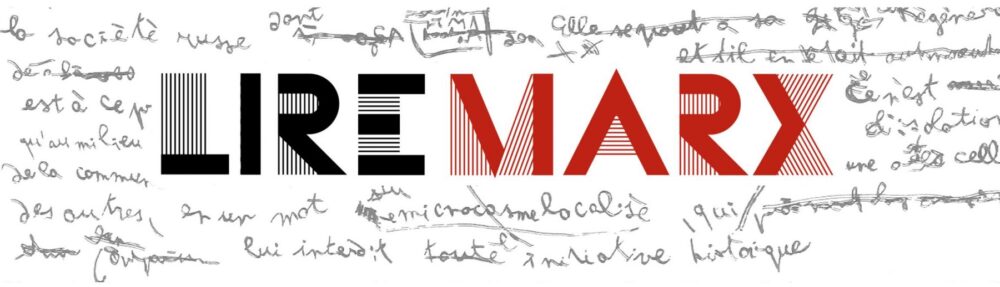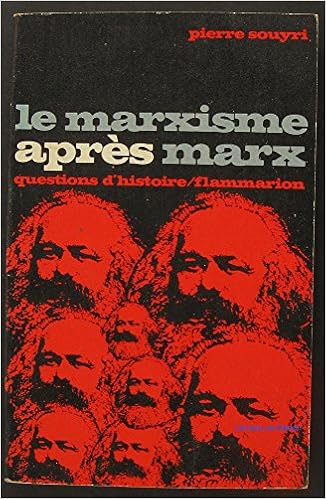 Pierre Souyri, Le marxisme après Marx, 1970
Pierre Souyri, Le marxisme après Marx, 1970
INTRODUCTION
Lorsque, douze ans après Marx, Engels disparaît à son tour en 1895, les hommes qui se considèrent comme leurs héritiers peuvent se sentir portés à l’optimisme. Sans doute de 1848 à 1871 toutes les insurrections ont-elles été écrasées, mais, rétrospectivement, ces défaites peuvent apparaître comme le résultat de l’immaturité des conditions nécessaires au renversement du capitalisme. Un prolétariat peu nombreux, faiblement concentré dans quelques régions industrielles encore rares, socialement hétérogène, politiquement mal éclairé et mal organisé ne pouvait pas alors triompher de l’ordre. Mais à l’orée du XXe siècle, les forces du prolétariat ont grandi au rythme même du développement capitaliste. Tandis que les nations d’Europe et la Russie s’engagent avec plus ou moins de rapidité dans l’industrialisation, que l’Amérique jette les bases de sa puissance future, l’Afrique et l’Asie, submergées par les puissances, sont entraînées dans l’orbite du capitalisme. En même temps que le mode de production capitaliste, le prolétariat tend à s’universaliser, et, en Europe du moins, il est déjà une puissance.
Pendant toute cette période la doctrine de Marx, ou plutôt une vulgate de cette doctrine, se répand dans les pays européens, en Russie et jusque dans les Balkans. Bientôt elle fera son apparition hors d’Europe, aux Amériques où de Leon prendra rang parmi les théoriciens marxistes de bon aloi, au Japon où Sen Katayama sera plus tard une figure marquante du Komintern, en Indonésie où est fondée, en 1914, une union social‑démocrate au sein de laquelle milite Sneevliet qui atteindra bientôt à une réputation internationale. L’Inde et la Chine ne sont encore qu’effleurées mais dès 1904 des cercles marxistes existent en Transcaucasie et en Iran, et bientôt après, parmi les Tatars musulmans de Russie. Le marxisme, qui dans les années cinquante et soixante du XIXe siècle restait confiné dans d’étroites minorités révolutionnaires n’existant que dans quelques pays occidentaux, est en train de prendre rang parmi les grandes idéologies du monde.
I – ORTHODOXES, RÉVISIONNISTES ET RADICAUX DANS LA 2e INTERNATIONALE (1895‑1918)
Nulle part cependant le marxisme n’apparaît aussi fortement implanté que dans les pays germaniques. L’Allemagne et l’Autriche en sont les bastions dans l’Internationale et ce sont presque toujours les Allemands et les Autrichiens ou bien des militants qui se trouvent mêlés à la vie du socialisme allemand – Rosa Luxembourg, Radek, Parvus, Pannekoek, etc. – qui suscitent les interrogations, élaborent les réponses, ouvrent les perspectives nouvelles. Marxistes français, anglais, espagnols, italiens – à l’exception de Antonio Labriola n’apportent qu’une contribution insignifiante à la théorie marxiste. Les Russes eux‑mêmes considèrent à cette époque les théoriciens allemands et autrichiens comme des maîtres.
LE « MARXISME ORTHODOXE » DE KAUTSKY
Le marxisme qui se répand alors en Europe c’est d’abord le marxisme tel que le comprend Kautsky. Pourtant la philosophie kautskyste ne coïncide pas avec celle de Marx telle qu’elle apparaîtra à mesure que les publications de textes ultérieurs et les réflexions critiques en révéleront la complexité. Comme beaucoup d’intellectuels européens de cette époque, Kautsky a subi la fascination des sciences de la nature et du darwinisme il a été ainsi amené à construire sa représentation de l’univers historique à l’image du monde naturel et à tenter de rendre compte du processus historique par le moyen d’un déterminisme univoque situé au niveau des contradictions de l’économie. Dès lors, tandis que le marxisme devient, bien plus que la théorie et la pratique de la révolution, la « science du développement social ». la conscience de classe tend à être réduite à un épiphénomène qui est lui même déterminé par les facteurs objectifs et, du même coup, la praxis révolutionnaire se trouve en quelque sorte inscrite par avance dans le développement des contradictions immanentes de l’économie. Le kautskysme aboutit ainsi à une représentation téléologique de l’histoire : la perspective du socialisme est fondée sur la certitude que l’évolution économique et sociale du capitalisme est en train de mettre en place, au terme d’un processus automatique et nécessaire, une force irrésistible de transformation de la société.
C’est en fonction de cette certitude que les marxistes apprécient la signification de la période que traverse alors le capitalisme et pensent leur action politique. Si, après la longue dépression commencée en 1873, la croissance a repris et se poursuit dans toute l’Europe sans qu’aucune grande crise économique et politique vienne troubler le continent, cette situation est tenue pour transitoire. Derrière les apparences trompeuses de cette « phase de développement pacifique », les contradictions économiques et sociales s’accumulent et resurgiront un jour avec plus de violence des profondeurs du système, attestant que celui‑ci a épuisé ses capacités de progrès et que les conditions du passage à un ordre social supérieur sont arrivées à maturité. Mais en attendant, le prolétariat se doit d’utiliser toutes les possibilités qui lui sont offertes pour occuper les meilleures positions possibles en vue des luttes révolutionnaires futures. En 1895, Engels dans son « Introduction à la lutte des classes en France », avait nettement formulé les tâches de la nouvelle période. Sans exclure que la violence puisse être finalement nécessaire pour briser le capitalisme, Engels définissait une stratégie adaptée aux nouvelles possibilités qu’offrait le renforcement, numérique du prolétariat au cours de cette phase où, par ailleurs, l’expansion du capitalisme atténuait relativement la brutalité des antagonismes sociaux. Le mouvement socialiste devait utiliser ce répit pour se donner des armées de masse qui investiraient progressivement les positions de l’adversaire au cours d’une multitude d’accrochages mineurs et prépareraient ainsi la bataille finale dans laquelle les gros bataillons prolétariens pourraient déployer infiniment plus de force que n’avaient, précédemment, pu le faire les minorités révolutionnaires.
Ainsi, au sein des partis socialistes s’établit une distinction entre le programme minimum qui assignait au mouvement un certain nombre d’objectifs politiques et syndicaux limités mais à portée de la main et le programme maximum, celui de la révolution, qui serait plus tard mis à l’ordre du jour par la crise du capitalisme et dont la réalisation aurait été préparée par l’exécution du programme minimum.
Kautsky en effet n’admet pas alors que le socialisme puisse naître progressivement d’une simple addition de réformes dans le cadre de la démocratie. C’est que, s’il tient la révolution prolétarienne pour inséparable de l’épanouissement de la démocratie, il ne pense pas que celle‑ci soit l’enveloppe nécessaire du capitalisme et doive inévitablement surgir du développement de celui‑ci. Il est au contraire persuadé que dans des pays comme l’Autriche et l’Allemagne, l’existence d’une forte bureaucratie d’Etat et d’une caste militaire, permettront aux classes dirigeantes de s’éloigner de plus en plus des méthodes démocratiques de gouvernement et que, d’une façon plus générale, l’évolution sociale que déterminera le développement du capitalisme tendra à miner les régimes démocratiques. Loin d’être donné par le capitalisme, l’épanouissement de la démocratie nécessaire au socialisme devra être conquis par de puissants mouvements de masse qui, finiront par conduire à la prise du pouvoir. Faite par des masses nombreuses et conscientes, que le socialisme aura longuement éduquées, la révolution ne comportera certainement pas les mêmes violences aveugles que celles du XVIIIe et XIXe siècle, mais elle n’en sera pas moins une cassure dans la continuité politique puisqu’elle enlèvera l’État aux classes possédantes pour en faire l’instrument de la dictature du prolétariat. Celle‑ci aura pour tâche d’organiser la transition du capitalisme au socialisme mais elle ne sera nullement la dictature d’une minorité imposant son pouvoir à la manière jacobine ou blanquiste. Elle se confondra au contraire avec le plein exercice de la démocratie par la majorité des travailleurs contre la minorité capitaliste qui sera contrainte de se soumettre et de disparaître.
Bien qu’aucun marxiste n’ait d’abord contesté le kautskysme, l’avenir rendra cependant manifeste tout ce que son orthodoxie marxiste avait de purement formel. En fait, Kautsky n’avait conservé de la théorie marxiste que la forme que celle‑ci assigne à la trajectoire historique du système capitaliste et, en réduisant la dialectique à une action causale de l’économie, il arrachait du marxisme la conception spécifique que celui‑ci a produit des conditions de la praxis et de sa fonction historique. Postulant que tout le développement du capitalisme était orienté vers une maturation des conditions du socialisme, le kautskysme ne conduisait pas à une philosophie de l’action révolutionnaire mais vers une sorte de quiétisme attentiste s’en remettant aux forces de l’histoire, conçue comme le produit d’une nécessité immanente à économie, du soin de faire surgir un ordre social nouveau.
L’ATTAQUE DES RÉVISIONNISTES
C’est cependant la représentation marxiste elle‑même de la trajectoire du développement capitaliste que vont contester les révisionnistes au terme de la dernière décennie du XIXe siècle, alors que le système paraît s’être assagi.
Il est vrai que très vite les rivalités impérialistes vont s’aggraver et que la paix apparaîtra bientôt menacée, mais, à l’articulation des deux siècles, la physionomie de l’évolution du capitalisme est suffisamment ambiguë pour que, en Allemagne, tout un courant de la pensée socialiste, animée par Bernstein, croit pouvoir affirmer la nécessité de « réviser le marxisme ».
Considérant l’évolution qui s’est accomplie entre 1891 et 1899, Bernstein estime que presque toutes les prévisions du système marxiste ont été prises en défaut. Loin d’évoluer vers une période de déséquilibres aggravés, le capitalisme a fait preuve de larges capacités d’adaptation ainsi qu’en témoigne la marche ascendante de la production dans laquelle les crises cycliques n’apportent plus que des perturbations très atténuées. Ni la formation d’une armée de réserve industrielle aux effectifs croissants, ni la paupérisation relative du prolétariat, ni la concentration du capitalisme qui devait faire disparaître les classes moyennes ne se sont réalisées. Le capitalisme dont l’expansion a augmenté les marges de profit a, au contraire, pu faire aux ouvriers d’importantes concessions : non seulement les salaires réels ont été largement relevés, mais un ensemble de réformes ont très sérieusement atténué les misères matérielles et morales des travailleurs, cependant qu’avec la régularisation de la croissance économique, l’instabilité de l’emploi et le chômage ont diminué. La concentration capitaliste s’est par ailleurs révélée comme un phénomène beaucoup plus lent et plus complexe qu’il n’était prévu. Elle n’a pas fait disparaître tous les petits et moyens possédants ni dans l’agriculture ni dans toutes les branches de l’industrie, et au sommet de la société, elle ne s’est pas identifiée à une centralisation croissante de la richesse entre les mains d’une minorité de magnats. Le nombre des capitalistes s’est au contraire accru. Enfin, – bien que les choses soient en retard en Allemagne –, les superstructures politiques de la société capitaliste se sont transformées et la démocratisation croissante des institutions tend à limiter la toute puissance de la bourgeoisie au sein de l’État.
Construisant alors l’avenir à l’image de la représentation qu’il s’est faite du processus de la société capitaliste au cours des dix dernières années, Bernstein récuse la vision marxiste du mouvement vers le socialisme. Celui‑ci, dit‑il, ne naîtra pas d’une aggravation des conditions sociales, ainsi que l’affirment les marxistes en projetant abusivement sur la réalité des schémas dialectiques empruntés à la métaphysique de Hegel, mais du processus d’adaptation du capitalisme qui ouvre des possibilités d’action nouvelle aux partis socialistes, s’ils savent comprendre que la perspective de la révolution n’est plus désormais qu’un mythe. Il leur appartiendra alors d’utiliser les possibilités de plus en plus larges offertes par les progrès de la démocratie pour se consolider progressivement à l’intérieur du système afin de le transformer graduellement, par le moyen de réformes qui, de proche en proche, feront disparaître la domination et l’exploitation de la classe capitaliste.
En substituant ainsi le schéma d’une évolution graduelle à celui d’un processus dialectique, Bernstein n’a pas seulement rompu avec la représentation marxiste de la forme du mouvement historique vers le socialisme, mais avec la manière même de concevoir ses déterminations et de fonder théoriquement la praxis. La totalité historique telle que Marx l’avait conçue se trouve brisée : dès lors que la lutte pour le socialisme ne prend plus racine dans l’aggravation des conditions objectives de la société et n’est plus fondée sur la nécessité historique du déclin du capitalisme et de son dépassement, elle n’a plus d’autre point d’appui que l’aspiration à un idéal.
Poussant en effet jusqu’à ses dernières conséquences la distinction entre ce qui dans le socialisme est « science du développement social » et ce qui est volonté de faire naître un ordre nouveau, Bernstein aboutira à la conclusion que la « théorie scientifique » qui a seulement pour objet de comprendre le mouvement de la réalité et ne saurait se faire normative pour indiquer ce qui « devrait être », doit nécessairement recevoir un complément éthique. C’est le néo‑kantisme qui connaît alors un vif prestige, qui donnera ce complément au révisionnisme. Dans la mesure où cette philosophie implique des impératifs moraux qui sont censés s’imposer à tous les hommes, elle doit permettre de faire apparaître le prolétariat comme porteur de revendications et de valeurs dans lesquelles la communauté sociale tout entière sera amenée à reconnaître, de proche en proche, sa propre marche vers une prise de conscience éthique d’elle‑même. Ainsi, la situation et la fonction du prolétariat dans le processus historique tel que Marx les avaient pensées se trouvent complètement bouleversées. Loin d’annoncer par son existence et sa lutte la dissolution violente de l’ordre contre les autres classes, le prolétariat devient un élément intégrateur dont la mission est de faire découvrir pacifiquement, à tous le corps social, ses fins éthiques communes.
Né dans la social‑démocratie allemande, le révisionnisme eut des retentissements dans les partis étrangers, et en particulier en Russie. Si Strouvé, qui affirme que les conceptions catastrophiques élaborées vers le milieu du XIXe siècle doivent disparaître d’une vision réaliste de l’évolution contemporaine, qui rend caduque l’idée de faire naître le socialisme par une révolution politique, n’apporte guère d’éléments nouveaux, il en va différemment pour Tougan‑Baranovski. Après avoir polémiqué contre les populistes pour démontrer la possibilité d’un développement capitaliste de la Russie, il aboutit en 1902 à une rupture radicale avec la conception marxiste du capitalisme comme système dominé par des contradictions insurmontables : à la seule condition que la croissance des moyens de production se maintienne à un niveau élevé, l’économie capitaliste peut rester en permanence dans une situation d’équilibration dynamique, expliquera Tougan‑Baranovski qui dès lors abandonnera le marxisme.
En France, où les réactions contre l’abâtardissement d’un socialisme, prenaient la forme du syndicalisme révolutionnaire, Sorel développa un révisionnisme qui le situait sur le flanc gauche du marxisme : ce n’était pas pour justifier des pratiques réformistes mais, au contraire, parce qu’il tenait pour illusoire la volonté et la capacité des marxistes à exercer des capacités révolutionnaires qu’il entreprit de critiquer leurs conceptions. Sorel, dont la pensée procède d’un syncrétisme qui s’est efforcé d’intégrer des vues empruntées tour à tour à Proudhon, Hegel, Marx et Bergson, s’en prend d’abord au matérialisme historique, tel du moins qu’il est alors compris : lorsque les marxistes prétendent fonder la perspective révolutionnaire sur l’analyse des contradictions du développement capitaliste, ils sont victimes d’un rationalisme pseudo‑scientifique qui postule la possibilité de rendre compte du devenir social au moyen de conceptions empruntées aux sciences de la nature. Or, c’est là pure mystification car l’histoire est imprévisible. Elle n’est pas mise en mouvement par un déterminisme objectif que l’analyse pourrait mettre à jour, mais par des mythes, c’est‑à‑dire par des complexes d’images motrices chargées d’affectivité et génératrices d’action : c’est par l’intensité avec laquelle les mythes sont vécus et traduits en actes que l’avenir se réalise. Or le monde moderne est habité par un mythe, celui de la grève générale, dans lequel s’affirme, face à un monde bourgeois a perdu la grandeur qui l’avait animé à l’époque révolutionnaire et napoléonienne pour sombrer dans le souci vulgaire de jouir en sécurité des biens matériels, la morale combattante et héroïque du prolétariat. Le socialisme sera, bien plus encore qu’un bouleversement social, une mutation régénératrice de l’éthique et de la culture : détruisant les valeurs dégradantes de la bourgeoisie et la culture ornementale et stérile de cette classe, les prolétaires feront surgir, par la violence, une civilisation nouvelle où l’intelligence de la production et les dures vertus qui, naissent du travail et de la lutte seront reconnues comme les valeurs suprêmes. Or le socialisme marxiste, qui rétrécit son action aux dimensions des luttes électorales ou parlementaires et entretient parmi les producteurs des illusions démocratiques qui masquent la nécessaire violence des antagonismes de classes, ne peut ni fournir les idées‑forces, ni faire surgir les mentalités indispensables à l’accomplissement du grand drame prolétarien qu’exige le déclin de la civilisation bourgeoise. En fait, le marxisme des socialistes n’est pas l’idéologie des producteurs mais du « prolétariat intellectuel » qui cherche, par des actions politiciennes, à canaliser et à dévoyer les aspirations des travailleurs eu, plutôt, de tous les mécontents, pour se hisser au pouvoir.
LA RIPOSTE
Cette mise en question du marxisme au sein même du mouvement socialiste suscita de vives ripostes venues de plusieurs pays. Antonio Labriola, en particulier, insista sur la nécessité de renoncer à considérer le processus historique comme un mouvement dialectique purement objectif pour restituer à la conscience et à la praxis une fonction active dans le dénouement de situations qu’aucun déterminisme n’a fixé par avance.
Mais c’est en Allemagne que la querelle du révisionnisme eut le plus de retentissement et atteignit le plus d’éclat.
S’efforçant d’approfondir la théorie des crises, Kautsky affirmait en 1902 contre Tougan‑Baranovski, que le capitalisme ne pouvait pas fonctionner comme un systèrne fermé et se trouvait dominé par la nécessité de trouver des débouchés dans les nations précapitalistes. Kautsky fut ainsi conduit à relier pour la première fois des phénomènes tels que l’aggravation des rivalités coloniales internationales, la lutte plus âpre pour les exportations, le passage au protectionnisme et la poussée du militarisme, aux contradictions internes du capitalisme. Entrevoyant dès lors que toute une longue période de guerres et de convulsions se profilaient déjà à l’horizon du début du XXe siècle, il rejeta catégoriquement les idées de Bernstein sur l’adaptation du capitalisme et toutes les conséquences réformistes que celui‑ci prétendait en tirer : loin de s’atténuer, les crises allaient au contraire s’aggraver et conduire le capitalisme vers une période de stagnation qu’exacerberaient les luttes de classes et les antagonismes entre États. Au demeurant, ajoutait Kautsky, la vision bernsteinienne d’une démocratisation progressive de l’État ouvrant la perspective d’un passage indolore et graduel au socialisme ne correspond à aucune réalité. Le système parlementaire avait atteint ses sommets à l’époque où le capitalisme incarnait l’avenir des nations, mais il entrait maintenant dans la voie du déclin et ne pourrait retrouver sa vigueur que par une révolution. Cependant, même lorsque, après la révolution russe de 1905, Kautsky admettait que la lutte pour le socialisme pouvait éventuellement prendre la forme d’une grève de masse culminant dans une insurrection, il ne parvenait pas à se départir des conceptions objectivistes qui avaient toujours été à la base de sa pensée. Il avait récusé la vision du processus historique qu’avaient formulé les révisionnistes mais ce processus lui‑même restait conçu comme une mécanique sociale. La dialectique de la nécessité et de la liberté restaient absentes du marxisme de Kautsky, et la pensée socialiste continuant à buter sur le dilemme surgi des conceptions symétriquement opposées des révisionnistes et des « marxistes orthodoxes », ne parvenait pas à établir si une société nouvelle devait naître de la fatalité des lois économiques ou de pures intentions éthiques. C’est une nouvelle génération de marxistes, qui dépassera cette antinomie. Souvent mêlés aux luttes du socialisme russe et polonais, fortement marqués par la révolution de 1905, les drames balkaniques, les crises internationales, les menaces de guerre, ils pressentaient bien mieux que leurs aînés arrivés à maturité en pleine période de progrès pacifique, que le XXe siècle serait lourd de tragédies historiques et que le temps de la lucidité et de l’action était venu pour les révolutionnaires.
Dès 1904 Parvus donnait le ton et dépassait largement les prévisions de Kautsky sur les violences latentes que contenait la civilisation capitaliste. Considérant que le développement de l’économie capitaliste n’était plus compatible avec les limites trop étroites des États nationaux d’Europe, il prévoyait le déclenchement de luttes pour la domination mondiale qui, à travers une succession de convulsions dramatiques, aboutiraient à l’élimination des nations les plus faibles et à la formation de vastes empires qui survivraient seuls au milieu des ruines.
C’est aussi la perspective d’un développement violemment convulsif du capitalisme que Rosa Luxembourg opposait aux schémas révisionnistes d’une adaptation graduelle du système. Cependant, persuadée que le marxisme ne pouvait pas être considéré comme une construction théorique achevée, lors des polémiques contre les révisionnistes, elle s’employa, plus que tout autre, à élucider les transformations qui s’étaient produites dans les structures et le fonctionnement du capitalisme, afin de pouvoir prendre la mesure d’une époque nouvelle et de résoudre les problèmes tactiques et stratégiques qui se poseraient au socialisme.
Accusant Bernstein de s’être laissé influencer par les fabiens, elle chercha à dépasser l’apparence des phénomènes qui se manifestent à la surface de la vie sociale pour démontrer que l’atténuation des crises n’avait qu’un caractère transitoire. Si, disait‑elle, l’émergence des cartels et des trusts, favorisée par le développement du crédit, a tempéré les luttes concurrentielles sur le plan intérieur, celles‑ci se sont aggravées à l’échelle internationale et la « mise en jachère » d’une importante proportion du capital n’a pas pu être évitée. En réalité, la réanimation de la croissance économique, qui s’est produite à la fin du XIXe siècle, n’est que le résultat passager de la dilatation des marchés internationaux consécutive aux entreprises impérialistes. Mais à plus long terme, lorsque tout le globe sera intégré au capitalisme, la possibilité d’atténuer les contradictions internes des pays les plus avancés, par l’élargissement vers l’extérieur du champ d’application du capital, se trouvera ruinée. Dès lors, tandis que la « mise en jachère » du capital prendra des proportions de plus en plus importantes, les crises se répéteront avec une violence croissante. Il deviendra alors évident que la phase ascendante du capitalisme a pris fin avec la mondialisation du système.
C’est en fonction de cette vision de l’avenir du capitalisme – elle en rectifiera par la suite certains aspects – que Rosa Luxembourg entreprendra de démontrer l’inconsistance des conceptions révisionnistes de la marche vers le socialisme. Il est en particulier, expliquait‑elle, complètement illusoire de croire que les syndicats par viendront à s’associer puis à se substituer au pouvoir patronal dans les usines, et à obtenir parallèlement des augmentations de salaires telles que le profit et l’exploitation se trouveront, de proche en proche, réduits et finalement abolis. A mesure en effet que le capitalisme entrera dans sa phase de déclin, la conjoncture du marché s’aggravera pour la force de travail et le patronat exerçant une pression croissante sur les salaires pour compenser la diminution de ses profits, les luttes entre le capital et le travail deviendront de plus en plus âpres. L’action syndicale restera, certes, un des éléments du combat contre le capitalisme, mais elle doit se débarrasser aussi bien des chimères anarchistes, du mythe de la grève générale suffisant à briser la domination du capital que des naïvetés réformistes. Seule la conquête du pouvoir par le prolétariat peut mettre un terme à la domination de la bourgeoisie. Mais encore ne convient‑il pas de s’illusionner sur le rôle que peuvent jouer les luttes parlementaires dans la réalisation d’une telle entreprise. Toute la force du mouvement socialiste réside dans l’organisation et l’action des masses en dehors du Parlement et sa victoire ne peut surgir que de la « ruine de l’État » dans lequel s’incarne « la violence politique de la bourgeoisie ». Les actions légales de la social‑démocratie, tout le travail de propagande et d’organisation par lequel elle vise à éveiller la conscience de classe du prolétariat, n’ont de sens que dans la mesure où elles préparent le moment où la « révolution descendra des têtes dans les poings ». La violence est « la loi suprême de la lutte des classes » et si le prolétariat, se conformant aux vues révisionnistes, devait se cantonner dans l’action légale, tôt ou tard son mouvement s’effondrerait devant « la violence sans limite de la réaction ».
Au cours de la lutte contre le révisionnisme, Rosa Luxembourg a ainsi pris ses distances vis‑à‑vis de la conception kautskyste d’un mouvement historique s’acheminant nécessairement vers un dépassement socialiste des contradictions économiques. Pour elle, le socialisme n’est nécessaire que dans la mesure où surgit de la totalité historique, la volonté révolutionnaire et consciente d’une classe en même temps que la situation objective sur laquelle cette volonté puisse avoir prise, mais surtout, au sein même de cette totalité, le processus objectif et l’action de classe ne sont plus compris comme situés dans une simple relation de cause à effet: ils s’y trouvent intégrés comme éléments agissant réciproquement l’un sur l’autre. C’est l’action consciente du prolétariat qui constitue la force opérante de la transformation révolutionnaire dont le processus objectif crée seulement les conditions. Loin d’être par avance inscrit dans le ciel de l’histoire, le socialisme n’est qu’une chance à saisir : s’il n’est pas, en temps voulu, arraché des flancs de la vieille société, par l’action décisive des masses, la société tout entière régressera vers la barbarie. Du même coup, la théorie marxiste se voit assigner une notion et des fonctions nouvelles : elle n’est plus seulement une science, livrant la connaissance objective des lois d’un processus historique orienté par l’économie, mais une critique du réel, élaborée d’un point de vue de classe, en vue d’éveiller les masses à la conscience de leur tâche historique et d’ouvrir la voie à la pratique révolutionnaire.
CONTROVERSES SUR L‘IMPÉRIALISME ET L’AVENIR DU CAPITALISME
La critique révisionniste constituait cependant pour le marxisme un défi qui ne pouvait être réellement relevé que dans la mesure où celui‑ci ferait la preuve qu’il était capable de rendre compte de la physionomie nouvelle que l’univers capitaliste était en train de prendre au début du XXe siècle. Que signifiait en fin de compte dans l’histoire du capitalisme l’atténuation des crises, l’expansion impérialiste, la politique protectionniste, l’importance croissante des armements, l’aggravation des tensions internationales, la montée des revendications nationales qui s’affirmaient en Europe et s’annonçaient en Asie ? Autant de questions qui assaillaient de tous côtés la théorie marxiste et l’invitait à démontrer par des analyses concrètes qu’elle ne constituait pas un système refermé sur lui‑même et déjà relégué par le mouvement historique au rang des idéologies mortes. L’ampleur des recherches théoriques qui furent alors entreprises, le haut niveau auquel se situèrent souvent discussions et polémiques, montrèrent que la théorie marxiste ne s’était pas pétrifiée en orthodoxie et qu’elle était capable de se renouveler. Mais la difficulté d’intégrer dans un système théorique cohérent une multitude de faits nouveaux dont l’évolution historique ne faisait pas toujours apparaître immédiatement le sens et la portée, les présuppositions philosophiques différentes à partir desquelles furent effectuées les recherches de Kautsky, des radicaux, des austro-marxistes, la diversité des milieux historiques et culturels dans lesquels les uns et les autres s’étaient formés, les options politiques souvent opposées qui sous‑tendaient les constructions doctrinales, brisèrent l’unité du marxisme européen. Il n’y eut pas une théorie de l’impérialisme mais plusieurs théories conduisant à des déductions pratiques contradictoires.
Les marxistes n’ont pris qu’assez tard l’exacte mesure de l’importance de l’impérialisme et de l’expansion coloniale. En 1898, Kautsky ne voyait encore dans les expéditions coloniales que le produit du retard du développement capitaliste : si elles bénéficiaient à des milieux restreints représentant les archaïsmes de la société capitaliste – traitants, spéculateurs, militaires et fonctionnaires aventureux – elles étaient contraires aux intérêts des maîtres de l’industrie; un développement plus avancé du capitalisme, le renforcement de l’influence politique des industriels qui en résulterait, conduirait vraisemblablement les gouvernements à y renoncer. C’est seulement entre 1902 et 1907 que Parvus et Kautsky parvinrent à situer l’impérialisme dans une autre perspective et à le relier non pas à l’immaturité du capitalisme mais aux formes les plus avancées de son évolution. Il est vrai que leurs conceptions ne coïncidaient pas exactement. Parvus insistait plus particulièrement sur l’importance que prenaient dans les pays avancés les excédents de capitaux qui cherchaient à s’investir dans les pays attardés où une composition organique du capital moins élevée permettait de réaliser des profits plus hauts. Kautsky, développant des conceptions déjà formulées dans sa théorie des crises, faisait dériver l’impérialisme de la nécessité pour les pays industriels de se donner des dépendances agricoles qui fourniraient des matières premières à bas prix et permettraient une croissance ininterrompue et plus rapide, en offrant aux industries des métropoles des marchés protégés et en expansion. Leurs théories n’en présentaient pas moins de nombreux traits de similitude. L’un et l’autre considéraient l’impérialisme comme le résultat de l’impossibilité pour chaque capitalisme national de fonctionner plus longtemps dans le cadre de ses frontières et de l’obligation où il se trouvait de se doter d’empires qui seraient fermés à la concurrence étrangère. L’impérialisme cependant ne pourrait offrir, pensaient‑ils, qu’une issue transitoire aux contradictions de l’accumulation. Sans doute, les travaux d’équipement effectués dans les territoires conquis, la politique d’armements qui accompagnerait nécessairement les luttes pour la création et la défense des empires – Parvus soulignait qu’il en résulterait un endettement de l’État qui se trouverait ainsi de plus en plus soumis au capital contribueraient‑ils à faciliter et à intensifier l’accumulation. Mais à plus ou moins long terme, les contradictions qui étaient à l’origine de l’expansion impérialiste resurgiraient, poussant chaque puissance à dilater au détriment des autres, ses zones de domination et la guerre surgirait inévitablement de ces antagonismes. Parvus et les radicaux considéraient que des conflits de plus en plus meurtriers étaient inexorablement inscrits dans le fonctionnement même du capitalisme et qu’il n’y avait pas d’autre politique de paix que la lutte pour le renversement révolutionnaire du système.
Mais déjà les marxistes autrichiens, qui étaient assez peu enclins à accepter les conclusions politiques des radicaux, avaient élaboré d’autres analyses qui ouvraient des vues toutes différentes sur l’avenir du capitalisme impérialiste. Dès 1907 en effet, Bauer avait laissé entrevoir qu’après une période critique pour la paix, l’impérialisme pouvait aboutir à son auto‑dépassement, Si, expliquait Bauer, la politique impérialiste multipliait les risques de conflit, minait les régimes démocratiques qui se militarisaient et brutalisaient les peuples assujettis, elle avait aussi pour effet d’intégrer ces peuples dans le cycle de la civilisation moderne et de préparer les voies à une économie mondiale au sein de laquelle les taux de profit tendraient à s’égaliser et qui fourniraient finalement les bases pour un dépassement des nationalismes. C’est cependant Hilferding qui, en 1910 précisa le plus nettement les perspectives d’une phase ultra‑impérialiste et pacifique du capitalisme. Développant de manière systématique des conceptions qui se trouvaient esquissées chez Bauer, Hilferding a bâti toute sa. théorie de l’impérialisme par rapport aux mutations qui se produisent dans les structures et le fonctionnement du capitalisme, lorsque la concentration des capitaux atteint un certain niveau et conduit à la formation de trusts et de cartels. Tandis que la fusion du capital bancaire et industriel conduit alors à l’émergence d’une étroite et puissante oligarchie financière qui se trouve à la tête d’un nombre décroissant de grandes firmes, la concurrence se trouve en voie de négation dans les limites du marché national. Dès lors, cartels et trusts sont conduits par la nécessité de compenser la chute du taux de profit à utiliser la situation de monopole qui surgit de l’affaiblissement des luttes concurrentielles, pour fixer le volume de leur production et le niveau de leur prix de telle manière que la vente des marchandises leur permette de réaliser des surprofits. Si les progrès de la concentration permettent ainsi, à mesure que des secteurs toujours plus vastes de la production se trouvent intégrés aux organismes monopoleurs, d’exercer un certain contrôle conscient sur le fonctionnement de l’économie nationale, l’apparition et le développement de pratiques monopolistes semblables, dans tous les grands pays capitalistes, conduisent à une redoutable aggravation des compétitions internationales. La réalisation des surprofits n’est en effet possible que dans la mesure où le marché est protégé contre la concurrence étrangère, mais en même temps, comme la recherche des surprofits et la hausse des prix qui en résulte tendent à restreindre les capacités du marché national, elle suscite, parmi toutes les puissances capitalistes, une intensification des luttes pour l’exportation. Que celles‑ci prennent la forme du « dumping » contre lequel les gouvernements étrangers ne tardent pas à réagir, ou que l’État entreprenne une politique d’expansion territoriale destinée à élargir les zones protégées où peuvent être réalisés les surprofits, les compétitions concurrentielles tendent désormais à se métamorphoser en rivalités politiques et militaires. Tous les États poursuivant des buts incompatibles – faire respecter l’étanchéité de son propre espace économique tout en essayant de pénétrer dans celui du voisin – les risques d’affrontements militaires surgissent de tous côtés.
Cependant, à la différence des radicaux, Hilferding ne tient pas pour acquis que la période de conflits armés, vers laquelle l’impérialisme menace de conduire le monde, ouvre nécessairement la perspective d’une dislocation générale du régime capitaliste sous les coups de la guerre et de la révolution. La phase dramatique dont la concentration capitaliste et les rivalités impérialistes contiennent les prémisses, ne constitue qu’un moment dans la dialectique globale que décrit le processus historique du capitalisme. C’est qu’en effet, la concentration du capital se poursuivant sur le plan international peut conduire, comme elle l’a déjà fait dans le cadre de chaque capitalisme national, à une négation et à un dépassement des antagonismes concurrentiels au sein d’une économie mondiale unifiée sous la domination d’un ultra‑monopolisme. C’est un point de vue assez analogue qu’adoptera à partir de 1911 Kautsky. Récusant l’idée que l’impérialisme est le produit nécessaire des contradictions du capitalisme, il le définira comme une simple politique pouvant être combattue avec succès jusqu’à ce que le monde parvienne à une phase post‑impérialiste caractérisée par une cartellisation internationale et une nouvelle période de développement pacifique. Ainsi les conceptions des radicaux, qui, avec Parvus, affirmaient que le système capitaliste approchait maintenant de la période critique de son histoire exigeant que les tâches pratiques de la révolution prolétarienne soient mises à l’ordre du jour, se trouvaient remises en question. C’est pour ruiner les implications attentistes des théories des austro‑marxistes et de Kautsky que Rosa Luxembourg entreprit de démontrer au contraire que les contradictions du processus d’accumulation, après avoir amené le capitalisme à déborder sur toute la surface de la terre, conduisaient à une impossibilité de son développement. Critiquant les schémas de Marx sur la reproduction élargi qui ne tiennent pas compte de l’élévation de la composition organique du capital intervenant d’un cycle productif à l’autre, elle aboutit à la conclusion que, si on ne néglige pas ce phénomène, on constate que le capitalisme fonctionne en produisant constamment un reliquat de marchandises quine peuvent être vendues qu’aux couches précapitalistes de l’Europe – artisans, paysans, etc. puis aux peuples colonisés qui n’ont pas encore atteint au stade de la production capitaliste. Or, à mesure que le capitalisme se développe il décompose les couches précapitalistes; des métropoles et contraint les pays d’outre‑mer à passer de l’économie naturelle à la production marchande puis, par suite notamment des exportations de capitaux, de la simple production marchande à la production capitaliste. Ainsi considérée dans sa dimension mondiale, la marche de l’accumulation produit une contradiction insurmontable: le capitalisme ne peut réaliser l’accumulation qu’en intégrant à son fonctionnement des formations non capitalistes, mais, au cours de cette intégration, le rapport capitaliste de production tend à s’universaliser, et, par là même, les conditions nécessaires à l’accumulation se trouvent en voie de destruction.
La théorie luxembourgiste de l’accumulation suscita cependant de fortes objections qui ne furent pas seulement formulées par les adversaires de droite de Rosa Luxembourg : Pannekoek, Lénine, et plus tard Boukharine furent parmi ses critiques. A l’exception de Bauer qui admit que les schémas du Capital ne permettaient pas de résoudre le problème de l’accumulation mais n’en rejeta pas moins l’idée que le capitalisme ne peut pas fonctionner sans environnement précapitaliste, les critiques de Rosa Luxembourg considérèrent que toute sa démonstration était faussée par les postulats sous‑consommationnistes qui étaient à son point de départ. Hilferding et Lénine se trouvèrent d’accord pour affirmer, après Marx, que la production capitaliste crée elle‑même ses débouchés au cours de son développement et, tout en admettant que, périodiquement, l’essor de la production se heurte aux bases trop étroites de la consommation, ils rappelèrent le rôle que joue la rupture des proportions nécessaires entre les deux sections de la production dans la marche contradictoire du développement économique. Cependant, aux approches de la guerre, ce n’étaient pas les discussions sur la signification des schémas du Capital qui constituaient la véritable base des clivages qui s’accentuaient dans le mouvement socialiste, mais les appréciations portées sur les caractères de la période historique qui s’annonçait. Contestable dans ses présuppositions et ses conclusions, la théorie luxembourgiste de l’accumulation projetait une vision dramatique du développement capitaliste qui, était certainement mieux à la mesure des violences de l’époque que les perspectives offertes par Kautsky et les austro‑marxistes.
LA QUESTION NATIONALE ET COLONIALE
Divisés par les problèmes de l’impérialisme, les marxistes ne l’étaient pas moins par la question nationale et coloniale que l’époque allait poser avec une intensité croissante.
En raison des conceptions déterministes par rapport auxquelles s’organisait leur représentation du processus historique, les marxistes de la 2e Internationale ne parvinrent pas en effet à saisir immédiatement la relation qui pouvait s’établir entre la lutte des peuples assujettis et celle du prolétariat. Pour eux, les peuples attardés aux différents stades des sociétés précapitalistes se situaient encore en dehors de la véritable histoire, celle qui, mettant face à face le capital et le travail, se dénouerait par un renversement de toutes les oppressions. A long terme cependant ils y seraient intégrés dans la mesure où l’expansion du capitalisme faisait surgir parmi eux des formes modernes de production et de vie sociale d’où naîtrait, en son temps, la contradiction du capital et du travail. Mais il fallait attendre que l’histoire ait fait son œuvre et le problème du socialisme ne pourrait être posé dans les pays dépendants que lorsque la maturation des conditions économiques en aurait créé les présuppositions : jusque‑là, on ne pouvait lutter que pour aménager dans certaines limites les formes les plus brutales d’oppression et d’exploitation. La corrélation étroite qui était ainsi posée entre la maturation de l’économie capitaliste et la perspective socialiste conduisait à tenir po, que les différents pays aborderaient la phase dans l’ordre des niveaux de développement qu’ils auraient respectivement atteint. Les pays les plus avancés étant ainsi appelés à entrer les premiers dans la voie du socialisme, il appartiendrait éventuellement à leurs gouvernements prolétariens, d’exercer une tutelle éclairée sur les colonisés pour les guider à leur tour vers le socialisme.
Cette manière d’imaginer l’avenir conduisait les partis socialistes à être très réticents devant les revendications nationales en Europe comme aux colonies ou même à les tenir pour aberrantes ou réactionnaires. Pour Kautsky les sentiments nationalistes surgissaient du renforcement oppressif des appareils d’État centralisateurs dans les empires multinationaux mais ils se situaient à contre-courant des tendances fondamentales de l’évolution capitaliste qui conduisaient à un effacement des différences nationales et à un développement des bases de l’internationalisme. Ils seraient donc dépassés lorsque le socialisme liquiderait dans les anciens empires les formes archaïques de la domination politique. A Vienne, Renner redoutait que les nationalismes qui s’affirmaient dans l’empire ne prennent des formes séparatistes : en désintégrant l’empire, les nationalités briseraient aussi le vaste ensemble territorial rassemblé par les Habsbourg qui constituait le cadre nécessaire d’un développement économique rapide conduisant à l’éclosion d’une conscience supra‑nationale. Plus nuancée, Rosa Luxembourg s’efforçait de fixer ses positions à partir d’une analyse concrète de chaque nationalisme. Si elle considérait qu’il était légitime que les peuples arriérés des Balkans aspirent à renverser la domination turque qui entravait tout progrès, elle tenait, par contre, le nationalisme polonais pour dépassé. En Pologne existait déjà un prolétariat et il lui incombait, non pas de rendre vie au séparatisme, mais de lutter en commun avec les russes pour le socialisme.
C’est seulement après 1905 que les marxistes furent amenés, de proche en proche, à considérer les questions nationales et coloniales selon une optique nouvelle. Ils y furent d’abord conduits par les événements. La violence des luttes soutenues par les peuples allogènes de Russie en 1905 et 1906 et la montée des revendications nationales dans l’Europe danubienne et balkanique montraient assez que les nationalismes n’étaient pas résiduels, cependant que les premières révolutions de l’Orient et la formation des partis socialistes dans plusieurs pays d’Asie, remettaient en question l’idée que la lutte pour le socialisme serait exclusivement axée sur les grands pays d’Europe. Les marxistes de cette époque ne purent cependant intégrer ces faits nouveaux dans une représentation cohérente qu’en rompant avec les représentations du processus historique qui naissaient de leur déterminisme économique, pour retrouver la dimension dialectique du marxisme et, avec elle, la possibilité d’élaborer d’autres visions du mouvement historique.
La réaction contre le marxisme vulgaire, qui s’était développée au cours de la lutte contre le révisionnisme, avait pris à Vienne des formes particulières. Les théoriciens de la nouvelle génération et en particulier Max Adler avaient entrepris de synthétiser le marxisme et le néokantisme qui,, en face du monde naturel et économique régi par un déterminisme rigoureux, permettait de réaffirmer la liberté active de l’homme. Adler avait ainsi été amené à construire une ingénieuse philosophie hégélio‑kantienne de l’histoire. Si, expliquait Adler, qui concevait la dialectique comme un mouvement purement objectif, le passé était intelligible comme la réalisation d’une nécessité, à un certain moment du développement – à l’époque moderne – une mutation qualitative intervenait dans l’agencement interne du processus historique. Celui‑ci cessait alors d’être uniquement déterminé de manière objective pour s’entrouvrir sur une action libre de l’homme qui pouvait dès lors intervenir pour construire l’avenir en fonction des impératifs de l’éthique kantienne laquelle, à cette étape de l’évolution historique, s’affirmait comme un a priori s’imposant à tous.
C’est à travers cette philosophie qu’en 1907 Bauer entreprend d’élucider la question nationale. La conscience éthico‑sociale que produit l’histoire et qui devient alors son moteur, trouve d’abord, dit‑il, sa réalisation dans la conscience nationale. Celle‑ci, qui ne présuppose nullement qu’un peuple ait une langue et un territoire défini, naît du sentiment d’une communauté de destin, et elle constitue un moment nécessaire dans le développement historique. Loin de manifester des réticences devant les revendications nationales, les socialistes doivent les accueillir comme le signe que le peuple qui les formule atteint à un premier stade de la conscience éthico‑sociale et, en les situant dans la dialectique de l’histoire, comprendre que c’est la réalisation et non pas le rejet de l’idée nationale qui permettra à celle‑ci de se dépasser dans l’éclosion d’une conscience internationale.
Cette nouvelle façon de penser la question nationale et ses relations avec l’internationalisme influença les réflexions de tous les partis socialistes qui avaient à se préoccuper du problème. Tout en rejetant l’éclectisme philosophique des austro‑marxistes, et en refusant d’admettre qu’un peuple sans territoire et sans unité linguistique puisse constituer une nation, les bolcheviks sauront tirer profit des conceptions dialectiques de Bauer. C’est au contraire parce qu’elle ne fondait pas la nationalité sur la possession d’un territoire que la théorie de Bauer sera en faveur auprès des socialistes des Balkans : ils y verront le moyen de mettre un terme aux luttes des peuples qui l’enchevêtraient dans des provinces comme la Macédoine en donnant à chacun son autonomie culturelle dans le cadre d’une fédération balkanique.
A la même époque, des manières nouvelles de considérer les problèmes de la colonisation étaient également apparues. Dès 1903 le hollandais Wiedijk avait remis en question l’idée que la domination des pays avancés fasse nécessairement naître dans les pays d’outre‑mer des structures économiques et sociales modernes. Wiedijk avait en particulier montré que la colonisation néerlandaise qui prenait appui sur les vieilles classes dirigeantes locales ne conduisait pas à une industrialisation de l’Indonésie. En 1907, Kautsky aboutissait à des conclusions analogues. Dans bien des cas, soulignait‑il, l’exploitation des colonies s’opère par des moyens – travail forcé, commerce de traite, etc. – qui laissent intacts ou même consolident les modes de production et les formes de vie sociale les plus archaïques De là, on aboutit vite à la critique de l’idée que les pays colonisés devraient nécessairement passer par l’étape capitaliste avant d’être mûrs pour le socialisme. Dès 1903, les hollandais Mendels et Gorter envisageaient la possibilité pour les pays arriérés d’enjamber la phase capitaliste si la révolution prolétarienne triomphait assez tôt dans les pays avancés et les signes annonciateurs du réveil de l’Asie allaient bientôt permettre d’assigner aux peuples assujettis un rôle historique actif. Si Rosa Luxembourg tenait le prolétariat européen pour le pivot de l’action révolutionnaire, dans l’Accumulation elle n’en avait pas moins situé les luttes coloniales dans le contexte d’une résistance générale au capitalisme. En 1912, Pannekoek et les Tribunistes néerlandais reliaient plus clairement les luttes coloniales et la révolution européenne : en faisant obstacle à l’expansion du capitalisme, les révolutions d’Asie allaient aggraver en Europe les antagonismes sociaux et les rivalités impérialistes de sorte que guerres européennes, révolutions prolétariennes et soulèvements coloniaux pourraient s’intégrer dans une dynamique mondiale de la révolution.
Cependant les minorités de l’extrême‑gauche marxiste qui parvenaient ainsi à une prise de conscience du caractère mondial de la révolution se refusaient à envisager qu’une liaison positive puisse s’établir entre les luttes des nationalités européennes et celles du prolétariat. En 1916 Radek, Gorter, Henriette Roland‑Holst, etc. se retrouveront d’accord avec Rosa Luxembourg pour dénier tout caractère révolutionnaire aux aspirations nationales des peuples d’Europe et de Russie. Le nationalisme, expliquait Rosa Luxembourg, est un moule vide dans lequel « chaque période historique et les rapports de classes dans chaque pays coulent un contenu matériel particulier ». Avec le développement de l’impérialisme, tous les peuples d’Europe avaient été intégrés à l’un ou à l’autre des blocs en conflit et leurs revendications nationales manipulées par les belligérants n’étaient qu’un élément de la stratégie des Etats impérialistes. A l’heure où le capitalisme s’embourbant dans la guerre impérialiste, mettait à l’ordre du jour la lutte pour la révolution prolétarienne, les aspirations à l’indépendance des « micro‑bourgeoisies » venaient trop tard et n’avaient plus de signification révolutionnaire.
II – GRANDEUR ET LIMITES DU MARXISME RUSSE (1884‑1924)
L’importance du marxisme russe réside d’abord dans le fait que, sous la forme du bolchevisme, il envahit après 1917 la scène internationale et bouleverse la situation du socialisme : rejetant la social‑démocratie vers la droite, il cristallise pour un temps – si on fait exception des quelques pays, l’Espagne surtout, où l’anarchisme restera vivace – toutes les aspirations des révolutionnaires. Il y parvient parce qu’il est lié au succès de la première révolution prolétarienne, mais surtout parce qu’il paraît se confondre avec le réalisme révolutionnaire. S’étant forgé dans un pays où le caractère policier et despotique de l’État contraignait les opposants à l’action clandestine et à la lutte insurrectionnelle, il est dépourvu d’illusions pacifistes et « légalistes » et a porté à un niveau très élevé, l’organisation efficace de la violence. C’est parce qu’il propose une « realpolitik » au prolétariat qu’il s’implantera dans les pays où, en Europe ou dans les autres continents, révolution et contre‑révolution s’affrontent dans des combats acharnés. Ailleurs, son influence sera passagère ou superficielle.
Le bolchevisme n’est pas cependant qu’une forme radicalisée du marxisme. Confronté avec les problèmes de la lutte révolutionnaire dans un pays qui par ses particularités se situait en marge de l’Europe, le marxisme russe a brisé les conceptions européocentriques qui avaient dominé les partis de la 2e Internationale et élaboré, pour la première fois, une conception systématisée de la lutte des classes comme processus mondial. C’est sous la forme du bolchevisme que le marxisme pénétrera vraiment en Asie et dans les continents assujettis à l’impérialisme.
Enfin en créant la première République prolétarienne le bolchevisme a fait surgir un nouveau domaine de réflexions devant la pensée marxiste : celle‑ci n’aura plus seulement polir tâche de s’interroger sur le monde capitaliste et sur ses contradictions de classes. Il lui faudra penser en termes concrets la politique révolutionnaire après le renversement de la bourgeoisie, puis se prononcer sur la signification historique du système social qui, en Russie, s’est progressivement dégagé des décombres de l’ancien régime
LES CONTROVERSES SUR L’AVENIR DE LA RUSSIE
La tâche de comprendre la réalité russe en fonction du marxisme apparaissait exceptionnellement malaisée, tant la différence était grande entre l’Europe capitaliste et cet empire à demi asiatique, où quelques centres industriels récents restaient noyés dans une immense population rurale vivant encore dans le cadre du mir. Dans quelle mesure le développement historique de la Russie pouvait‑il être pensé dans le cadre d’un système qui fait de la contradiction du Capital et du Travail le principe central du mouvement de la société ?
Les populistes le contestaient. Tirant argument des particularités sociales qui naissaient du retard du pays, ils soutenaient que la Russie resterait une exception et, qu’en raison même de la conservation des formes de vie et des mentalités communautaires, elle parviendrait au socialisme bien avant l’Europe. Sans accepter les perspectives populistes d’un socialisme paysan, Marx et Engels avaient, de leur côté, envisagé la possibilité pour la Russie d’atteindre le socialisme sans reproduire les étapes du développement capitaliste si la domination du capital était renversée suffisamment tôt par le prolétariat des pays avancés.
Négligeant cette manière de relier le socialisme russe au socialisme occidental, les premiers marxistes russes, Plekhanov en particulier, qui étaient fortement influencés par le kautskysme, tranchaient le problème en affirmant que la Russie comme les autres pays n’aborderait le socialisme qu’au terme d’un long développement du capitalisme. S’attaquant aux populistes qui se livraient au terrorisme dans l’espoir d’éveiller les masses rurales par des actes exemplaires, Plekhanov expliquait en 1884, que l’histoire n’était pas faite par des minorités héroïques mais par des classes en lutte et que le prolétariat, par sa situation dans la production moderne et sa concentration, avait un potentiel révolutionnaire beaucoup plus élevé que la paysannerie que d’ailleurs le capitalisme décomposerait.
S’appuyant sur Sismondi ou même sur des interprétations sous‑consommationistes de Marx, les populistes récusaient cette perspective. Le capitalisme russe, expliquait en particulier Nikolayon en 1897, ne tarderait pas à subir un blocage : il se trouverait vite en face d’un marché intérieur trop étroit et il se développerait trop tard pour pouvoir percer sur les marchés extérieurs déjà occupés par les pays avancés. Les marxistes ripostaient en montrant que le capitalisme ne se heurte à aucune impossibilité de réaliser en totalité la plus‑value sur le marché national. Cependant leurs arguments et leurs représentations de l’avenir du. capitalisme russe ne concordaient pas toujours. Strouvé, pour montrer que toute la plus‑value est réalisable, avait recours à l’existence de « tierces‑personnes » –fonctionnaires, membres des professions libérales… qui, dans toutes les sociétés capitalîstés, participent à la consommation tout en n’étant ni des capitalistes ni des ouvriers. Boulgakov concevait au contraire l’économie capitaliste comme un circuit fermé au sein duquel l’essor de la production crée son propre marché : la décroissance relative de l’importance de la consommation des capitalistes et des travailleurs ne sont que des phénomènes mineurs parce que le capitalisme fonctionne en élargissant la section de l’économie qui fabrique des moyens de production, faisant par là apparaître une demande additionnelle de moyens de consommation et par voie de conséquence, une nouvelle demande d’équipements dans la section qui produit les moyens de consommation. Ayant ainsi démontré, chacun à sa manière, que le marché intérieur suffit au développement du capitalisme, Strouvé et Boulgakov pouvaient également rejeter les vues des populistes sur la nécessité des marchés extérieurs.
Pour Lénine comme pour Boulgakov, la croissance du marché nécessaire au fonctionnement du capitalisme était donnée par le développement du capitalisme lui‑même. Aussitôt que les rapports capitalistes ont émergé de la décomposition de l’économie naturelle par la production marchande, expliquait‑il, l’expansion du marché nécessaire à l’essor du capitaliste se réalise du seul fait que la production devient essentiellement « une production pour la production » et qu’il existe donc un décalage entre les vitesses avec laquelle augmente la consommation en moyens de production et en moyens de consommation. Mais, à la différence de Tougan‑Baranovski, qui construira abstraitement un système au sein duquel, par suite d’une élévation constante de la composition organique du capital, la reproduction élargie reste toujours possible même si la consommation des personnes reste stationnaire ou diminue, Lénine qui se place sur le terrain du capitalisme concret, ne croit pas possible de détacher complètement la production de la consommation. La production de capital constant n’est pas une fin en elle‑même. Elle n’est réalisée que dans la mesure où il faut davantage d’outillage pour fabriquer des moyens de consommation et, en dernière analyse, elle trouve ses bruites dans l’étroitesse. de la consommation. Mais il ne résulte pas de là que le capitalisme russe soit destiné à subir un blocage. Les limitations que l’étroitesse de la consommation oppose à l’essor des forces productives ne sont que relatives et trouvent périodiquement, à la fois leur expression et leur solution, dans les crises cycliques qui, cependant, sont autant de signes prémonitoires qu’à réchelle historique, les rapports capitalistes de production deviendront une entrave croissante au plein développement des forces productives.
Ayant ainsi rejeté les conceptions sous‑consommationistes des populistes, Lénine comme les autres marxistes élimine les marchés extérieurs comme éléments nécessaires à la reproduction élargie mais il ne partage pas cependant les vues de Strouvé et de Boulgakov sur la possibilité d’un capitalisme autarcique. C’est que, explique‑t‑il, le capitalisme étant régi par les lois du marché, l’équilibre entre les différentes branches de la production qui se servent les unes aux autres de débouchés ne se réalise que comme la moyenne d’une succession d’oscillations et, périodiquement, les inégalités de développement qui apparaissent dans l’appareil productif contraignent les industries les plus avancées qui sont alors menacées de crise, à rechercher des marchés étrangers. Dès cette époque Lénine tendait à se représenter le capitalisme international comme une totalité.
Mais déjà, dans les dernières années du XIXe siècle, les progrès industriels de la Russie, bientôt suivis de puissantes vagues de grèves, tendaient à reléguer vers le passé les controverses avec les populistes : c’est le problème de la construction d’un parti ouvrier qui devenait le centre des préoccupations Les groupes marxistes n’avaient guère Jusque à réussi à s’implanter que parmi .es intellectuels et le P.O.S.D.R. (Parti ouvrier social‑démocrate de Russie), créé en 1898, était resté un ensemble mal relié d’organismes légaux ou clandestins dont l’influence sur le prolétariat demeurait épiderinique. Les « économistes » en avaient conclu que l’entreprise de fonder un parti ouvrier était prématurée : les ouvriers russes, expliquaient‑ils, ne sont préoccupés que de luttes économiques élémentaires et c’est seulement lorsqu’ils auront compris, par leur propre expérience, que même les luttes revendicatives exigent, pour pouvoir être organisées, des libertés, qu’il leur sera possible de s’intégrer à un véritable parti social‑démocrate capable de lutter pour la conquête et l’élargissement de la démocratie. Le groupe rassemblé autour de l’Iskra dénonçait les « économistes.» comme des attentistes qui, sous prétexte de laisser le prolétariat agir sur son terrain de classe – la lutte contre le patronat – tournaient le dos à la tâche de lui faire prendre conscience des objectifs globaux de sa lutte. D’ailleurs, dans les premières années du XXe siècle, une forte récession durcissait et transformait les luttes : les grèves aboutissaient à de fréquentes collisions avec les forces de l’ordre et se « politisaient » d’elles‑mêmes. Il devenait évident qu’il faudrait une organisation d’un tout autre type que le P.O.S.D.R. pour aborder la nouvelle étape. C’est dans ces conditions que Lénine, entre 1900 et 1902, commença à élaborer sa conception du Parti révolutionnaire.
La classe ouvrière, exténuée de labeur, expropriée de la culture et soumise au poids écrasant des idéologies dominantes ne pouvait par elle‑même, assurait alors Lénine, parvenir qu’à une conscience élémentaire, « trade‑unioniste », de son antagonisme avec le Capital, de sorte que le projet socialiste ne pouvait pas prendre corps sans la médiation d’une avant‑garde dirigée par des intellectuels parvenus à la connaissance de l’ensemble des lois de développement historique et de la lutte des classes. Marqué par l’idée, empruntée à Kautsky, que lé marxisme est « la science du développement social » et, sans doute aussi, influencé par le décalage qui existait alors entre le comportement effectif des ouvriers russes et le rôle historique que le marxisme assigne au prolétariat, Lénine avait argumenté comme s’il tenait que l’opposition entre le savoir du Parti et le non‑savoir de la classe implique, entre eux, une séparation conduisant à situer leur relation réciproque sur le plan d’une subordination totale de l’une à l’autre. Pourtant, il n’est pas exact que Lénine ait conçu le Parti comme le dépositaire d’un savoir déjà donné et achevé, l’autorisant à imposer aux masses un comportement conforme à des schémas établis a priori, en déduction d’une connaissance atteinte séparément de la pratique du prolétariat. Il insistera au contraire constamment sur la nécessité pour le Parti d’être étroitement lié aux masses, attentif à l’évolution de leurs formes de lutte et ouvert sur la compréhension des innovations que leur pratique peut faire surgir : ainsi en ira‑t‑il lorsqu’il reconnaîtra les Soviets comme une création spontanée et imprévue du prolétariat. Mais en même temps, et Lénine avait d’abord très fortement mis l’accent sur cet aspect, le Parti ne pouvait pas être un simple reflet de la classe mais un organisme au plus haut point actif qui, précédant les masses d’un pas, leur découvrirait le sens de leurs propres actions, leur ferait apparaître de quelle manière elles s’intègrent à la lutte pour le socialisme et leur montrerait par quelles voies celle‑ci doit passer. Le Parti était ainsi conçu comme étant, à la fois, le lieu où les luttes partielles, multiformes et désordonnées du prolétariat sont pensées en fonction d’une vision d’ensemble de la situation et de sa dynamique et le centre, d’où partent les mots d’ordre capables d’amplifier et de coordonner les luttes, en fonction d’une vue claire des objectifs à atteindre. C’est parce qu’il lui assignait, par là, les tâches d’un état‑major que Lénine insistait sur la nécessité pour le Parti d’être organisé à l’image d’une formation combattante qui devrait être capable d’entraîner les masses, au moment voulu, à exécuter les mouvements tactiques et stratégiques nécessaires à la victoire.
Ces conceptions que Lénine avait, dans le souci d’en finir au plus vite avec l’état d’anarchie paralysante où se débattait le Parti, volontairement formulée de manière exagérée et tranchante – il le reconnaîtra plus tard soulevèrent de vives oppositions parmi les Iskristes et dès 1903 la scission entre bolcheviks et mencheviks se dessinait. Ces derniers, pour lesquels le Parti russe devait être construit à l’image des partis sociaux‑démocrates occidentaux, accusèrent Lénine de rompre avec le marxisme – il proposait des modèles d’organisation et d’action empruntés au jacobinisme ou au blanquisme qui seraient foncièrement inadaptés à la lutte pour le socialisme. Trotsky dénonçait Lénine comme un radical‑bourgeois qui, plein de méfiance pour la classe ouvrière, se préparait à instituer la dictature d’une minorité jacobine et à endosser le rôle terroriste d’un Robespierre. Rosa Luxembourg partageait ces appréhensions : elle redoutait que l’opposition trop tranchée que Lénine instituait entre la classe et le Parti ne conduise celui‑ci à se fermer aux innovations que produirait la pratique prolétarienne et à se penser comme détenteur de certitudes qu’il aurait tendance à imposer au prolétariat.
A partir de 1904 cependant, ces polémiques sur la structure et le rôle du Parti s’aggravaient et prenaient toutes leurs dimensions par rapport aux divergences qui surgissaient maintenant à propos de la révolution dont les premiers symptômes se multipliaient.
Continuant à penser dans la lancée des luttes contre le populisme, Plekhanov et les mencheviks tendaient à minimiser les particularités de la révolution russe. Celle‑ci, ayant pour tâche de détruire les survivances du despotisme asiatique, d’ouvrir la voie à un complet épanouissement du capitalisme et de mettre à la tête du pays une forme démocratique de gouvernement, porterait, avec le soutien du prolétariat, la bourgeoisie au pouvoir et c’est seulement plus tard, lorsque le capitalisme russe aurait terminé son développement, que le problème du socialisme se poserait de la même manière que dans les pays occidentaux. Lénine en effet, contestait que la bourgeoisie russe soit capable de réaliser jusqu’au bout ses tâches révolutionnaires et, en particulier, de résoudre la question agraire, car en raison même de l’importance de ses investissements fonciers, elle se trouvait liée par de puissants intérêts au maintien du régime de propriété existant dans les campagnes. Pour lui, la perspective d’un reflux de l’ensemble des couches possédantes vers la recherche d’un compromis avec le régime tsariste était, par avance, inscrite dans la logique des antagonismes sociaux. Dès que les soulèvements populaires nécessaires pour abattre le tsarisme, prendraient de l’ampleur, les couches possédantes feraient défection, laissant inachevée la liquidation de l’ancien régime. Il fallait donc, en prévision du faible potentiel révolutionnaire que manifesterait la bourgeoisie, substituer à la tactique menchevik du soutien ouvrier de la politique bourgeoise, une tactique de la coopération révolutionnaire du prolétariat et des paysans. Bien que bourgeoise par ses objectifs, la révolution russe se développerait suivant une voie originale : elle serait accomplie par les ouvriers et les paysans et aboutirait à l’établissement d’une « dictature démocratique du prolétariat et de la paysannerie ». Lénine entendait par là, un régime qui, sans attaquer les bases du capitalisme encore insuffisamment développé en Russie, détruirait toutes les survivances politiques et sociales du passé et imposerait aux classes possédantes, au besoin par la force, un ensemble de transformations permettant immédiatement au prolétariat d’occuper des positions de force en vue de la lutte ultérieure contre le capitalisme. Lénine ne précisait pas quelle pourrait être la durée de ce régime hybride, mais il était persuadé que la victoire révolutionnaire des ouvriers et des paysans russes donnerait une puissante impulsion à la lutte du prolétariat européen pour le socialisme et que, en retour, des victoires socialistes en Occident, abrégeraient en Russie la période de « dictature démocratique ».
Seuls, Parvus et Trotsky avaient, dès cette époque, affirmé que la révolution russe, par son propre dynamisme, irait au‑delà de l’étape proprement bourgeoise. Parvus avait en effet montré qu’en raison des particularités de son développement historique, la société russe présentait deux traits originaux d’une importance décisive : tandis que, dans les campagnes, il n’existait pas de classe de petits propriétaires ruraux capables de fournir une base à l’ordre social bourgeois, dans les villes, un prolétariat de type moderne avait grandi, avant même que les couches petites‑bourgeoises aient eu le temps de se développer pleinement. Parvus en avait conclu que le prolétariat jouerait le rôle autrefois assumé par la petite bourgeoisie urbaine dans le cours des révolutions et que, compte tenu de l’impuissance politique des masses paysannes archaïques, il émergerait rapidement comme la force dirigeante de la révolution russe qui aboutirait à l’établissement d’un « gouvernement ouvrier de *type australien ». C’est sur ce dernier point que Trotsky se séparait de Parvus. Il ne croyait pas que la « démocratie russe », surgie « d’un grandiose soulèvement révolutionnaire », puisse se stabiliser sur la base d’un gouvernement ouvrier à la manière australienne qui lui, était né de simples compétitions électorales et ne dépassait pas les limites d’un réformisme dans le cadre bourgeois. Il estimait que les formidables dynamismes de la lutte des masses russes entraîneraient la révolution jusqu’à la dictature du prolétariat, ébranleraient toute l’Europe et y déclencheraient un ensemble d’assauts contre le Capital. Ainsi, la révolution russe réaliserait jusqu’au bout les tâches démocratiques bourgeoises et notamment dans les campagnes, pour aborder aussitôt le processus de transition vers le socialisme en même temps que le prolétariat international. Elle triompherait avec lui ou serait écrasée. Sous le vocable, emprunté à Marx, de « révolution permanente » Trotsky avait déjà formulé l’essentiel des conceptions qu’il défendra jusqu’au bout.
L’IMPÉRIALISME ET LA RÉVOLUTION MONDIALE
Ainsi tandis que le menchevisme se borne à projeter sur la réalité russe des schémas empruntés au kautskysme, le bolchevisme et plus encore la théorie de Trotsky apparaissent comme des adaptations originales du marxisme aux particularités de la situation russe.
Mais ce, n’est là pourtant qu’une étape. A la veille de la révolution de 1905, léninisme et trotskysme ne sont encore que des variantes russes du radicalisme au sein de la 2eInternationale. En 1917 le bolchevisme s’affirme comme la théorie de la révolution mondiale à l’époque impérialiste. En 1919 avec la fondation de la 3e Internationale il est déjà largement reconnu comme tel.
Cette mondialisation de la vision révolutionnaire des bolcheviks s’est opérée, de proche en proche, à partir de 1906 Lénine, réfléchissant sur les causes de la défaite de 1905, arrive à la conclusion que pour vaincre, le parti du prolétariat devra se ménager un soutien plus massif de toutes les forces qui s’opposent au tsarisme. C’est pourquoi, malgré le scandale que suscitent ses prises de position en faveur de revendications « bourgeoises », préoccupé avant tout de stratégie, il oriente en 1906 son parti vers une politique de soutien des aspirations paysannes au partage des terres et, à partir de 1912, vers la reconnaissance du droit des peuples allogènes de l’empire russe à faire sécession. Pendant la même période il étend à l’Asie ses vues sur la possibilité de relier les luttes nationales et paysannes à celles du prolétariat : la peuples de l’Orient qui s’éveillent au nationalisme, même si leurs mouvements sont encore dirigés par la bourgeoisie autochtone, affrontent le même adversaire capitaliste que le prolétariat d’Europe et constituent une énorme réserve de potentiel révolutionnaire. L’effondrement de l’Internationale en 1914 conduit sa pensée un peu plus loin : expliquant la « trahison » des socialistes européens par la formation d’une « aristocratie du travail » – dès 1907 il a formulé cette idée empruntée à Engels – tirant bénéfice de l’exploitation impérialiste, il lui apparaît que les révolutions des peuples assujettis ne mut pas seulement intégrées à une lutte unique contre le capitalisme mondial mais qu’elles sont de nature a relever le potentiel révolutionnaire de l’Ouest.
En 1916 et 1917, avec les études de Boukharine et de Lénine sur l’impérialisme, ces réflexions s’intègrent dans un système cohérent. Bien qu’ils aient construit leur théorie en utilisant des vues déjà largement répandues parmi les marxistes, les bolcheviks, Lénine surtout, ont renouvelé la question de l’impérialisme, parce qu’ils l’ont abordée en dialecticiens et en stratèges de la lutte révolutionnaire. Pour eux, l’impérialisme est avant tout une nouvelle phase du capitalisme qui a surgi comme résultat du changement qualitatif qui était déjà en voie de développement dans le fonctionnement du système tel que Marx l’avait décrit : en se réalisant, les lois de la concurrence ont abouti à leur négation partielle et les traits distinctifs de l’impérialisme – lutte pour les surprofits, surcapitalisation, exportation des capitaux, etc. – tirent leur origine des mutations structurelles et fonctionnelles qui se sont accomplies au sein du capitalisme avec la formation des monopoles. L’impérialisme est un moment dans la dialectique générale du capitalisme et la tâche des marxistes est de le comprendre comme tel, en mettant à jour les lois spécifiques du fonctionnement et du mouvement d’un système devenu mondial et centré sur quelques pays avancés.
Dès lors, Boukharine et Lénine ont produit une représentation de l’impérialisme quine coïncide avec aucune de celles de leurs devanciers. S’ils rejettent les perspectives kautskystes d’un retour à une politique pacifique qu’ils tiennent pour une simple utopie réactionnaire, ils se séparent aussi de Hilferding et, implicitement de Rosa Luxembourg, en ce qui concerne l’avenir du monde impérialiste. Lénine, qui avait soutenu contre les populistes que le développement du capitalisme ne se heurte à aucun obstacle naissant de ses structures constitutives, applique le même point de vue à l’impérialisme : les contradictions qui resurgiront au sein du système devenu mondial ne fondent ni la perspective d’un ralentissement et d’un blocage général de la croissance économique, ni celle d’une autodestruction du régime. Aussi longtemps que la lutte des classes ne mettra pas un terme à l’existence de la société d’exploitation, celle‑ci sera capable de se transformer pour échapper aux effets de ses contradictions. Dès cette époque, Boukharine et Lénine évoquent le passage au capitalisme d’Etat comme une des formes possibles d’adaptation du capitalisme de la phase impérialiste. Cependant, si le système n’est pas voué à s’effondrer de lui‑même indépendamment de la pratique révolutionnaire, il n’est pas vrai qu’il puisse automatiquement parvenir vers une phase ultra‑impérialiste de développement pacifique et équilibré. Il existe, certes, une tendance à la concentration internationale du Capital qui ouvre, en principe, la perspective de la formation d’un seul « trust mondial » dominant toute l’économie. Mais le développement dans cette direction, contredit par la concentration des capitaux autour des pôles constitués par les états nationaux et les flambées de luttes concurrentielles qui remettent en question les positions acquises par les cartels et les trusts, s’opère avec une telle lenteur que l’ultra‑impérialisme n’est qu’une possibilité lointaine et abstraite. Le monde impérialiste réel est, dès le présent, dominé par un ensemble de contradictions qui accumulent en lui-même un potentiel révolutionnaire sans précédent, de sorte que les perspectives d’une destruction du système par la lutte des classes sont plus vraisemblables que celles de l’ultra‑impérialisme.
Le capitalisme n’a en effet trouvé dans l’expansion mondiale une issue à la surcapitalisation que pour la voir resurgir avec davantage d’ampleur et, dès lors que le partage du monde était terminé, les états impérialistes ont été entraînés dans la lutte par les armes pour le repartage de leurs « chasses gardées » respectives. Tel est le sens du conflit de 1914. Les masses européennes ont alors appris à leurs dépens quel était le véritable visage du capitalisme impérialiste : tueries sans précédents, redoublement d’oppression, tendances à la militarisation de la vie sociale, hausse du coût de la vie, restrictions alimentaires, etc. Transformés en « esclaves blancs » de l’mpérialisme, les ouvriers d’Europe sont acculés à une situation intolérable d’où ils ne peuvent sortir que par la lutte révolutionnaire. En irait‑il différemment d’ailleurs, que de nouvelles situations révolutionnaires ne tarderaient pas à resurgir car déjà d’autres guerres sont en vue : étouffant dans des espaces trop étroits, les pays vaincus n’auront d’autre choix que de mobiliser toutes leurs ressources pour préparer la revanche et échapper à la ruine de leur économie, ce qui ne pourra pas se faire sans que le prolétariat soit, au préalable, plus lourdement encore assujetti à l’Etat capitaliste. Ainsi, de toute manière, la période du développement pacifique est terminée. Le capitalisme voué aux guerres et à un militarisme qui tendra à envahir toute la société ne pourra qu’appesantir sa domination sur le travail : ruinant ainsi lui‑même les illusions sur le progrès pacifique et graduel et, avec elles, l’influence de la social‑démocratie, il suscitera les ripostes toujours plus amples du prolétariat. En même temps que l’époque des guerres impérialistes a commencé celle des combats de classes acharnés.
Mais dans ces combats, le prolétariat des pays avancés n’est plus seul. A l’époque de l’impérialisme les luttes nationales des peuples coloniaux et semi‑coloniaux prennent un sens et un contenu nouveau : elles frappent l’impérialisme sur ses arrières, et si elles sont victorieuses, rétrécissent les territoires où les monopoles prélèvent les sur profits grâce auxquels ils corrompent « l’aristocratie ouvrière ». Elles deviennent un puissant adjuvant de la lutte pour le socialisme en Europe. Bien plus, elles peuvent elles‑mêmes se transformer en révolution socialiste. A partir d’avril 1917 en effet, Lénine a abandonné sa théorie de la « dictature démocratique » pour aligner le parti bolchevik sur des positions foncièrement analogues à celles de Trotsky : la révolution russe se transformera en révolution socialiste et se développera en conjonction avec les révolutions ouvrières d’Europe que la crise sanglante de la guerre et l’exemple des Russes ne tarderont pas à faire surgir. Mais dès lors, la Russie ne peut plus être tenue pour une exception, entre l’Occident et l’Orient. Dans la plupart des pays coloniaux et semi‑coloniaux existent des structures sociales et une dynamique révolutionnaire analogues à celle de la Russie : la bourgeoisie socialement atrophiée par la concurrence impérialiste, liée au capital étranger et mal différenciée des couches précapitalistes qui exploitent la paysannerie, est, tout autant qu’en Russie, incapable d’accomplir les tâches nationales et démocratiques agraires de la révolution. A défaut de la bourgeoisie impotente c’est l’alliance du prolétariat et de la paysannerie qui exécutera le programme national et agraire, dans le cadre d’une révolution qui, au cours de son accomplissement, se dépassera en révolution prolétarienne. Ainsi le lien mécanique que les « marxistes orthodoxes » avaient établi entre le plein développement du capitalisme et la révolution socialiste se trouve rompu. Dans le contexte des contradictions mondiales de l’impérialisme, les pays attardés ne reproduiront pas, avec un simple décalage dans le temps, les mêmes étapes de développement que les pays capitalistes avancés : sous l’impulsion des contradictions mêmes qui déterminent leur retard, ils avanceront par bonds.
Les bolcheviks n’en ont pas pour autant admis que les pays attardés et la Russie, elle‑même, puissent jouer un rôle pionnier dans la période de transition vers le socialisme. Persuadés, comme Marx, qu’il n’est pas possible de « socialiser la misère », ils considéraient que si la Russie avait été, en raison de son retard, le « maillon le plus faible» où «la chaîne de l’impérialisme » avait pu être rompue en premier lieu, ce même retard lui interdisait d’avancer vers le socialisme séparément des révolutions occidentales. C’est en Occident, là où se trouvaient, en même temps que les grandes concentrations prolétariennes, les puissants appareils de production nécessaires au passage à un ordre social plus élevé, que se situait nécessairement le front principal et décisif de la lutte pour le socialisme. Même en 1920, lorsque les retards de la révolution européenne conduisirent le Komintern à tourner son attention vers les luttes des peuples de l’Orient et des colonies, cette certitude ne fut pas perdue de vue. AU 2e Congrès de l’I.C. (Internationale Communiste), Roy put alors soutenir, en poussant à l’extrême le thème des surprofits coloniaux comme base d’une aristocratie ouvrière conservatrice, que les classes ouvrières de l’Europe ne pourraient pas briser la domination du capital avant que les révolutions coloniales. n’aient tari à leur source les surprofits corrupteurs. Mais, pour les dirigeants bolcheviks, les révolutions asiatiques, même si elles aboutissaient à la formation de pouvoirs soviétiques, pouvaient seulement contribuer, en affaiblissant les Etats impérialistes sur leurs arrières par des attaques à contrefront , à faciliter la tâche des révolutionnaires occidentaux. C’est dans les pays industriels avancés que se trouvait placée « la clef d’une libération socialiste de l’humanité ».
Leurs conceptions de l’impérialisme, leur vision mondiale de la lutte révolutionnaire, leurs convictions que l’époque du développement pacifique était terminé et que les affrontements décisifs entre la révolution et la contre‑révolution se produiraient, à l’échelle internationale, dans des délais historiques très brefs, avaient cependant entraîné les bolcheviks à rompre radicalement avec les conceptions de la tâche révolutionnaire qui avaient prévalu dans la 2e Internationale.
Dans les Partis sociaux‑démocrates, toute la manière de penser la politique se fondait sur la présomption que l’évolution sociale à long terme conduisait à l’affrontement d’un prolétariat de plus en plus nombreux et d’une minorité capitaliste de plus en plus réduite, de sorte que la victoire du socialisme était en quelque sorte donnée par avance. Mais, à partir de leur analyse de l’impérialisme, les bolcheviks avaient constaté que le fonctionnement du système ne conduisait pas à une unicité ni même à une homogénéité croissante des forces révolutionnaires. Le développement du capitalisme, après avoir d’abord unifié le prolétariat des pays avancés, y avait fait surgir, à l’époque impérialiste, un clivage nouveau concrétisé par la séparation des masses et de l’aristocratie ouvrière. Quant aux forces révolutionnaires des pays attardés, elles étaient et resteraient, en raison même des lenteurs du développement, foncièrement hétérogènes : elles incluaient à côté du prolétariat minoritaire, une paysannerie déjà différenciée par l’économie marchande et toute la gamme des petits producteurs urbains. La tâche de faire converger vers un même but révolutionnaire toutes ces forces disparates posait des problèmes tactiques et stratégiques que la 2e Internationale n’avait même pas soupçonnés.
Par ailleurs, la configuration du monde à abattre avait changé. Le prolétariat se trouvait désormais face à un État capitaliste qui se cuirassait de forces contre‑révolutionnaires et n’hésiterait pas devant l’ampleur de la menace prolétarienne, à liquider toutes les conditions d’une forme pacifique de la lutte des classes. On pouvait encore utiliser les campagnes électorales pour développer des thèmes d’agitation. Mais les luttes principales se situaient désormais sur un autre terrain. C’est par la contestation de l’ordre et du pouvoir capitaliste dans les ateliers, les usines, les casernes et les rues, par la grève de masse qui, à la limite, culmineraient en insurrection que le prolétariat serait amené à rompre avec les conceptions social‑démocrates de la politique, à découvrir dans l’Etat non pas un organisme neutre, mais l’instrument central de la violence répressive du capital –et à se donner les organisations nécessaires pour affronter et briser cet instrument. En raison même des transformations subies par l’État à l’époque impérialiste, la lutte des classes devait nécessairement prendre la forme d’une guerre des classes.
Mais, dès lors que la lutte pour le socialisme était conçue comme une guerre au cours de laquelle les forces révolutionnaires devraient affronter, à l’échelle mondiale, un adversaire supérieurement armé alors qu’elles ne possédaient elles‑mêmes aucune unité donnée par avance, le problème de l’organisation et de la direction du mouvement prenait une importance nouvelle et décisive. La révolution, pensaient les bolcheviks, ne pourrait vaincre que si elle surclassait l’adversaire sur le plan de l’organisation et des manœuvres tactiques et stratégiques d’envergure internationale, ce que le prolétariat et les forces révolutionnaires des pays vassalisés ne pouvaient certainement pas faire sans la médiation d’un Parti d’avant‑garde. Ainsi, le type d’organisation que Lénine avait d’abord conçu pour coordonner l’action des ouvriers et des paysans russes et briser le despotisme tsariste devenait, en raison des conditions spécifiques de la lutte des classes dans la phase impérialiste, universellement valable. A une époque où les luttes de la révolution et de la contre‑révolution répercutaient leurs effets d’un bout à l’autre de l’univers, l’Internationale ne pouvait plus être une simple juxtaposition de partis nationaux autonomes. Dans la bataille internationale qui était engagée, les partis communistes devaient se considérer comme les différents corps d’une même armée qui combattaient sous la direction d’un « état‑major mondial de la Révolution ».
Dès 1917, les bolcheviks s’étaient par ailleurs complètement séparés des partis de la 2e Internationale en ce qui concerne le programme du socialisme et le rôle de l’État.
Rappelant que tout Etat, fut‑il une république parlementaire, est l’instrument de la dictature des classes possédantes sur les travailleurs, Lénine esquissait en 1917 les traits fondamentaux de l’État prolétarien. Après la conquête du pouvoir, le prolétariat ne peut pas, affirmait‑il utiliser l’appareil d’État tel qu’il a été modelé par ses fonctions dans la société d’exploitation. Il doit, au contraire, le détruire de fond en comble pour y substituer un nouveau type d’État qui sera caractérisé par l’abolition de tout appareil permanent, privilégié et séparé de la population laborieuse. Comme tel, l’État prolétarien sera à la fois une dictature opprimant les anciens exploiteurs et la forme la plus extrême de la démocratie qui, s’incarnant dans le pouvoir des soviets, permettra à tous les travailleurs de s’initier à la tâche de diriger la vie publique et la production.
Lénine en effet, rejette l’idée, avancée en 1902 par Kautsky, selon laquelle la suppression de l’organisation bureaucratique étant impossible dans la grande production, les ouvriers devraient se borner à la contrôler à l’aide d’une « sorte de Parlement ». Pour lui, au contraire, l’évolution du capitalisme a réduit les tâches de direction de l’économie à des opérations à la portée de tous et la dictature du prolétariat ne prendra tout son sens que si elle parvient à mettre en place « l’autogouvernement des producteurs». En même temps que l’appareil de direction politique de la société, c’est l’appareil de gestion de l’économie qui devra se résorber dans la démocratie directe et totale des conseils annonçant le dépérissement de l’État.
UN PROBLÈME IMPRÉVU : LA BUREAUCRATISATION
Ce sont cependant là des perspectives générales et à long terme. L’économie russe où prédominent les entreprises archaïques et dispersées ne peut pas atteindre sans transition au niveau du socialisme. En 1917 les bolcheviks se proposent seulement d’établir, sous le contrôle des ouvriers, un capitalisme d’État qui permettra aux travailleurs d’apprendre à gérer l’économie en attendant que la révolution en Europe donne au socialisme des bases de départ plus élevées.
Mais, l’autogouvernement des producteurs ne parvient pas à se réaliser. Quelles qu’en soient les raisons, on a, au contraire, assisté à travers la guerre civile à un dépérissement de la démocratie ouvrière et au développement d’un appareil, de plus en plus centralisé et distinct du prolétariat, qui a attiré à lui la totalité du pouvoir politique, monopolisé la direction de l’économie et rétabli, dans les entreprises, une hiérarchie et une discipline du travail imposée par en haut. Dès lors a surgi un problème complètement imprévu par la théorie marxiste et qui va être au centre des déchirements du bolchevisme : celui de la bureaucratisation de l’État prolétarien.
Cette évolution du régime soviétique suscite, très tôt, des inquiétudes et des oppositions parmi les communistes russes eux‑mêmes qui se demandent si la révolution n’est pas en train de dévier bien loin de ses objectifs.
Dès 1918 les « communistes de gauche » – Boukharine, Radek Ossinski, Ouritsky, etc. dénoncent les mesures qui, mettant un terme aux tentatives de gestion ouvrière de la production, rétablissent dans les usines une autorité directoriale souvent confiée à des spécialistes bourgeois. En même temps, ils critiquent le rôle croissant des commissaires dans le fonctionnement des soviets et voient, dans ce déclin de la démocratie directe, le signe que le pouvoir est en train de devenir une force étrangère au prolétariat qui étouffera ses initiatives et ruinera ses capacités d’organisation. Pour eux, le socialisme ne peut naître que des initiatives et des capacités gestionnaires du prolétariat et, dès le mois d’avril 1918 Ossinski soulignera le risque que court le régime d’évoluer non , pas vers le socialisme mais vers un capitalisme d’État qui se stabilisera.
En 1919 les efforts de Trotsky pour créer une force militaire capable de surclasser les armées blanches suscite me « opposition militaire » qui dénonce le caractère mm prolétarien du type d’armée et de la stratégie que parvient cependant à imposer Trotsky. En 1920, les combattaient sous la direction d’un « état‑major mondial de la Révolution » inquiétudes que suscitent l’émergence d’un appareil qui achève de se substituer aux soviets et se met à administrer la Russie à la manière d’un corps de fonctionnaires centralisé, réapparaissent au 10e Congrès du Parti. L’opposition, animée par Vladimir Smirnov, Sopranov, Ossinski, dénonce le centralisme bureaucratique» qui, après avoir étouffé la démocratie dans les Soviets, est en train de la ruiner à l’intérieur même du Parti et réclame, sans succès, un retour aux pratiques du centralisme démocratique ainsi que l’établissement d’une direction collégiale à la tête des entreprises. Un an plus tard, l’opposition ouvrière, que dirigent Alexandra Kollontaï et Chliapnikov et qui sera défaite au 10e Congrès du Parti, en mars 1921. reprend, mais d’une manière plus systématique et plus radicale, une critique analogue de la politique des dirigeants bolcheviks. Pour l’opposition, le Parti, l’État les organes de gestion de l’économie sont déjà gravement altérés par la pénétration d’éléments étrangers au prolétariat et à l’esprit du socialisme – spécialistes, administrateurs professionnels, petits bourgeois empressés à faire carrière, etc. – et il est grand temps de réagir en remplaçant les fonctionnaires de métier par des militants liés aux masses qui seront moins portés vers cet esprit d’obéissance aveugle qui est en train de faire de l’État une pyramide de bureaucrates dociles et uniquement soucieux d’appliquer les décisions des sommets. Il faut aussi démocratiser la vie du Parti dans tous les domaines : rétablir l’éligibilité des responsables à tous les échelons, restituer aux organismes de base le droit de participer aux décisions et, enfin, permettre aux tendances et aux fractions de se constituer, à l’intérieur du Parti, et de s’exprimer librement. Surtout, l’opposition ouvrière propose de transformer de fond en comble les organismes qui gèrent les entreprises et l’économie. L’autorité d’un appareil de spécialistes et, souvent aussi de parvenus incompétents, apparaît à l’opposition comme une prolongation de l’autocratie du capital qui, réduisant les ouvriers au rang d’exécutants passifs, rendra impossible le développement vers le socialisme. C’est pourquoi les opposants réclament l’établissement de la gestion ouvrière par la participation des syndicats à « toutes les structures économiques du pays » et par la création de comités d’usines et d’ateliers qui permettront de faire élire par les producteurs eux‑mêmes, « l’administration économique de la République ouvrière ».
Tandis que les groupements oppositionnels sont ainsi parvenus, très rapidement, à l’idée que le renforcement des couches bureaucratiques fait peser des menaces décisives sur la révolution, les dirigeants bolcheviks restent, au contraire, persuadés que la situation de la Russie demeure ouverte sur un avenir socialiste. Cette conviction repose, avant tout, sur leur conception internationale de la lutte des classes et sur la relation qu’ils établissent entre le développement de l’Éteat ouvrier et celui de la révolution mondiale. Pour eux, la révolution d’octobre a, pour la première fois dans l’histoire, mis au service du prolétariat mondial les ressources d’un pays tout entier et c’est là une conquête d’un prix inestimable qui doit être défendue par tous les moyens. Les mesures que, sous l’emprise de la nécessité, il faut prendre pour assurer la survie du premier état prolétarien, même si elles paraissent contredire aux normes idéales d’un développement vers le socialisme, n’ont pas en elles‑mêmes de significations décisives. La centralisation du pouvoir et de la gestion de l’économie aux mains d’un appareil distinct des masses, la substitution d’une armée régulière aux gardes rouges, les concessions faites, avec la N.E.P. (Nouvelle politique économique) au commerce et à la production privée, ne constituent que des détours et des reculs tactiques qui prendront une signification positive à partir du moment où la révolution internationale permettra de dépasser la situation objective qui les rend pour le moment inévitables et d’appliquer le programme socialiste sur des bases plus élevées.
Ce raisonnement cependant, ne manquent pas de rétorquer les opposants, postule, qu’à travers détours et reculs, le Parti et l’Etat restent identiques à eux‑mêmes et continuent à être les dépositaires des intérêts historiques du prolétariat. Toutes les représentations que, dès l’origine de leur mouvement, les bolcheviks se sont faites des rapports de la classe et de l’avant‑garde les poussent vers cette conviction. C’est elle qui les a conduit à substituer la dictature du Parti à celle de la classe puis à supprimer à l’intérieur du Parti tendances et fractions sous prétexte qu’elles pourraient devenir « l’expression de tendances hostiles au prolétariat ». Au contraire pour les groupes d’opposants communistes qui après 1921 subsistent clandestinement – Vérité Ouvrière, Groupe Ouvrier, etc. – mais n’ont plus guère d’influence effective sur le prolétariat, les dirigeants bolcheviks mythifient le pouvoir et ne se rendent pas compte qu’ils ont eux-mêmes mis en place la tyrannie d’une « nouvelle bourgeoisie » de fonctionnaires privilégiés et exploiteurs qui, déjà, règne sur une classe ouvrière dépossédée de tous ses droits.
Sans croire que la situation soit déjà aussi désespérée, les bolcheviks ne se sont cependant pas aveuglés sur les risques de bureaucratisation et, en tout cas, ils ne les ont pas purement et simplement niés comme feront les staliniens. C’est parce qu’il définit l’État soviétique non pas comme un État ouvrier, mais comme un « État ouvrier et paysan à forte déformation bureaucratique » que Lénine refusera de suivre Trotsky dans sa politique de militarisation du travail et d’intégration des syndicats. « Le recours à la lutte gréviste dans un État où le pouvoir politique appartient au prolétariat peut être justifié uniquement par les déformations bureaucratiques de l’État prolétarien » écrit en 1922 Lénine qui recherche alors par quels moyens il serait possible de freiner la bureaucratisation
Il est certain pourtant que les dirigeants bolcheviks n’ont pas alors clairement aperçu les véritables racines de la bureaucratisation Lénine ne voyait dans la bureaucratisation qu’une résurgence du passé déterminée par le retard de la Russie et aggravée par les dévastations de la guerre civile : c’étaient l’isolement des petits producteurs retournant à l’autarcie, la rupture des échanges entre la ville et la campagne, l’énorme inculture de la Russie barbare qui produisaient la réapparition des « superstructures bureaucratiques » qu’il assimila parfois à une remontée du « despotisme asiatique ». C’est pourquoi, les mesures qui permettraient de restaurer l’économie et rendraient sa vigueur au prolétariat épuisé et en partie déclassé par l’arrêt des industries, lui paraissaient de nature, en attendant de nouvelles révolutions victorieuses, à contenir et même à infléchir la poussée. des forces bureaucratiques. Il ne semble pas avoir compris que le phénomène bureaucratique pouvait tirer sa vigueur, non pas seulement des archaïsmes de l’économie russe et de son délabrement passager, mais de la consolidation de ce capitalisme d’État organisé à la manière allemande, dans lequel il voyait un moyen transitoire d’arracher la Russie à sa barbarie.
Des conceptions voisines apparaissent chez Trotsky lorsqu’en 1923 il se rend compte de l’énorme distance qui s’est accusée entre le prolétariat et la machinerie du Parti et de l’État S’il se met alors à dénoncer la menace d’une dégénérescence bureaucratique du régime, il pense surtout à l’éventualité où le capital privé qui se développe de nouveau dans le cadre de la N.E.P., parviendrait à se subo