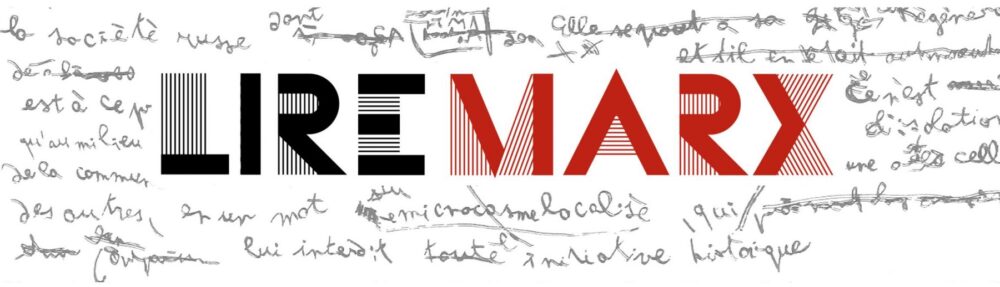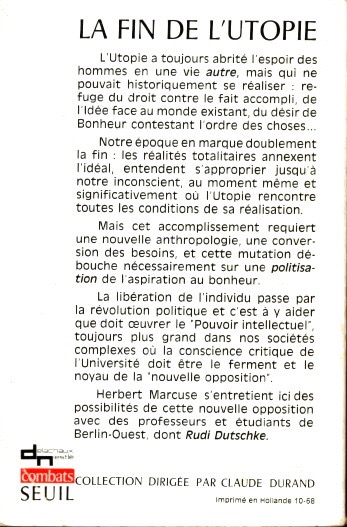 La fin de l’utopie, Herbert Marcuse, 1968
La fin de l’utopie, Herbert Marcuse, 1968
Le livre La fin de l’utopie est un compte rendu d’une série de conférences-débats tenue par Herbert Marcuse à l’Université libre de Berlin Ouest du 10 au 13 juillet 1967.
Une reproduction de l’allocution introductive du philosophe précède les échanges avec les personnes présentes. Parmi eux se trouve notamment Rudi Dutschke, le syndicaliste, mais de nombreuses autres personnalités de la gauche radicale, maoïste ou anti-parlementaire allemande. Il est étonnant de remarquer que l’un des ouvrages cités régulièrement dans les échanges est Le livre des abolitions de Karl Korsch qui vient tout juste de paraître aux éditions de l’Asymétrie.
Le constat érigé en problème par lequel s’ouvre et dans laquelle s’enracine tout l’ouvrage est celui de l’absence de désir d’utopie, désir dans lequel doit s’enraciner la rupture radicale de la société. C’est ainsi qu’aux yeux du philosophe émigré aux USA s’ouvre un chantier conséquent : celui d’identifier les causes de cette absence de désir, et les moyens à disposition pour le susciter.
Il ressort des questions qui sont posées bien souvent les points qui peuvent sembler problématiques à la lecture des thèses de Marcuse. On voit se dessiner les grandes tendances des militants de gauche alors en Allemagne de l’Ouest, mais aussi affleurer les limites de la pensée de Marcuse : son appareil conceptuel aussi puissant soit-il, ne dispose pas de distinctions précises permettant de comprendre ce qu’il se passe réellement, ainsi, il ne parvient pas à donner de définition précise de l’URSS, et l’on sent bien qu’il manque à ce niveau là de connaissances empiriques et factuelles. Ceci constitue l’un des travers des écoles philosophiques, aussi marxisantes soient-elles, dans les années 1970, et Marcuse ne s’en distingue pas sur ce point. Si les catégories marxiennes sont utilisées de manière assez typique pour l’époque, où le travail aliéné est la catégorie centrale notamment, des thèses fondamentales doivent retenir notre attention, pour la pertinence qu’elles ont encore pour notre compréhension de la société actuelle et des problématiques que nous rencontrons.
Marcuse nous propose une réflexion intéressante sur la violence. Il part d’une affirmation : « Rien n’est plus révoltant que le commandement d’amour « Ne hais pas ton ennemi » dans un monde où la haine est partout institutionnalisée (p. 33). ». Il poursuit : « On peut battre un adversaire on peut vaincre un adversaire sans lui trancher les oreilles, sans lui sectionner les jambes et sans le torturer » (ibid.). Autrement dit, brutalité et cruauté appartiennent à un système d’oppression que nous combattons, et dont un « combat de libération » n’a pas besoin. Le terme de combat de libération renvoie à une séquence historique marquée par un ensemble de luttes d’indépendance, dont nous percevons à quel point elles sont structurantes, quoique la notion de « combat de libération », et le concept de liberté sous-jacent soient éminemment problématiques.
Le lien « dialectique » que propose Marcuse entre technique et révolution doit retenir notre attention parce qu’il renferme une modalité d’argumentation valable face à un techno-scepticisme. Il affirme : « une des possibilités nouvelles signalant la différence qualitative entre la société libre et non libre consiste précisément à laisser affleurer le règne de la liberté dans le règne de la nécessité, à la manifester dans le travail et pas seulement au-delà du travail (nécessaire) » (p. 8). Marcuse défend la thèse que le problème consiste dans l’usage industriel de la science et de la technique, alors que ce développement renferme des possibilités d’émancipation véritables. Les tonalités déterministes qui ressortent de son argumentation ne permettent cependant pas de la rendre totalement utilisable.
Herbert Marcuse défend la nécessité d’une « nouvelle anthropologie » : ce serait une nouvelle dimension biologique de l’existence humaine qui passerait par la transformation des besoins. Par l’apparition, en le cultivant, d’un besoin « vital » de liberté. Le freudo-marxisme de Marcuse l’amène à enraciner l’absence de révolution dans l’absence d’existence de besoin de révolution, dans l’existence de besoins qui répondent à la société répressive et qui sont à sa mesure. La transformation des besoins est un lieu commun des années 1968 en Allemagne, qui n’est pas étranger à la lecture renouvelée dont a alors fait l’objet l’« Introduction à la Contribution à la critique de l’économie politique » de 1843, dans laquelle Marx formule notamment qu’« une révolution radicale ne peut être que la révolution des besoins radicaux ».
Une thèse qui ouvre le livre nous semble tout aussi pertinente qu’elle est encore aujourd’hui difficilement audible aux tenants d’un « matérialisme historique » classique : toute l’histoire jusqu’à ce jour n’est que la préhistoire de l’humanité. Nous n’intervenons pas de manière consciente sur la direction générale de la production et les rapports sociaux qui sont générés par le nexus rerum marchand se nouent et se structurent « dans notre dos ». Et quelque part le programme que propose Marcuse est celui d’ancrer durablement la maîtrise des finalités de la production dans le désir de « liberté », premier mis à mal par la société répressive qui génère sa disparition.
Enfin, il est intéressant de noter la manière dont Herbert Marcuse traite la thématique de l’éthique dans ses exposés et dans ses réponses aux participant.es. Il émet l’hypothèse qu’il est possible et nécessaire de faire appel à des « arguments humanitaires », entendu que l’autre possibilité serait d’en appeler à la « rationalité » pour justifier la nécessité de détruire le capitalisme. Il convient de préciser que Marcuse avance cette thématique surtout pour rendre raison de l’utilisation d’arguments éthiques lors de l’usage de la violence dans le processus révolutionnaire.
Dans l’ensemble, ce livre est une porte d’entrée privilégiée dans l’œuvre de Marcuse, qui lui confère la vivacité d’une pensée au contact avec d’autres personnes engagées sur différents fronts et tenants d’autres options tactiques et révolutionnaires. Il en ressort les travers typiques de l’approche du marxisme universitaire, tout en révélant les espoirs que nous savons aujourd’hui déçus qui étaient alors placés dans les mouvements « subversifs ». En effet, nous n’avons plus aucun doute aujourd’hui sur la capacité du capital à intégrer les éléments de subversion pour en faire des atouts lui permettant de rebondir dans des phases de désadéquation entre le salariat et la valorisation du capital. Il n’en reste pas moins que les questions fondamentales que pose Herbert Marcuse conservent, au fond, toute leur pertinence et leur actualité, et le vocabulaire freudo-marxiste a un côté exotique pétillant, tout en étant relativement accessible. Un tel livre permet de mettre en perspective les ouvrages qui proposent encore aujourd’hui des réflexions sur les stratégies anticapitalistes et leur rapport au désir, à la morale, à la violence, enfin, à l’utopie.
I. J.