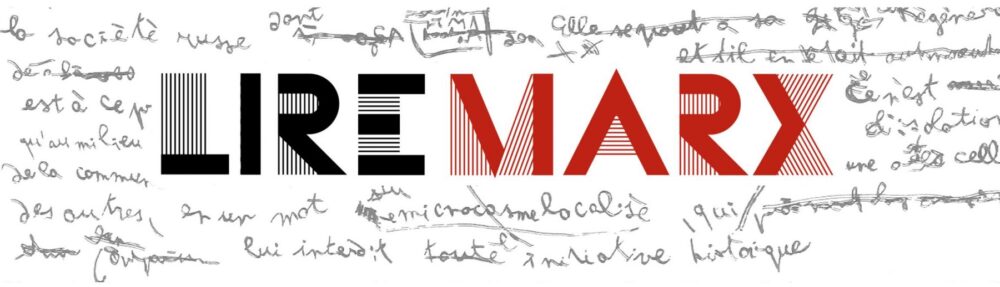Le mouvement des Conseils ouvriers en Allemagne (1919-1935), par Henk Canne-Meijer (lien vers sa biographie)
Le mouvement des Conseils ouvriers en Allemagne (1919-1935), par Henk Canne-Meijer (lien vers sa biographie)
LA REVOLUTION ÉCLATE
En novembre 1918, le front allemand s’effondra. Les soldats désertèrent par milliers. Toute la machine de guerre craquait. Néanmoins, à Kiel, les officiers de la flotte décidèrent de livrer une dernière bataille : pour sauver l’honneur. Alors, les marins refusèrent de servir. Ce n’était pas leur premier soulèvement, mais les tentatives précédentes avaient été réprimées par les balles et les bonnes paroles. Cette fois-ci, il n’y avait plus d’obstacle immédiat ; le drapeau rouge monta sur un navire de guerre, puis sur les autres. Les marins élurent des délégués qui formèrent un Conseil.
Désormais les marins étaient obligés de tout faire pour généraliser le mouvement. Ils n’avaient pas voulu mourir au combat contre l’ennemi ; mais ils demeuraient dans l’isolement, les troupes dites loyales interviendraient et, de nouveau, ce serait le combat, la répression. Aussi les matelots débarquèrent et gagnèrent Hambourg ; de là, par le train ou par tout autre moyen, ils se répandirent dans toute l’Allemagne. Le geste libérateur était accompli. Les événements s’enchaînaient maintenant rigoureusement. Hambourg accueillit les marins avec enthousiasme ; soldats et ouvriers se solidarisaient avec eux, ils élirent eux aussi des Conseils. Bien que cette forme d’organisation ait été jusque-là inconnue dans la pratique, un vaste réseau de Conseils ouvriers et de Conseils de soldats couvrit promptement, en quatre jours, le pays. Peut-être avait-on entendu parler des Soviets russes de 1917, mais alors très peu : la censure veillait. En tout cas, aucun parti, aucune organisation n’avait jamais proposé cette nouvelle forme de lutte.
PRÉCURSEURS DES CONSEILS
Toutefois, pendant la guerre en Allemagne, des organismes assez analogues avaient fait leur apparition dans les usines. Ils étaient formés au cours des grèves par des responsables élus, appelés hommes de confiance. Chargés par le syndicat de petites fonctions sur le tas, ces derniers, dans la tradition syndicale allemande, devaient assurer un lien entre la base et les centrales, transmettre aux centrales les revendications des ouvriers. Pendant la guerre, ces griefs étaient nombreux (les principaux portaient sur l’intensification du travail et l’augmentation des prix). Mais les syndicats allemands – comme ceux des autres pays – avaient constitué un front unique avec le gouvernement, afin de lui garantir la paix sociale en échange de menus avantages pour les ouvriers et de la participation des dirigeants syndicaux à divers organismes officiels. Aussi les hommes de confiance frappaient-ils à la mauvaise porte. Les « fortes têtes » étaient, tôt ou tard, expédiées aux armées, dans les unités spéciales. Il était donc difficile de prendre position, publiquement, contre les syndicats.
Les hommes de confiance cessèrent donc de renseigner les centrales syndicales – cela n’en valait pas la peine – mais la situation,et par conséquent, les revendications ouvrières, n’en demeurait pas moins ce qu’elle était, ils se réunirent clandestinement. En 1917, un flot de grèves sauvages déferla sur le pays. Spontanés, ces mouvements n’étaient pas dirigés par une organisation stable et permanente ; s’ils se déroulaient avec un certain ensemble, c’est qu’ils avaient été précédés de discussions et d’accords entre diverses usines, les contacts préliminaires aux actions étant pris par les hommes de confiance de ces usines.
Dans ces mouvements, provoqués par une situation intolérable, en l’absence de toute organisation à laquelle accorder une confiance si limitée fût-elle, les conceptions différentes (sociale-démocrate, religieuse, libérale, anarchiste, etc.) des ouvriers devaient s’effacer ,devant les nécessités de l’heure ; les masses laborieuses étaient obligées de décider par elles-mêmes, sur la base de l’usine. A l’automne 1918, ces mouvements, jusqu’alors sporadiques et cloisonnés plus ou moins les uns par rapport aux autres, prirent une forme précise et généralisée. Aux côtés des administrations classiques (police, ravitaillement, organisation du travail, etc.) parfois même – en partie – à leur place, les Conseils ouvriers prirent le pouvoir dans les centres industriels importants : à Berlin, à Hambourg, Brème, dans la Ruhr et dans le centre de l’Allemagne, en Saxe. Mais les résultats furent minces. Pourquoi ?
UNE FACILE VICTOIRE
Cette carence provient de la facilité même avec laquelle se formèrent les Conseils ouvriers. L’appareil d’Etat avait perdu toute autorité ; s’il s’écroulait, ici et 1à, ce n’était pas en conséquence d’une lutte acharnée et volontaire des travailleurs. Leur mouvement rencontrait le vide et s’étendait donc sans difficultés, sans qu’il fût nécessaire de combattre et de réfléchir sur ce combat. Le seul objectif dont on parlait était celui de l’ensemble de la population : la paix.
II y avait là une différence essentielle avec la révolution russe. En Russie, la première vague révolutionnaire, la Révolution de Février, avait balayé le régime tsariste ; mais la guerre continuait. Le mouvement des travailleurs unis trouvait ainsi une raison d’accentuer sa pression, de se montrer de plus en plus hardi et décidé. Mais en Allemagne, l’aspiration première de la population, la paix, fut immédiatement comblée ; le pouvoir impérial laissait place à la république. Quelle serait cette république ?
Avant la guerre, il n’y avait sur ce point aucune divergence entre les travailleurs. La politique ouvrière, en pratique comme en théorie, était faite par le parti social-démocrate et les syndicats, adoptée et approuvée par la majorité des travailleurs organisés. Pour les membres du mouvement socialiste, au cours de la lutte pour la démocratie parlementaire et les réformes sociales, ne songeant qu’à cette lutte, l’Etat démocratique bourgeois devait être un jour le levier du socialisme. Il suffirait d’acquérir une majorité au Parlement, et les ministres socialistes nationaliseraient, pas à pas, la vie économique et sociale ; ce serait le socialisme.
II y avait aussi, sans doute, un courant révolutionnaire, dont Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg étaient les représentants les plus connus. Toutefois ce courant ne développa jamais des conceptions nettement opposées au socialisme d’Etat ; il ne constituait qu’une opposition au sein du vieux parti, du point de vue de la base ce courant ne se distinguait pas clairement de l’ensemble.
CONCEPTIONS NOUVELLES
Pourtant des conceptions nouvelles virent le jour pendant les grands mouvements de masse de 1918-1921. Elles n’étaient pas la création d’une prétendue avant-garde, mais bien créées par les masses elles-mêmes. Dans la pratique, l’activité indépendante des ouvriers et des soldats avait reçu sa forme organisationnelle : les Conseils, ces nouveaux organes agissant dans un sens de classe. Et, parce qu’il y a une liaison étroite entre les formes prises par la lutte de classe et les conceptions de l’avenir, il va sans dire que, ça et là, les vieilles conceptions commençaient d’être ébranlées. A présent, les travailleurs dirigeaient leurs propres luttes en dehors des appareils des partis et des syndicats ; aussi l’idée prenait corps que les masses devaient exercer une influence directe sur la vie sociale par le moyen des Conseils. Il y aurait alors « dictature du prolétariat » comme on disait ; une dictature qui ne serait pas exercée par un parti, mais serait l’expression de l’unité enfin réalisée de toute la population travailleuse. Certes, une telle organisation de la société ne serait pas. Démocratique au sens bourgeois du terme, puisque la partie de la population qui ne participait pas à la nouvelle organisation de la vie sociale n’aurait voix ni dans les discussions ni dans les décisions.
Nous disions que les vieilles conceptions commençaient d’être ébranlées. Mais il devint vite évident que les traditions parlementaires et syndicales étaient trop profondément enracinées dans les masses pour être extirpées à bref délai. La bourgeoisie, le parti social démocrate et les syndicats firent appel à ces traditions pour battre en brèche les nouvelles conceptions. Le parti, en particulier, se félicitait en paroles de cette nouvelle façon que les masses avaient de s’imposer dans la vie sociale. II allait jusqu’à exiger que cette forme de pouvoir direct soit approuvée et codifiée par une loi. Mais, s’il leur témoignait ainsi sa sympathie, l’ancien mouvement ouvrier, en entier, reprochait aux Conseils de ne pas respecter la démocratie, tout en les excusant en partie à cause d’un manque d’expérience dû à leur naissance spontanée.En réalité, les anciennes organisations trouvaient que les Conseils ne leur faisaient pas une place assez grande et voyaient en eux des organismes concurrents. En se prononçant pour la démocratie ouvrière, les vieux partis et les syndicats revendiquaient en fait pour tous les courants du mouvement ouvrier le droit d’être représentés dans les Conseils, proportionnellement à leur importance numérique respective.
LE PIÈGE
La plus grande partie des travailleurs était incapable de réfuter cet argument : il correspondait trop à leurs anciennes habitudes. Les Conseils ouvriers rassemblèrent donc des représentants du parti social-démocrate, des syndicats, des social-démocrate de gauche, des coopératives de consommation etc. ainsi que des délégués d’usine. II est évident que de tels Conseils n’étaient pas les organes d’équipes des travailleurs, réunis par la vie à l’usine, mais des formations issues de l’ancien mouvement ouvrier et œuvrant à la restauration du capitalisme sur la base du capitalisme d’Etat démocratique.
Cela signifiait la ruine des efforts ouvriers. En effet, les délégués aux Conseils ne recevaient plus leurs directives de la masse, mais de leurs différentes organisations. Ils adjuraient les travailleurs de respecter et de faire régner « l’ordre », proclamant que « dans le désordre, pas de socialisme ». Dans ces conditions, les Conseils perdirent rapidement toute valeur aux yeux des ouvriers. Les institutions bourgeoises se remirent à fonctionner, sans se soucier de l’avis des Conseils ; tel était précisément le but de l’ancien mouvement ouvrier.
L’ancien mouvement ouvrier pouvait être fier de sa victoire. La loi votée par le Parlement fixait dans le détail les droits et les devoirs des Conseils. Ils auraient pour tâche de surveiller l’application des lois sociales. Autrement dit les Conseils devenaient à leur façon des rouages de l’Etat ; ils participaient à sa bonne marche, au lieu de le démolir. Cristallisées dans les masses, les traditions se révélaient plus puissantes que les résultats de l’action spontanée. Malgré cette « révolution avortée », on ne peut dire que la victoire des éléments conservateurs ait été simple et facile. La nouvelle orientation des esprits, tout de même assez forte pour que des centaines de milliers d’ouvriers luttent avec acharnement afin que les Conseils gardent leur caractère de nouvelles unités de classe. II fallut cinq ans de conflits incessants, pour que le mouvement des Conseils soit définitivement vaincu par le front unique de la bourgeoisie, de l’ancien mouvement ouvrier et des gardes-blancs, formés par les hobereaux prussiens et les étudiants réactionnaires.
COURANTS POLITIQUES
On peut distinguer, en gros, quatre courants politiques du côté des ouvriers :
a) les sociaux-démocrates :
ils voulaient nationaliser graduellement les grandes industries en utilisant la voie parlementaire. Ils tendaient également à réserver aux syndicats le rôle d’intermédiaires exclusifs entre les travailleurs et le capital d’Etat.
b) les communistes :
s’inspirant plus ou moins de l’exemple russe, ce courant préconisait une expropriation directe des capitalistes par les masses. Selon eux, les ouvriers révolutionnaires avaient pour devoir de « conquérir » les syndicats et de les « rendre révolutionnaires ».
c) les anarcho-syndicalistes :
ils s’opposaient à la prise du pouvoir politique et à tout Etat. D’après eux, les syndicats représentaient la formule de l’avenir ; il fallait lutter pour que les syndicats prennent une extension telle qu’ils seraient en mesure, alors, de gérer toute la vie économique. L’un des théoriciens les plus connus de ce courant, Rudolf Rocker, écrivait en 1920 que les syndicats ne devaient pas être considérés comme un produit transitoire du capitalisme, mais bien comme les germes d’une future organisation socialiste de la société. II sembla tout d’abord en 1919, que l’heure de ce mouvement était venue. Les syndicats anarchistes se gonflèrent dès l’écroulement de l’Empire allemand. En 1920, ils comptaient autour de deux cent mille membres.
d) Toutefois, cette année 1920, les effectifs des syndicats révolutionnaires se réduisirent. Une grande partie de leurs adhérents se dirigeaient maintenant vers une toute autre forme d’organisation, mieux adaptée aux conditions de la lutte : l’organisation révolutionnaire d’usine. Chaque usine avait ou devait avoir sa propre organisation, agissant indépendamment des autres, et qui même, dans un premier stade, n’était pas reliée aux autres. Chaque usine faisait donc figure de « république indépendante », repliée sur elle-même.
Sans doute ces organismes d’usines étaient-ils une réalisation des masses ; cependant, il faut souligner qu’ils apparaissaient dans le cadre d’une révolution, sinon vaincue, du moins stagnante. Il devint vite évident que les ouvriers ne pouvaient pas, dans l’immédiat, conquérir et organiser le pouvoir économique et politique au moyen des Conseils ; il faudrait tout d’abord soutenir une lutte sans merci contre les forces qui s’opposaient aux Conseils. Les ouvriers révolutionnaires commençaient donc à rassembler leurs propres forces dans toutes les usines, afin de rester en prise directe sur la vie sociale. Par leur propagande, ils s’efforçaient d’éveiller la conscience des ouvriers, les invitaient à sortir des syndicats et adhérer à l’organisation révolutionnaire d’usine ; les ouvriers comme un tout pourraient alors diriger eux-mêmes leurs propres luttes, et conquérir le pouvoir économique et politique sur toute la Société. En apparence, la classe ouvrière faisait ainsi un grand pas en arrière sur le terrain de son organisation. Tandis qu’auparavant, le pouvoir des ouvriers était concentré dans quelques puissantes organisations centralisées, il se désagrégeait à présent dans des centaines de petits groupes, réunissant quelques centaines ou quelques milliers d’adhérents, selon l’importance de l’usine. En réalité, cette forme se révélait la seule qui permit de poser les jalons d’un pouvoir ouvrier direct ; aussi, bien que relativement petites, ces nouvelles organisations effrayaient la bourgeoisie, la social-démocratie, et les syndicats.
DÉVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS D’USINES
Toutefois, ce n’est pas par principe que ces organisations se tenaient isolées les unes des autres. Leur apparition s’était effectuée ça et là, de façon spontanée et séparée, au cours de grèves sauvages (parmi les mineurs de la Ruhr, en 1919, par exemple). Une tendance se fit jour en vue d’unifier tous ces organismes et d’opposer un front cohérent à la bourgeoisie et à ses acolytes. L’initiative partit des grands ports, Hambourg et Brême ; en avril 1920, une première conférence d’unification se tint à Hanovre. Des délégations venues des principales régions industrielles de l’Allemagne y participèrent. La police intervint et dispersa le congrès. Mais elle arrivait trop tard. En effet, l’organisation générale, unifiée était déjà fondée ; elle avait pu mettre au net les plus importants de ses principes d’action. Cette organisation s’était donnée le nom d’Union générale des travailleurs d’Allemagne : AAUD (Allemeine Arbeiter Union-Deutschlands). L’AAUD avait pour principe essentiel la lutte contre les syndicats et les Conseils d’entreprise légaux, ainsi que le refus du parlementarisme. Chacune des organisations, membre de l’Union, avait droit au maximum d’indépendance et à la plus grande liberté de choix dans sa tactique.
A cette époque en Allemagne, les syndicats comptaient plus de membres qu’ils n’en avaient jamais eu et qu’ils ne devaient en avoir depuis. Ainsi, en 1920, les syndicats d’obédience socialiste regroupaient presque huit millions de cotisants dans 52 associations syndicales ; les syndicats chrétiens avaient plus d’un million d’adhérents ; et les syndicats maison, les jaunes, en réunissaient près de 300 000. En outre, il y avait des organisations anarcho-syndicalistes (FAUD) et aussi quelques autres qui, un peu plus tard, devaient adhérer à l’ISR (Internationale syndicale rouge, dépendant de Moscou). Tout d’abord, l’AAUD ne rassembla que 80 000 travailleurs (avril 1920) ; mais sa croissance fut rapide et, à la fin de 1920, ce nombre passa à 300 000. Certaines des organisations qui la composaient affirmaient, il est vrai, une égale sympathie pour la FAUD ou encore pour l’LSR.
Mais dès décembre 1920, des divergences politiques provoquèrent une grande scission au sein de l’AAUD : de nombreuses associations adhérentes la quittèrent pour former une nouvelle organisation dite unitaire : l’AAUD-E. Après cette rupture, l’AAUD déclarait compter encore plus de 200 000 membres, lors de son 4e Congrès (juin 1921). En réalité, ces chiffres n’étaient déjà plus exacts : au mois de mars 1921, l’échec de l’insurrection d’Allemagne centrale avait littéralement décapité et démantelé l’AAUD Encore faible, l’organisation ne put résister de manière efficace à une énorme vague de répression policière et politique.
LE PARTI COMMUNISTE ALLEMAND (KPD)
Avant d’examiner les diverses scissions dans le mouvement des organisations d’usines, il est nécessaire de parler du parti communiste (KPD). Pendant la guerre, le parti social-démocrate se tint aux côtés – ou plutôt derrière – des classes dirigeantes et fit tout pour leur assurer la « paix sociale » ; à l’exception toutefois d’une mince frange de militants et de fonctionnaires du parti, dont les plus connus étaient Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Ces derniers faisaient de la propagande contre la guerre et critiquaient violemment le parti social-démocrate. Ils n’étaient pas tout à fait seuls. Outre leur groupe, la Ligue Spartacus, il y avait, entre autres, des groupes comme les « Internationalistes » de Dresde et de Francfort, les « radicaux de gauche » de Hambourg ou « Politique ouvrière » de Brême. Dès novembre 1918 et la chute de l’empire, ces groupes, formés à l’école de la « gauche » social-démocrate, se prononcèrent pour une lutte « dans la rue » destinée à forger une organisation nouvelle, politique et qui s’orienterait dans une certaine mesure sur la révolution russe. Finalement, un Congrès d’unification se tint à Berlin et, dès le premier jour (30 décembre 1918), fut fondé le parti communiste [1]. Ce parti devint immédiatement un lieu de rassemblement pour nombre d’ouvriers révolutionnaires qui exigeaient « tout le pouvoir aux Conseils ouvriers ».
II faut noter que les fondateurs du KPD formèrent, en quelque sorte par droit de naissance, les cadres du nouveau parti ; ils y introduisirent donc souvent, avec eux, l’esprit de la vieille social-démocratie. Les ouvriers qui affluaient maintenant au KPD et se préoccupaient en pratique des nouvelles formes de lutte n’osaient pas toujours affronter leurs dirigeants, par respect de la discipline, et se pliaient fréquemment à des conceptions périmées. « Organisations d’usines », ce mot recouvre en effet des notions très dissemblables. Il peut désigner, comme le pensaient les fondateur du KPD, une simple forme d’organisation, sans plus, et donc soumise à des directives qui sont décidées en dehors d’elle : c’était la vieille conception. Il peut aussi renvoyer à un ensemble tout différent d’attitudes et de mentalités. Dans ce sens nouveau, la notion d’organisation d’usines implique un bouleversement des idées admises jusqu’alors à propos de :
a) l’unité de la classe ouvrière ;
b) la tactique de lutte ;
c) les rapports entre les masses et sa direction ;
d) la dictature du prolétariat ;
e) les rapports entre l’Etat et la Société ;
f) le communisme en tant que système économique et politique.
Or, ces problèmes se posaient dans la pratique des luttes nouvelles ; il fallait tenter de les résoudre ou disparaître en tant que forces neuves. La nécessité d’un renouvellement des idées, par conséquent, se faisait pressante ; .mais les cadres du parti – s’ils avaient eu le courage de quitter leurs anciens postes – ne pensaient plus maintenant qu’à reconstituer le nouveau parti sur le modèle de l’ancien, en évitant ses mauvais côtés, en peignant ses buts en rouge et non plus en rose et blanc. D’autre part, il va sans dire que les idées nouvelles souffraient d’un manque d’élaboration et de netteté, qu’elles ne se présentaient pas comme un tout harmonieux, tombé du ciel ou d’un cerveau unique. Plus prosaïquement, elles provenaient en partie du vieux fond idéologique, le neuf y côtoyait l’ancien et s’y mêlait. En bref, les jeunes militants du KPD ne s’opposaient pas de façon massive et résolue à leur direction, mais ils étaient faibles et divisés sur bien des questions.
LE PARLEMENTARISME
Le KPD, dès sa formation, se divisa sur l’ensemble des problèmes soulevés par la notion nouvelle des « organisations d’usines ». Le gouvernement provisoire, dirigé par le social-démocrate Ebert, avait annoncé des élections pour une Assemblée constituante. Le jeune parti devait-il participer à ces élections, même pour les dénoncer ? Cette question provoqua des discussions très vives au Congrès.
La grande majorité des ouvriers exigeait le refus de toute participation aux élections. Au contraire, la direction du parti, y compris Liebknecht et Luxembourg, se prononçait pour une campagne électorale. La direction fut battue aux voix, la majorité du parti se déclara anti-parlementaire. Selon cette majorité, la Constituante n’avait pas d’autre objet que de consolider le pouvoir de la bourgeoisie en lui donnant une base « légale ». A l’inverse, les éléments prolétariens du KPD tenaient surtout à rendre plus actifs, « activer » les Conseils ouvriers existants et à naître ; ils voulaient donc mettre en valeur la différence entre démocratie parlementaire et démocratie ouvrière en répandant le mot d’ordre : « Tout le pouvoir aux Conseils ouvriers ».
La direction du KPD voyait dans cet antiparlementarisme, non pas un renouvellement, mais une régression vers des conceptions syndicalistes et anarchistes, comme celles qui se manifestèrent au début du capitalisme industriel. En réalité, l’anti-parlementarisme du nouveau courant n’avait pas grande chose de commun avec le « syndicalisme révolutionnaire » et l’« anarchisme ». Il en représentait même, à bien des égards, la négation. Tandis que l’anti-parlementarisme des libertaires s’appuyait sur le refus du pouvoir politique, et en particulier de la dictature du prolétariat, le nouveau courant considérait l’anti-parlementarisme comme une condition nécessaire à la prise du pouvoir politique. Il s’agissait donc d’un anti-parlementarisme « marxiste ».
LES SYNDICATS
Sur la question des activités syndicales, la direction du KPD avait, naturellement, une façon de voir différente de celle du courant « organisations d’usines ». Cela donna lieu également à des discussions peu de temps après le Congrès (et aussi l’assassinat de Karl et de Rosa) [2].
Les propagandistes des Conseils mettaient en avant le mot d’ordre « Sortez des syndicats ! Adhérez aux organisations d’usines ! Formez des Conseils ouvriers ». Mais la direction du KPD déclarait : « Restez dans les syndicats. » Elle ne pensait pas, il est vrai, « conquérir » les centrales syndicales, mais elle croyait possible de « conquérir » la direction de quelques branches locales. Si ce projet prenait corps, alors on pourrait réunir ces organisations locales dans une nouvelle centrale qui, elle, serait révolutionnaire. Là encore, la direction du KPD essuya une défaite. La plupart de ses sections refusèrent d’appliquer ses instructions. Mais la direction décida de maintenir ses positions, fût ce au prix de l’exclusion de la majorité de ses membres ; elle fut soutenue par le parti russe et son chef, Lénine ; qui rédigea à cette occasion sa néfaste brochure sur La Maladie infantile [3]. Cette opération se fit au Congrès de Heidelberg (octobre 1919) où, par diverses, machinations, la direction parvint à exclure de façon « démocratique » plus de la moitié du parti… Désormais le Parti communiste allemand était en mesure de mener sa politique parlementaire et syndicale (avec des résultats- plutôt piteux) ; l’exclusion des révolutionnaires lui permit de s’unir, un peu plus tard (octobre 1920) avec une partie des socialistes de gauche (et de quadrupler en nombre : mais pour trois ans seulement). En même temps, le KPD perdait ses éléments les plus combatifs et devait se soumettre inconditionnellement aux volontés de Moscou.
LE PARTI OUVRIER COMMUNISTE (KAPD)
Quelque temps après, les exclus formèrent un nouveau parti : le KAPD. Ce parti entretenait des rapports étroits avec l’AAUD Dans les mouvements de masse, qui eurent lieu au cours des années suivantes, le KAPD fut une force qui compta. On redoutait autant sa volonté et sa pratique d’actions directes et violentes que sa critique des partis et des syndicats, sa dénonciation de l’exploitation capitaliste sous toute ses formes, et d’abord à l’usine, bien entendu ; sa presse et ses publications diverses participent souvent de ce que la littérature marxiste offrait de meilleur, à cette époque de décadence du mouvement ouvrier marxiste, et cela, bien que le KAPD s’embarrassât encore de vieilles traditions.
LE KAPD ET LES DIVERGENCES AU SEIN DE L’AAUD
Quittons maintenant les partis, et revenons au mouvement des « organisations d’usines ». Ce jeune mouvement démontrait que d’importants changements s’étaient produits dans la conscience du monde ouvrier. Mais ces transformations avaient eu des conséquences variées ; différents courants de pensée se révélaient très distinctement dans l’AAUD L’accord était général sur les points suivants :
a) la nouvelle organisation devait s’efforcer de grandir ;
b) sa structure devait être conçue de manière à éviter la constitution d’une nouvelle clique de dirigeants ;
c) cette organisation devrait organiser la dictature du prolétariat lorsqu’elle rassemblerait des millions de membres.
Deux points provoquaient des antagonismes insurmontables :
a) nécessité ou non d’un parti politique en dehors de l’AAUD ;
b) gestion de la vie économique et sociale.
Au début, l’AAUD n’avait que des rapports assez vagues avec le KPD ; aussi ces divergences n’avaient-elles pas de portée pratique. Les choses changèrent avec la fondation du KAPD. L’AAUD coopéra étroitement avec le KAPD et ceci contre la volonté d’un grand nombre de ses adhérents, surtout en Saxe, à Francfort, Hambourg, etc. (il ne faut pas oublier que l’Allemagne était encore extrêmement décentralisée, et ce découpage se répercutait aussi sur la vie des organisations ouvrières). Les adversaires du KAPD dénoncèrent la formation en son sein d’une « clique de dirigeants » et, en décembre 1920, formèrent l’AAUD-E (« E » pour « Einheitsorganisation », organisation unitaire), qui repoussait tout isolement d’une partie du prolétariat dans une organisation « spécialisée », un parti politique.
LA PLATE-FORME COMMUNE
Quels étaient les arguments des trois courants en présence ? II y avait unité de vue dans l’analyse du monde moderne. En gros, tout le monde reconnaissait que la société avait changé : au XIXe siècle, le prolétariat ne formait qu’une minorité restreinte dans la société ; il ne pouvait lutter seul et devait chercher à se concilier d’autres classes, d’où la stratégie démocratique de Marx. Mais ces temps étaient révolus à tout jamais, du moins dans les pays développés d’Occident. Là le prolétariat constituait maintenant la majorité de la population, tandis que toutes les couches de la bourgeoisie s’unifiaient derrière le grand Capital, lui-même unifié. Désormais, la révolution était l’affaire du prolétariat seul. Elle était inévitable, car le capitalisme était entré dans sa crise mortelle (on n’oubliera pas que cette analyse date des années 1920 à 1930).
Si la société avait changé, en Occident du moins, alors la conception même du communisme devait changer, elle aussi. II se révélait, d’ailleurs, que les vieilles idées, appliquées par lès vieilles organisations, représentaient tout le contraire d’une émancipation sociale. C’est par exemple, ce que soulignait en 1924 Otto Rühle, l’un des principaux théoriciens de l’AAUD-E.
« La nationalisation des moyens de production, qui continue d’être le programme de la social-démocratie en même temps que celui des communistes, n’est pas la socialisation. A travers la nationalisation des moyens de production, on peut arriver à un capitalisme d’Etat fortement centralisé, qui aura peut-être quelque supériorité sur le capitalisme privé, mais qui n’en sera pas moins un capitalisme. »
Le communisme résulterait de l’action des ouvriers, de leur lutte active et surtout « par eux-mêmes ». Pour cela, il fallait d’abord que se créent de nouvelles organisations. Mais que seraient ces organisations ? Là les opinions divergeaient et ces antagonismes aboutissaient à des scissions. Elles furent nombreuses. Tandis que la classe ouvrière cessait progressivement d’avoir une activité révolutionnaire, que ses formations officielles n’avaient d’action que spectaculaire autant que dérisoire, ceux qui voulaient agir ne faisaient qu’exprimer, à leur corps défendant, la décomposition générale du mouvement ouvrier. Néanmoins, il n’est pas inutile de rappeler, ici, leurs divergences.
LA DOUBLE ORGANISATION
Le KAPD repoussait l’idée de parti de masse, dans le style léniniste qui prévalut après la révolution russe, et soutenait qu’un parti révolutionnaire est nécessairement le parti d’une élite, petit donc, mais basé sur la qualité et non sur le nombre. Le parti, rassemblant les éléments les mieux éduqués du prolétariat, devrait agir comme un levain dans les masses, c’est-à-dire diffuser la propagande, entretenir la discussion politique, etc. La stratégie qu’il recommandait, c’était la stratégie classe contre classe, basée à la fois sur la lutte dans les usines et le soulèvement armé – parfois même, en préliminaire, l’action terroriste (actions à la bombe, pillage des banques, des wagons-postaux, coffres d’usines, etc. fréquents au début des années 1920). La lutte dans les usines, dirigée par des comités d’action, aurait pour effet de créer l’atmosphère et la conscience de classe nécessaires aux actions de masse et d’amener des masses toujours plus larges de travailleurs à se mobiliser pour les luttes décisives.
Herman Gorter, l’un des principaux théoriciens de ce courant, justifiait ainsi la nécessité d’un petit parti politique communiste :
« La plupart des prolétaires sont dans l’ignorance. Ils ont de faibles notions d’économie et de politique, ne savent pas grand-chose des événements nationaux et internationaux, des rapports qui existent entre ces derniers et de l’influence qu’ils exercent sur la révolution. Ils ne peuvent accéder au savoir en raison de leur situation de classe. C’est pourquoi ils ne peuvent agir au moment qui convient. Ils se trompent très souvent. »
Ainsi, le parti sélectionné aurait une mission éducatrice, il ferait office de catalyseur au niveau des idées. Mais la tâche de regrouper progressivement les masses, de les organiser, reviendrait à l’AAUD, appuyée sur un réseau d’organisations d’usines, et dont l’objectif essentiel serait de contrebattre et de ruiner l’influence des syndicats ; par la propagande, certes, mais aussi et surtout par des actions acharnées, celles « d’un groupe qui montre dans sa lutte ce que doit devenir la masse » disait encore Gorter [4]. Finalement, au cours de la lutte révolutionnaire, les organisations d’usines se transformeraient en Conseils ouvriers, englobant tous les travailleurs et directement soumis à leur volonté, à leur contrôle. En bref, la « dictature du prolétariat » ne serait rien d’autre qu’une AAUD étendue à l’ensemble des usines allemandes.
LES ARGUMENTS DE L’AAUD-E
Opposée au parti politique séparé des organisations d’usines, l’AAUD-E voulait édifier une grande organisation unitaire qui aurait pour tâche de mener la lutte pratique directe des masses et aussi, plus tard, d’assumer la gestion de la société sur la base du système des Conseils ouvriers. Ainsi donc la nouvelle organisation aurait-elle des objectifs à la fois économiques et politiques. D’un côté cette conception différait du « vieux syndicalisme révolutionnaire » qui s’affirmait hostile à la constitution d’un pouvoir politique spécifiquement ouvrier et à la dictature du prolétariat. D’un autre côté, l’AAUD-E, tout en admettant que le prolétariat est faible, divisé et ignorant, et qu’un enseignement continu lui est donc nécessaire, ne voyait pas pour autant l’utilité d’un parti d’élite, style KAPD. Les organisations d’usines suffisaient à ce rôle d’éducation puisque la liberté de parole et de discussion y était assurée.
II est caractéristique que l’AAUD-E adressait au KAPD une critique dans « l’esprit KAP » : d’après l’AAUD-E, le KAPD était un parti centralisé, doté de dirigeants professionnels et de rédacteurs appointés, qui ne se distinguait du parti communiste officiel que par son rejet du parlementarisme ; « double organisation » n’étant rien d’autre alors que l’application d’une politique de la « double mangeoire » au profit des dirigeants. La plupart des tendances de l’AAUD-E, quant à elles, repoussaient l’idée de dirigeants rémunérés : « Ni cartes, ni statuts, ni rien de ce genre », disait-on. Certains allèrent même jusqu’à fonder des organisations anti-organisations…
En gros donc, l’AAUD-E soutenait que si le prolétariat est trop faible ou trop aveugle pour prendre des décisions au cours de ses luttes, ce n’est pas une décision prise par un parti qui pourra y remédier. Personne ne peut agir à la place du prolétariat et il doit, par lui-même, surmonter ses propres défauts, sans quoi il sera vaincu et paiera lourdement le prix de son échec. La double organisation est une conception périmée, vestige de la tradition : parti politique et syndicats.
Cette séparation entre les trois courants : KAP, AA et AAU-E, eut des conséquences dans la pratique. Ainsi, lors de l’insurrection d’Allemagne centrale, en 1921, qui fut déclenchée et menée en grande partie par des éléments armés du KAPD (alors encore reconnus comme sympathisants de la IIIe Internationale), l’AAUD-E. refusa de participer à cette lutte destinée, d’après elle, à camoufler les difficultés russes et la répression de Cronstadt.
Malgré un émiettement continu, que précipitaient des polémiques très vives et trop souvent embrouillées par des questions de personnes, en dépit d’outrances provoquées par une déception et un désespoir profonds, « l’esprit KAP », c’est-à-dire l’insistance sur l’action directe et violente, la dénonciation passionnée du capitalisme et de ses lieutenants ouvriers de toutes couleurs politiques et syndicales (y compris les « maires du palais » de Moscou), exerça longtemps une influence sensible dans les masses. Il faut ajouter que toutes ces tendances disposaient d’une presse importante [5], généralement alimentée en argent par des moyens illégaux, et que souvent réduits aux chômage, en raison de leur comportement subversif, leurs membres étaient extrêmement actifs, dans la rue, dans les réunions publiques, etc.
LE MÉCOMPTE
On avait cru que la soudaine croissance des organisations d’usines, en 1919 et 1920, continuerait à peu près à la même cadence au cours des luttes à venir. On avait cru que les organisations d’usines deviendraient un grand mouvement de masses, groupant « des millions et des millions de communistes conscients », lequel contrebalancerait le pouvoir des syndicats prétendument ouvriers. Partant de cette juste hypothèse que le prolétariat ne peut lutter et vaincre que comme classe organisée, on croyait que les travailleurs élaboreraient chemin faisant une nouvelle et toujours croissante organisation permanente. C’est à la croissance de l’AAU et de l’AU-E qu’on pouvait mesurer le développement de la combativité et de la conscience de classe.
Après une période d’expansion économique accélérée (1923-1929) une nouvelle période s’ouvrit qui devait aboutir en 1933 à la prise du pouvoir, légale, par les hitlériens. Cependant, l’AAU, le KAP et l’AAU-E se repliaient de plus en plus sur eux-mêmes. A la fin, il ne restait plus que quelques centaines d’adhérents, vestige des grandes organisations d’usines d’antan, ce qui signifiait l’existence de petits noyaux, ça et là, sur un total de 20 millions de prolétaires. Les organisations d’usines n’étaient plus des organisations générales des travailleurs, mais des noyaux de communistes-de-conseils conscients. Dès lors, l’AAUD comme l’AAUD-E revêtaient le caractère de petits partis politiques, même si leur presse prétendait le contraire.
LES FONCTIONS
Est-ce spécialement le petit nombre de leurs adhérents qui transforma à la longue les organisations d’usines en parti politique ? Non. C’était un changement de fonction. Quoique les organisations d’usines n’eussent jamais eu pour tâche proclamée de diriger une grève, de négocier avec les patrons, de formuler des revendications (c’était l’affaire des grévistes), l’AAU et l’AA-E étaient des organisations de lutte pratique. Elles se bornaient à des activités de propagande et de soutien. Toutefois, la grève étant déclenchée, les organisations d’usines s’occupaient en grande partie de l’organisation de la grève ; elles organisaient les assemblées de grève et les orateurs y étaient très souvent des membres de l’AAU ou de l’AAU-E. Mais la charge de conduire les négociations avec les patrons revenait au comité de grève où les membres de l’organisation d’usines ne représentaient pas leur groupe comme tel, mais les grévistes qui les avaient élus et devant lesquels ils étaient responsables.
Le parti politique KAPD avait une autre fonction. Sa tâche consistait surtout en propagande, en analyse économique et politique. Au moment des élections, il faisait de la propagande anti-parlementaire pour dénoncer la politique bourgeoise des autres partis, appeler à former des comités d’action dans les usines, sur les marchés, parmi les chômeurs, etc. dont le but était d’inciter les masses, qui « cherchent instinctivement de nouveaux rivages », à se libérer des vieilles organisations.
CHANGEMENT DE FONCTION
Mais en fait, après l’échec et la répression sanglante de 1921, puis avec la vague de prospérité qui ne tarda pas de se manifester, ces fonctions devinrent purement théoriques. Dès lors, l’activité de ces organisations fut réduite à la propagande pure et à l’analyse, c’est-à-dire à une activité de groupement politique. Découragés par l’absence de perspectives révolutionnaires, les adhérents quittèrent pour la plupart l’organisation. La réduction des effectifs eut aussi pour conséquence que l’usine ne constituait plus la base de l’organisation. On se réunissait sur la base du quartier, dans une brasserie, où l’on chantait parfois, à l’allemande, en chœur, avec lenteur, les vieux chants ouvriers d’espoir et de colère.
II n’y avait plus grande différence entre le KAPD, l’AAUD et l’AAUD-E. Pratiquement, les membres de l’AU et du KAP se retrouvaient les mêmes à des réunions nominalement différentes et ceux de l’AAUD-E étaient membres d’un groupe politique, même s’ils lui donnaient un autre nom. Anton Pannekoek, le marxiste hollandais qui fut l’un de leurs inspirateurs théoriques à tous (mais surtout du KAPD), écrivait à ce propos (1927) :
« L’AAU, de même que le KAPD, constitue essentiellement une organisation ayant pour but immédiat la révolution. En d’autres temps, dans une période de déclin de la révolution, on n’aurait absolument pas pu penser à fonder une telle organisation. Mais elle a survécu aux années révolutionnaires ; les travailleurs qui la fondèrent autrefois et combattirent sous ses drapeaux ne veulent pas laisser se perdre l’expérience de ces luttes et la conservent comme une bouture pour les développements à venir. »
Et, en premier lieu, trois partis politiques de la même couleur, c’était deux de trop. Avec la montée des périls, tandis que s’affirmait la lâcheté sans nom des vieilles et soi-disant puissantes organisations ouvrières, tandis que les nazis entamaient triomphalement le chemin qui devait les mener où l’on sait aujourd’hui, l’AAU, en décembre 1931, séparée déjà du KAP, fusionna avec l’AAU-E. Seuls quelques éléments demeurèrent dans le KAPD, et quelques autres de l’AAUD-E rejoignirent les rangs anarchistes. Mais la plupart des survivants des organisations d’usines se regroupèrent dans la nouvelle organisation, la KAUD (Kommunistische Arbeiter Union : Union ouvrière communiste), exprimant ainsi l’idée que cette dernière n’était plus une organisation « générale » (comme l’était l’AAU, par exemple) réunissant tous les travailleurs animés d’une volonté révolutionnaire, mais bien des travailleurs communistes conscients.
LA CLASSE ORGANISÉE
La KAUD exprimait donc le changement intervenu dans les conceptions de l’organisation. Ce changement avait un sens ; il faut se souvenir de ce que signifiait jusqu’alors la notion de « classe organisée ». L’AAUD et l’AAUD-E avaient cru tout d’abord que ce seraient elles qui organiseraient la classe ouvrière, que des millions d’ouvriers adhéreraient à leur organisation. C’était au fond une idée très proche de celle des syndicalistes révolutionnaires d’autrefois qui s’attendaient à voir tous les travailleurs adhérer à leurs syndicats : et qu’alors la classe ouvrière serait enfin une classe organisée.
Maintenant la KAUD incitait les ouvriers à organiser eux-mêmes leurs comités d’action et à créer des liaisons entre ces comités. Autrement dit, la lutte de classe « organisée » ne dépendait plus d’une organisation bâtie préalablement à toute lutte. Dans cette nouvelle conception, la « classe organisée » devenait la classe ouvrière luttant sous sa propre direction.
Ce changement de conception avait des conséquences par rapport à de nombreuses questions : la dictature du prolétariat, par exemple. En effet, puisque la « lutte organisée » n’était pas l’affaire exclusive d’organisations spécialisées dans sa direction, celles-ci ne pouvaient plus être considérées comme les organes de la dictature du prolétariat. Du même coup disparaissait le problème qui, jusqu’alors, avait été cause de multiples conflits, à savoir : qui du KAP ou de l’AAU devait exercer ou organiser le pouvoir ? La dictature du prolétariat ne serait plus l’apanage d’organisations spécialisées, elle se trouverait dans les mains de la classe en lutte, assumant tous les aspects, toutes les fonctions de la lutte. La tâche de la nouvelle organisation, la KAUD, se réduirait donc à une propagande communiste, clarifiant les objectifs, incitant la classe ouvrière à la lutte contre les capitalistes et les anciennes organisations, au moyen tout d’abord de la grève sauvage, et tout en lui montrant ses forces et ses faiblesses. Cette activité n’en était pas moins indispensable. Et la plupart des membres de la KAU continuaient de penser que « sans une organisation révolutionnaire capable de frapper fort, il ne peut y avoir de situation révolutionnaire comme l’ont démontré la révolution russe de 1917 et, en sens contraire, la révolution allemande de 1918 » [6].
LA SOCIÉTÉ COMMUNISTE ET LES ORGANISATIONS D’USINES
Cette évolution dans les idées devait nécessairement s’accompagner d’une révision des notions admises en ce qui concerne la société communiste. D’une façon générale, l’idéologie qui dominait dans les milieux politiques et dans les masses était axée sur la création d’un capitalisme d’Etat. Bien entendu, il y avait des nuances multiples, mais toute cette idéologie pouvait se ramener à quelques principes très simples : l’Etat, au travers des nationalisations, de l’économie dirigée, des réformes sociales, etc., représente le levier permettant de réaliser le socialisme, tandis que l’action parlementaire et syndicale représente pour l’essentiel les moyens de lutte. Dès lors, les travailleurs ne luttent guère comme une classe indépendante, visant avant tout à réaliser ses fins propres ; ils doivent confier « la gestion et la direction de la lutte de classe » à des chefs parlementaires et syndicaux. Selon cette idéologie, il va donc sans dire que partis et syndicats devront servir d’éléments de base à l’Etat ouvrier, assumer en commun la gestion de la société communiste de l’avenir.
Au cours d’une première phase, celle qui suivit l’échec des tentatives révolutionnaires en Allemagne, cette tradition imprégnait encore fortement les conceptions de l’AAU, du KAP et de l’AAU-E. Tous trois se prononçaient pour une organisation groupant « des millions et des millions » d’adhérents, afin d’exercer la dictature politique et économique du prolétariat. Ainsi, en 1922, l’AAU déclarait qu’elle était en mesure de reprendre à son compte, sur la base de ses effectifs, « la gestion de 6 % des usines » allemandes.
Mais ces conceptions chancelaient maintenant. Jusqu’alors, comme nous l’avons vu, les centaines d’organisations d’usines, réunies et coordonnées par l’AAU et l’AAU-E, réclamaient le maximum d’indépendance quant aux décisions à prendre et faisaient de leur mieux pour éviter la formation d’une « nouvelle clique de dirigeants ». Serait-il possible, cependant, de conserver cette indépendance au sein de la vie sociale communiste ? La vie économique est hautement spécialisée et toutes les entreprises sont étroitement interdépendantes. Comment pourrait-on gérer la vie économique si la production et la répartition des richesses sociales ne revenait pas à quelques instances centralisatrices ? L’Etat en tant que régulateur de la production et organisateur de la répartition, l’Etat n’était-il pas indispensable ?
Il y avait là une contradiction entre les vieilles conceptions de la société communiste et la nouvelle forme de lutte qu’on préconisait maintenant. On redoutait la centralisation économique et ses conséquences clairement démontrées par les événements ; mais on ne savait comment se prémunir contre cela. La discussion portait sur la nécessité et le degré plus ou moins grands du « fédéralisme », ou du « centralisme ». L’AAU-E penchait plutôt vers le fédéralisme ; le KAP-AAU inclinait plus au centralisme. En 1923, Kar1 Schroeder [7], théoricien du KAPD, proclamait que « plus la société communiste sera centralisée et mieux ce sera ».
En fait, tant qu’on demeurait sur la base des anciennes conceptions de la « classe organisée », cette contradiction était insoluble. D’une part, on se ralliait plus ou moins aux vieilles conceptions du syndicalisme révolutionnaire, la « prise » en main des usines par les syndicats ; d’autre part, comme les bolcheviks, on pensait qu’un appareil centralisateur, l’Etat, doit régler le processus de production et répartir le « revenu national » entre les ouvriers.
Toutefois, une discussion au sujet de la société communiste, en partant du dilemme « fédéralisme ou centralisme », est absolument stérile. Ces problèmes sont des problèmes d’organisation, des problèmes techniques, alors que la société communiste est d’abord un problème économique. Au capitalisme doit succéder un autre système économique, où les moyens de production, les produits, la force de travail ne revêtent pas la forme de la « valeur » et où l’exploitation de la population laborieuse au profit de couches privilégiées a disparu. La discussion sur « fédéralisme ou centralisme » est dépourvue de sens, si l’on n’a pas montré auparavant quelle sera la base économique de ce « fédéralisme » ou de ce « centralisme ». En effet, les formes d’organisation d’une économie donnée ne sont pas des formes arbitraires ; elles dérivent des principes mêmes de cette économie. Ainsi, le principe du profit et de la plus-value, de son appropriation privée ou collective, se trouve-t-il à la base de toutes les formes revêtues par une économie capitaliste. C’est pourquoi il est insuffisant de présenter l’économie communiste comme un système négatif : pas d’argent, pas de marché, pas de propriété privée ou d’Etat. II est nécessaire de mettre en lumière son caractère de système positif, montrer quelles seront les lois économiques qui succéderont à celles du capitalisme. Cela fait, il est probable que l’alternative « fédéralisme ou centralisme » apparaîtra comme un faux problème.
LA FIN DU MOUVEMENT EN ALLEMAGNE
Avant d’examiner plus longuement cette question, il n’est pas inutile de rappeler le destin, dans la pratique, du courant issu des organisations révolutionnaires d’usines.
L’AAUD commença à se détacher du KAPD vers la fin de 1929. Sa presse préconisait alors une « tactique souple » : le soutien des luttes ouvrières ayant uniquement pour but des revendications de salaires l’aménagement des conditions ou horaires de travail. Plus rigide, le KAP voyait dans cette tactique l’amorce d’un glissement vers ta collaboration de classe, la « politique de maquignonnage » [8].
Un peu plus tard, certains KAPistes en arrivèrent même à prôner le terrorisme individuel comme moyen d’amener les masses à la conscience de classe. Marinus van der Lubbe qui, agissant solitairement, mit le feu au Reichstag, était en liaison avec ce courant. En incendiant l’immeuble qui abritait le Parlement, il voulait par un geste symbolique inciter les ouvriers à sortir de leur léthargie politique… [9].
Ni l’une ni l’autre de ces tactiques n’eut de résultats. L’Allemagne traversait alors une crise économique d’une profondeur extrême, les chômeurs pullulaient : il n’y avait pas de grèves sauvages, s’il est vrai que nul ne se souciait des directives syndicales, les syndicats collaborant étroitement avec les patrons et l’Etat. La presse des communistes de conseils était fréquemment saisie ; mais de toute façon ses appels à la formation de comités autonomes d’action ne rencontraient aucun écho. Ironie de l’histoire : 1a seule grande grève sauvage de l’époque, celle des transports berlinois (1932), fut soutenue par les bonzes staliniens et hitlériens contre les bonzes socialistes des syndicats.
Après l’accession légale d’Hitler au pouvoir, les militants des diverses tendances furent traqués et enfermés dans des camps de concentration où beaucoup d’entre eux disparurent. En 1945, quelques survivants furent exécutés sur ordre du Guépéou, lors de l’entrée en Saxe des armées russes. En 1952 encore, à Berlin Ouest, un ancien chef de l’AAUD, Alfred Weilard, était enlevé en pleine rue et transféré à l’Est pour s’y voir condamné à une lourde peine de prison.
A l’heure actuelle, il ne reste plus trace en Allemagne des divers courants du communisme de conseils en tant que tel. La liquidation des hommes a entraîné celle des idées dont ils étaient porteurs, tandis que l’expansion et la prospérité orientaient les esprits dans d’autres directions. Et, comme on le sait, c’est seulement ces toutes dernières années que ses conceptions propres de l’action de masse extra-parlementaire et extra-syndicale connaissent de nouveaux développements, sans qu’on puisse pour autant parler de « filiation » idéologique directe. Mais revenons maintenant au problème de l’économie communiste, pour voir en quoi les réflexions théoriques de ce mouvement peuvent contribuer à enrichir notre connaissance de la lutte pour le pouvoir ouvrier.
FONDEMENTS ÉCONOMIQUES DU COMMUNISME
Il fallait, pour approfondir ces problèmes, que l’AAU se fût libérée des vieilles traditions de la « classe organisée », qu’elle ait compris que la classe ouvrière ne peut réaliser son unité réelle que dans sa lutte en masse, globale, et en dehors des organisations spécialisées qui ne représentent au mieux que les aspects fragmentaires d’une phase périmée des aspirations et des objectifs prolétariens. En 1930, l’AAU publia une étude, rédigée par le groupe des communistes de conseils de Hollande et qui était intitulée : Grundptinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung (Principes fondamentaux de la production et de la distribution communistes) [10].
Cette analyse n’entend pas proposer un « plan » quelconque, montrer comment on pourrait édifier une société « plus belle », « plus équitable ». Elle ne s’intéresse qu’aux problèmes d’organisation de l’économie communiste et lie, dans une unité organique, pratique de la lutte de classe et gestion sociale. Les Principes tirent donc, au niveau théorique, les conséquences économiques de la lutte éventuellement menée au niveau de l’action politique par les mouvements de masse indépendants. Lorsque les Conseils ouvriers auront pris le pouvoir, et parce qu’ils auront appris à « gérer leur lutte » eux-mêmes directement, par un effort constant, ils se trouveront contraints de donner de nouvelles bases à leur pouvoir en introduisant consciemment des lois économiques nouvelles où la mesure du temps de travail sera le pivot de la production et de la répartition du produit social global. Les travailleurs sont capables de gérer eux-mêmes la production, mais cela n’est possible qu’en calculant le temps de travail dans les différentes branches de la production, au sens le plus large, et en répartissant les produits à l’aide de cette mesure.
Les « Principes » examinent ce problème du point de vue du travailleur exploité, qui n’aspire pas seulement à l’abolition de la propriété privée, mais bien à celle de l’exploitation. Or, l’histoire de notre époque a montré que la suppression de la propriété privée, si elle est nécessaire, ne coïncide pas obligatoirement avec celle de l’exploitation. Aussi doit-on serrer de plus près cette question.
Le mouvement anarchiste a compris cette nécessité beaucoup plus tôt que les marxistes, et ses théoriciens lui ont accordé une attention soutenue. Toutefois leurs conceptions, en fin de compte, n’ont pas été totalement différentes. Si les marxistes, sociaux-démocrates ou bolcheviks, voulaient faire passer, sans rien changer de fondamental à ses mécanismes, la production capitaliste, arrivée au stade des monopoles, sous le contrôle d’un Etat dit ouvrier, les théoriciens anarchistes préconisaient une fédération de communes libres et repoussaient tout Etat. C’était cependant pour le reconstituer sous une autre forme. Ce point étant souvent contreversé, nous allons en donner ici un exemple.
L’un des théoriciens les plus connus de l’anarchisme, Sébastien Faure, exposait que les habitants d’une commune auraient à recenser leurs besoins et leurs possibilités de productions ; puis, disposant de « l’état global des besoins de la consommation et des possibilités de la production, région par région, le Comité National fixe et fait connaître à chaque comité Régional de quelles quantités de produits sa région peut disposer et quelle somme de production elle doit fournir. Muni de ces indications, chaque comité Régional fait pour sa région le même travail : il fixe et fait connaître à chaque comité Communal de quoi se commune dispose et ce qu’elle a à fournir. Ce dernier en fait autant à l’égard des habitants de la commune [11] ».
Certes, Sébastien Faure avait auparavant précisé que : « Toute cette vaste organisation a pour base et principe vérificateur la libre entente »,mais un système économique exige des principes économiques et non des proclamations nobles. On peut faire la même chose à propos de la citation suivante de Hilferding, le célèbre théoricien social-démocrate, car là aussi le principe économique manque :
« Les commissaires communaux, régionaux et nationaux de la société socialiste décident comment et où, en quelle quantité et par quels moyens l’on tirera des nouveaux produits des conditions de production naturelles ou artificielles. A l’aide de statistiques de production et de consommation couvrant l’ensemble des besoins sociaux, ils transforment la vie économique toute entière d’après les besoins qu’expriment ces statistiques [12]. »
Ainsi la différence entre ces deux points de vue fondamentaux n’est pas très sensible. Toutefois les anarchistes ont eu le mérite historique de mettre en avant le mot d’ordre essentiel : « Abolition du salariat. » Dans cette perspective cependant, le « Comité National », le « bureau de la statistique », etc., ce que les marxistes appellent le « gouvernement du peuple », est censé pratiquer « l’économie en nature » c’est-à-dire une économie où l’argent n’a plus cours. Le logement, les aliments, le courant électrique, les transports, etc, tout cela est « gratuit ». Une certaine part de biens et services demeure toutefois payable en monnaie (généralement indexée sur le rapport population-consommation) .
Mais en dépit des apparences, cette manière de supprimer le salaire ne signifie pas l’abolition de l’exploitation et ne signifie pas non plus la liberté sociale. En effet, plus s’agrandit le secteur de l’économie « en nature », plus les travailleurs dépendent de la fixation de leurs « revenus » par l’appareil de répartition. Il existe un exemple d’économie « sans argent », où les échanges avaient lieu en « nature », du moins pour la plus grande partie, avec le logement, l’éclairage, etc., « gratuits ». C’est la période du « communisme de guerre » en Russie. On a pu voir alors, non seulement que ce système n’était pas viable durablement, mais encore qu’il pouvait coexister avec un régime fondé sur une domination de classe.
La réalité nous a donc appris :
a) qu’il est possible de supprimer la propriété privée sans abolir l’exploitation ;
b) qu’il est possible de supprimer le salariat sans abolir l’exploitation.
S’il en est ainsi, le problème de la révolution prolétarienne se pose pour l’exploité dans les termes suivants :
– quelles sont les conditions économiques qui permettent d’abolir l’exploitation ?
– Quelles sont les conditions économiques qui permettent au prolétariat de conserver le pouvoir, une fois ce dernier conquis, et de couper les racines de la contre-révolution ?
Bien que les Principes étudient les fondements économiques du communisme, le point de départ en est plus politique qu’économique. Pour les ouvriers il n’est pas facile de s’emparer du pouvoir politique-économique, mais il est encore plus difficile de le conserver. Or, dans les conceptions présentes du communisme ou du socialisme, on tend à concentrer – dans les faits sinon dans les mots – tout le pouvoir de gestion dans quelques bureaux étatiques ou « sociaux ». A l’inverse, ce livre considère l’économie comme le prolongement inévitable de la révolution et non comme un état de chose souhaitable et qui se réalisera dans cent, dans mille ans. Il s’agit de définir au niveau des principes les mesures à prendre, non par quelque parti ou organisation, mais par la classe ouvrière et par ses organes immédiats de lutte : les Conseils ouvriers. La réalisation du communisme n’est pas l’affaire d’un parti mais celle de toute la classe ouvrière, délibérant et agissant dans et par ses Conseils.
LE PRODUCTEUR ET LA RICHESSE SOCIALE
Un des grands problèmes de la révolution est d’instaurer de nouveaux rapports entre le producteur et la richesse sociale, rapports qui, au sein de la société capitaliste, s’expriment dans le salariat. Le régime du salariat est basé sur un antagonisme profond entre la valeur de la force de travail (salaire) et ce travail même (le produit du travail). Alors que le travailleur fournit, par exemple, 50 heures de travail à la société, il ne reçoit comme salaire que l’équivalent de 10 heures, par exemple. Pour s’émanciper véritablement le travailleur doit faire en sorte que ce ne soit plus la valeur de sa force de travail qui détermine la part qui lui revient de la production sociale, mais que cette part soit fixée par son travail même. Le travail : mesure de la consommation, tel est le principe qu’il doit faire triompher.
La différence entre la quantité de travail fournie et ce que le travailleur reçoit en échange est appelé surtravail et représente un travail non payé. Les richesses sociales produites pendant ce temps de travail non payé constituent le surproduit et la valeur incorporée dans ce surproduit est dite plus-value. Toute société, quelle qu’elle soit, et donc aussi la société communiste, repose sur la formation d’un surproduit, parce que sur l’ensemble des travailleurs effectuant un travail nécessaire ou utile, certains ne produisent pas de biens tangibles. Leurs conditions de vie sont donc produites par d’autres travailleurs (il en est de même pour les services de santé, l’entretien des infirmes, des enfants et des vieillards, les services administratifs, les savants, etc.). Mais c’est la façon dont ce surproduit se forme, celle dont il est réparti, qui constituent l’exploitation capitaliste.
Le travailleur reçoit un salaire qui, dans le meilleur des cas, lui suffit tout juste pour vivre dans des conditions données. Il sait qu’il a donné 50 heures de travail, mais il ne sait pas combien d’heures lui reviennent dans son salaire. Il ignore le montant de son surtravail. En revanche, on sait comment la classe possédante consomme ce surproduit : mis à part les « services sociaux » qui en reçoivent une certaine partie, ce sont les mines qui l’utilisent pour s’agrandir, les exploiteurs qui en vivent, l’administration, la police et l’armée qui en dissipent la substance.
Dans cette discussion, deux caractères du surproduit nous intéressent particulièrement. D’abord, le fait que la classe ouvrière n’a pas à décider, ou presque pas, du produit de son travail non payé. Ensuite,qu’il est impossible d’évaluer l’importance de ce surtravail. Nous recevons un salaire, un point c’est tout ; nous ne pouvons rien sur la production et la répartition de la richesse sociale. La classe qui dispose des moyens de production, la classe possédante, est maîtresse du processus de travail, y compris le surtravail ; elle nous fait chômer quand elle l’estime nécessaire à ses intérêts, nous fait matraquer par sa police ou massacrer dans ses guerres. L’autorité exercée par la bourgeoisie dérive du fait qu’elle dispose du travail, du surtravail, du surproduit. C’est ce qui nous réduit à l’impuissance dans la société et fait de nous une classe opprimée.
Cette analyse nous révèle que l’oppression est tout aussi forte, qu’elle soit exercée par le capitalisme privé ou par l’Etat. On entend souvent dire que l’exploitation dès travailleurs est supprimée en Russie, parce que le capital privé y est aboli et parce que tout le surproduit est à la disposition de l’Etat qui le répartit dans la société en promulguant de nouvelles lois sociales et en créant de nouvelles usines, en développant la production.
Acceptons ces arguments, c’est-à-dire laissons de côté le fait que la classe dominante ,la bureaucratie, chargée de la répartition du produit social, s’enrichit par des salaires exorbitants, qu’elle se reproduit au pouvoir en assurant à ses membres le monopole de l’éducation supérieure, et que les lois de succession lui garantissent les richesses accumulées « pour sa famille ». Allons même jusqu’à supposer que cet appareil n’exploite pas la population.
En serait-il ainsi, qu’en Russie la bureaucratie demeure maîtresse du processus du travail, y compris le surtravail, qu’elle. dicte, par la voix des syndicats étatisés, entre autres les conditions de travail, comme on le voit faire également en Occident. La fonction de la bureaucratie dirigeante est fondamentalement identique à celle de la bourgeoisie qui dirige le capitalisme privé. Dès lors, si la bureaucratie n’exploitait pas la population, cela ne saurait venir que de sa bonne volonté, du fait qu’elle refuse l’occasion qui lui en est offerte. Le développement de la société ne serait plus fonction de nécessités économiques et sociales ; il dépendrait des « bons » ou des « mauvais » sentiments des dirigeants. En d’autres termes, les rapports des travailleurs avec la richesse sociale continuent, même dans ce cas, d’être arbitrairement fixés et les travailleurs ne peuvent rien sur ces rapports, sauf à espérer que les « mauvais » dirigeants deviendront « bons ».
En conclusion, l’abolition du salaire n’est pas la condition nécessaire et suffisante pour que les travailleurs reçoivent la part du produit social qui leur revient, qu’ils ont créée par leur travail. Certes, cette part peut augmenter ; mais une véritable abolition du salaire sous toutes ses formes a un tout autre caractère : sans cette abolition, la classe ouvrière ne peut maintenir son pouvoir. Une révolution « trahie » mène à un Etat totalitaire capitaliste.
Il y a une autre conclusion à tirer. L’une des tâches essentielles incombant à un groupe de travailleurs qui veulent mettre fin radicalement à l’exploitation capitaliste – un groupe révolutionnaire, comme on disait autrefois – c’est de chercher le moyen d’asseoir économiquement le pouvoir conquis par des moyens d’action politiques. Le temps est passé où il suffisait d’exiger la suppression de la propriété privée des moyens de production. Il est également insuffisant de réclamer l’abolition du salariat. Cette revendication, en soi, n’a pas plus de consistance qu’une bulle de savon, si l’on ne sait comment jeter les bases d’une économie où le salaire est supprimé. Un groupe se prétendant révolutionnaire et qui se refuserait à élucider cette question essentielle n’a pas grand chose à dire en réalité, parce qu’il est incapable de proposer l’image d’un monde nouveau.
Les Principes de la production et de la répartition communistes partent de l’idée suivante : tous les biens produits par le travail de l’homme se valent qualitativement, car ils représentent tous une portion de travail humain. Seule la quantité de travail différente qu’ils représentent les rend dissemblables. La mesure du temps que chaque travailleur individuellement consacre au travail est l’heure de travail. De même, la mesure destinée à mesurer la quantité de travail que représente tel ou tel objet doit être l’heure de travail social moyen. C’est cette mesure qui servira à établir la somme de richesse dont dispose la société, de même que les rapports des diverses entreprises entre elles et enfin la part de ces richesses qui revient à chaque travailleur. Sur cette base, les Principes développent une analyse et une critique des différentes théories – et aussi des pratiques – des différents courants qui se réclament du- marxisme, de l’anarchisme ou du socialisme en général. On y trouve en somme un exposé plus précis des principes concis de Marx et d’Engels tels qu’ils nous les ont laissés dans Le Capital, la Critique du programme de Gotha et L’Anti-Dühring.
Bien entendu, les Principes ne se bornent pas à étudier l’unité de calcul dans le communisme ; ils analysent aussi son application dans la production et la répartition du produit social et dans les « services publics », examinent les règles nouvelles de la comptabilité sociale, l’extension de la production et son contrôle par les travailleurs, la disparition du marché et, enfin, l’application du communisme dans l’agriculture par l’intermédiaire de coopératives agricoles qui calculent elles aussi leurs récoltes en temps de travail.
Ainsi les Principes ont-ils pour point de départ le fait empirique que, lors de la prise de pouvoir par le prolétariat, les moyens de production se trouvent entre les mains des organisations d’entreprise. C’est de la conscience communiste du prolétariat, conscience née de sa lutte même, que dépendra le sort ultérieur de ces moyens de production, le fait de savoir si le prolétariat les gardera en main ou non. Aussi, le problème capital que la révolution prolétarienne devra résoudre sera de fixer des rapports immuables entre les producteurs et le produit social, ce qui ne peut se faire qu’en introduisant le calcul du temps de travail dans la production et la distribution. C’est la revendication la plus élevée que le prolétariat puisse formuler… mais en même temps c’est le minimum de ce qu’il peut réclamer. Et donc une question de pouvoir que seul le prolétariat est à même de régler sans appui aucun de la part d’autres groupes sociaux. Le prolétariat ne peut conserver les entreprises que s’il s’en assure la gestion et la direction autonomes. C’est aussi la seule manière de pouvoir appliquer partout le calcul du temps de travail. Tel est l’ultime message laissé au monde par les mouvements révolutionnaires prolétariens de la première moitié du XXe siècle.
A suivre : Mouvement pour les Conseils ouvriers – 2 :Le Groupe des communistes internationalistes en Hollande, 1934-1939
Notes
[1] On trouvera la traduction du compte rendu de ce congrès, réunie à d’autres matériaux intéressants, dans A. et D. Prudhommeaux, Spartacus et la Commune de Berlin, éd. Spartacus.
[2] Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht sont assassinés par les corps-francs à Berlin le 15 janvier 1919.
[3] La Maladie infantile du communisme (le « gauchisme ») a été terminé par Lénine en mai 1920. Ce texte sera distribué à tous les délégués au IIe Congrès de l’Internationale communiste. Lénine y exprime sa vision de la lutte politique en vue d’une prise de pouvoir.
[4] (1)Herman Gorter, Réponse à Lénine (1920) Paris, 1930. Texte en ligne : www.left-dis.nl/f/herman.htm.
[5] On considérait dans le KAP que la réaction des journaux devait être « tournante », c’est-à-dire prise en charge à tour de rôle par les différentes sections locales du parti, ceci afin d’éviter la formation d’une « clique » spécialisée dans la manipulation.
[6] Rätekorrespondenz, n° 2, novembre 1932 (organe clandestin, ronéoté, de la KAU, dont la presse, dès ce moment, était régulièrement saisie par ordre des autorités social-démocrates de Prusse).
[7] Karl Schroeder (1854-1950) combattant spartakiste, dont la tête fut mise à prix en 1919, puis dirigeant professionnel du KAPD, en fut exclu en 1924 ; il devint ensuite fonctionnaire du Parti socialiste. II fut l’un des rares dirigeants de ce parti à organiser une « résistance » au nazisme. Condamné en 1936 avec d’autres anciens du KAP, il tient aujourd’hui une place honorable dans le « martyrologue » du socialisme allemand.
[8] Ainsi l’un des dirigeants du parti fut exclu sous prétexte qu’il avait pactisé avec l’ennemi en publiant un roman dans la maison d’édition du Parti communiste allemand. Il s’agissait d’Adam Scharrer (1889-1948) ouvrier serrurier, puis combattant spartakiste. Ensuite dirigeant professionnel du KAPD, dont il fut exclu en 1930. Comme Schroeder, il est romancier, mais il s’oriente dans l’autre direction : à partir de 1933, il réside à Moscou. Il était considéré en Allemagne de l’Est comme un « pionnier de la littérature prolétarienne ». II va sans dire que certains traits de son passé restaient cachés au public.
[9] Voir Carnets de route de l’incendiaire du Reichstag et autres écrits, de Marinus van der Lubbe, éd. Verticales, 2003 ; Marinus van der Lubbe et l’incendie du Reichstag, de Nico Jassies, Editions antisociales, 2004 ; « L’acte personnel » et « La destruction comme moyen de lutte », d’Anton Pannekoek, Echanges n° 90 (printemps-été 1999).
[10] Traduction sur www.left-dis.nl/f/gictabma.htm. Un résumé sous le titre Principes de base, d’abord paru dans les nos 19, 20 et 21 de Bilan, a été publié dans le n° 11 des Cahiers du Communisme de Conseil.
[11] Sébastien Faure (1858-1942), Mon Communisme : le Bonheur universel, Paris 1921, page 227.
[12] Rudolf Hilferding, Das Finanzkapital, page 1. (Le Capital financier, trad. française aux Editions de Minuit,1970, épuisée.)