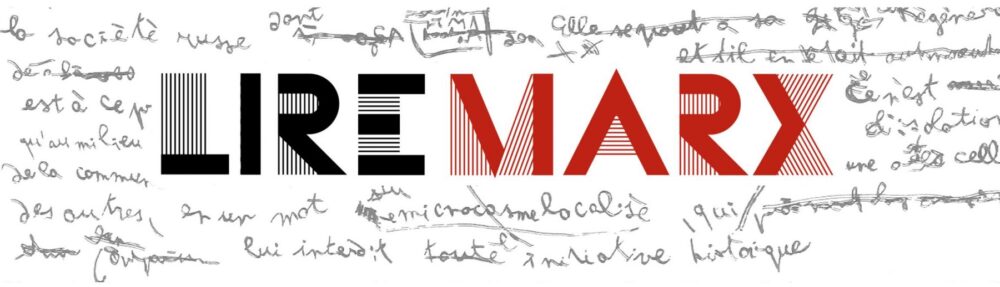Article paru sur le site agitationautonome.
Article paru sur le site agitationautonome.
Traduction d’un article de Michael Heinrich paru initialement dans le numéro de janvier/février 2002 de Blätter des iz3w Freiburg. L’auteur y traite de la conception marxienne de la monnaie, ce qui est l’occasion d’une confrontation avec la théorie économique néoclassique et la théorie keynésienne. Selon Heinrich, ces deux théories ont le défaut de concevoir la monnaie comme un simple moyen auxiliaire, ce qui les fait passer à côté du pouvoir réel de cette forme sociale particulière.
Une chose dotée d’une qualité supra-sensible, la monnaie comme rapport social
« Money makes the world go round » (l’argent fait tourner le monde). Dans le quotidien du capitalisme cette phrase se trouve pour le moins confirmée à tous les niveaux : que ce soit pour acheter une baguette pour le petit-déjeuner, pour investir dans une entreprise, ou bien cotiser pour la retraite, la question demeure de savoir si l’on a suffisamment d’argent, et si ce n’est pas le cas, où est-il possible d’en trouver. Il est toutefois surprenant que dans la théorie économique néoclassique, qui domine de façon quasi-absolue les universités et les conseils d’entreprise, on ne discute qu’à peine de la monnaie. Pour l’école néoclassique, qui apporte son fondement aux politiques économiques néolibérales, la monnaie est seulement un moyen de circulation, un moyen pratique pour faciliter l’échange utilisé comme une simple quantité sur laquelle une opération est exécutée. On lui dénie sa pertinence économique propre : d’un point de vue néoclassique, n’est vue comme décisive que sa grandeur « réelle », c’est à dire la quantité de marchandises qui sont produites, échangées, investies ou bien consommées. La sphère monétaire ne vaut que comme un voile, situé au-dessus de cette sphère « réelle ». S’il est possible que, par de mauvaises manipulations ce voile subisse des dommages de façon temporaire (lorsque par exemple, la banque centrale dépense trop d’argent et provoque une inflation), sur le long terme, ce sont toujours les rapports « réels » qui prévalent. Et, comme l’affirme la doctrine néoclassique dominante, à condition que le marché puisse produire ses effets sans entrave, une situation sociale optimale (un maximum de rendement aux prix les plus bas) doit s’installer,
Pour le keynésianisme, qui de nos jours ne joue qu’un rôle de second plan dans l’économie académique, la monnaie est d’une plus grande importance que pour l’école néoclassique. Elle ne se réduit pas à une fonction de moyen de circulation, plus que cela, sa qualité de moyen de conservation de la valeur est placée au premier plan et se combine aux rapports fondamentalement instables de l’économie de marché : la monnaie vaut ici comme l’assureur d’un avenir non assuré. Selon l’argumentation keynésienne, si l’insécurité augmente, alors plus d’argent est « maintenu liquide » , ce qui signifie que moins d’argent est dépensé par les foyers et les entreprises, ou investi sur le long terme, car pour ces derniers, l’argent ne doit pas manquer sur le court terme. De cela suit une augmentation des taux d’intérêt, et un affaiblissement des investissements, ce qui produit à son tour une baisse du revenu et une hausse du chômage. La théorie keynésienne ne connaît pas de processus automatique susceptible d’éliminer de telles crises, c’est pour cette raison qu’elle fait appel à l’État.
Certes, le keynésianisme envisage la monnaie d’une façon plus différentiée que l’école néoclassique, mais les deux théories ont en commun de la réduire largement à une unique fonction qu’ils considèrent comme essentielle. Pour les deux théories la monnaie est avant tout un moyen auxiliaire, tantôt insignifiant, tantôt important. La question de savoir ce qu’est au juste la monnaie, et dans quelles relations elle se trouve avec le mode spécifique de socialisation d’une société productrice de marchandise, n’est à aucun moment soulevée.

La monnaie, un simple instrument que l’on surestime ?
Or, c’est précisément cette question qui était centrale dans la confrontation de Marx avec la monnaie. Certains courants issus des mouvements ouvriers anglais et français du XIXe siècle voulaient réformer le capitalisme au travers d’une transformation du système monétaire : certes, la production marchande privée devait être conservée, mais la monnaie devait être remplacé par de simples bons horaires, ou encore par des coupons de marchandises (semblables à des billets pour le théâtre). Contre cela, Marx cherchait à montrer que c’est le mode de production bourgeois lui-même qui nécessite un moyen d’échange spécifique, à savoir la monnaie, (qui n’est justement pas aussi inoffensif qu’une place de théâtre).
Les producteurs privés de marchandises sont certes dans une relation sociale au travers de la division sociale du travail, mais leurs produits n’acquièrent un caractère social qu’en subissant l’épreuve du marché. Dans une société dominée par l’échange, le caractère social des produits ne repose pas simplement sur le fait qu’ils répondent aux besoins d’autrui ; les produits doivent se tenir les un les autres dans un rapport d’échange quantitatif, ils ne doivent pas simplement posséder une valeur d’usage, mais également une valeur. Dans la société bourgeoise, la richesse devient une grandeur abstraite : elle ne repose plus sur la multiplicité des valeurs d’usages et des plaisirs de la vie, mais sur une « valeur » abstraite. Cependant, la valeur ne s’appréhende pas au niveau d’une marchandise prise isolément, car elle n’existe qu’en relation avec d’autres marchandises. Dans le rapport d’échange avec une seule autre marchandise, la marchandise ne trouve son expression que d’une façon limitée et accidentelle, la valeur d’une marchandise ne peut recevoir une expression sociale générale que si elle se réfère à une figure autonome de la valeur c’est à dire à une chose qui ne fait pas face aux autres marchandises en tant que marchandise supplémentaire, mais comme une forme immédiate d’existence de la valeur. Ce n’est que dans cette relation qu’une marchandise isolée peut faire valoir un caractère de valeur indépendant de son caractère de valeur d’usage. La richesse abstraite nécessite elle-même une existence matérielle spéciale : celle-ci n’est autre que la monnaie.
Dans une société reposant sur l’échange, la monnaie n’est pas simplement un moyen d’échange d’une importance relative, c’est le médium nécessaire de la socialisation économique. Les producteurs marchands isolés ne créent, en tant que personnes, aucune relation économique, seuls leurs produits entrent en relation, et ce en tant que valeurs. C’est précisément parce que les personnes, en tant qu’individus isolés, disparaissent derrière leurs produits, que les rapports sociaux doivent, au sens propre du mot, se
« chosifier » , se fixer à une chose : la monnaie. La monnaie n’est donc pas seulement, comme le pensent les néoclassiques, un moyen de facilitation des échanges dont on pourrait en principe se passer, la monnaie est bien plutôt le seul médium par lequel le rapport social des producteurs isolés de marchandises peut s’établir.
Avec la monnaie, une chose acquière une propriété et un pouvoir social. Cette qualité « suprasensible » d’une chose, Marx la décrit comme un
« Fétichisme ». Un tel fétichisme n’est pas le simple fruit de l’imagination, ni non plus quelque chose relevant de la « fausse conscience » . Dans la société bourgeoise, la monnaie a effectivement le plus grand des pouvoirs. Toutefois, elle n’a ce pouvoir qu’en raison du rapport social spécifique sur lequel elle repose : celui entre des possesseurs atomisés de marchandises qui ne peuvent établir de rapports qu’à travers elle. La monnaie n’a son pouvoir que parce que tout le monde se réfère à la monnaie en tant que monnaie (c’est à dire comme figure autonome de la valeur) ; or, dans la mesure où les individus se comportent comme possesseurs de marchandises qui s’échangent leurs produits, ils n’ont d’autre choix que de se référer à la monnaie. Mais d’un autre côté, le fétichisme comporte aussi un élément d’illusion : le pouvoir social de la monnaie apparaît comme inhérent à celle-ci ; il échappe à la perception quotidienne que ce pouvoir n’est que le résultat d’un processus social achevé, processus qui disparaît dans son propre résultat.
La production marchande n’est donc pas possible sans la relation de la marchandise à la monnaie. Cela pose ainsi une limite fondamentale à tout projet utopique : qui veut supprimer la monnaie doit également supprimer les rapports sociaux qui font de celle-ci une nécessité. On ne peut avoir l’un sans l’autre.

De l’argent au capital
Si le procès de reproduction général de la société est médiatisé par la marchandise et l’argent, et si la production marchande ne mène pas d’existence marginale à l’intérieur d’un autre mode de production (comme ce fut le cas au Moyen-Âge en Europe), alors l’argent se transforme en capital : la figure autonome de la valeur,au travers de laquelle s’accomplit la socialisation économique des producteurs de marchandises, est devenue elle-même le premier but de l’activité économique. C’est précisément parce que l’argent est l’incarnation de la richesse abstraite (richesse qui ne connaît aucune limite immanente), que l’on ne peut prétendre en avoir
« suffisamment ». Le commerce et la production ne doivent pas seulement apporter de l’argent, mais de l’argent en quantités toujours plus grandes. La généralisation de la production marchande et de l’économie monétaire n’est possible que si la production se transforme en production capitaliste, que si l’accroissement de la richesse abstraite devient le but direct de la production, et que ce but soumet à lui tous les autres rapports sociaux. La
« force destructrice de l’argent », si souvent déplorée dans les modes de production pré-capitalistes (par exemple, par de nombreux auteurs de la Grèce antique), repose précisément sur ce processus de transformation capitaliste de la société fondée sur la généralisation des rapports monétaires. Les conceptions socialistes du marché, qui veulent abolir la production capitaliste (ou la remplacer par une société de coopératives), tout en conservant le marché, la production de marchandises et l’argent (en raison de leur « efficacité » en matière de production et d’innovation), se trouvent alors devant un problème fondamental : comment entendent-elles empêcher le retour d’une production sur un mode capitaliste sans diminuer cette « efficacité » du marché ?

Production capitaliste et marchés financiers
Puisque c’est par l’argent que s’établissent les relations sociales dans une société d’échange, c’est aussi au travers de l’argent que ces dernières peuvent être interrompues : comme le souligne déjà Marx dans les premiers chapitre du Capital, l’argent porte avec lui la « possibilité des crises ». Dans l’enchaînement marchandise-argent-marchandise (où l’on vend sa propre marchandise pour acquérir par la suite la marchandise d’autrui), l’argent n’est pas un simple médiateur de l’échange, il peut également rompre cette médiation : une vente à laquelle ne succède pas un achat (lorsque l’argent récolté lors de la vente ne sert pas pour un achat ultérieur), brise la chaîne de la reproduction. Aussitôt que cela arrive, les biens produits ne peuvent plus être écoulés, la production diminue ou est partiellement arrêtée. En conséquence,du capital non utilisé se tient d’un côté, et de la force de travail non employée de l’autre. Toutefois un certain nombre de circonstances supplémentaires sont nécessaires pour que la simple possibilité de la crise se transforme en crise réelle.
Pour le marxisme traditionnel, ces circonstances sont à trouver avant tout dans les conditions capitalistes de la production et dans la « loi de la baisse tendancielle du taux de profit ». En comparaison, la monnaie et le crédit ne jouent que des rôles secondaires en tant que simples « phénomènes de la circulation ». Une conception aussi simpliste de la production perd de vue non seulement le fait que la production marchande est impossible sans monnaie, mais également que la production capitaliste ne peut exister sans le crédit (et ses formes développées : monnaie de crédit, capital par action, etc.) : la flexibilité de la production capitaliste repose précisément sur le fait que l’accumulation ne se trouve pas limitée aux profits réalisées lors de la période antérieure, mais qu’à l’aide du crédit elle peut être étendue bien au-delà, ce qui implique aussi le risque de surproduction et de crise. Du crédit n’est cependant accordé qu’aux secteurs pour lesquels on attend des bénéfices importants dans le futur (ou plutôt seuls ces secteurs font appel au capital par action). En ce sens, tout le système financier est caractérisé par un moment spéculatif qui vient encore être renforcé par des instruments spécifiques comme les options (droits d’achat à un prix fixé à l’avance). Cela dit,toute production capitaliste comporte déjà par elle-même un moment spéculatif : un entrepreneur ne peut jamais savoir avec certitude si son produit sera vendu ni à quel prix, par conséquent il ne peut pas savoir si les investissements qu’il fait maintenant lui apporteront le profit escompté. Le crédit et la spéculation ne sont donc en aucun cas des moments qui seraient, pour ainsi dire, apportés de l’extérieur à une production capitaliste non-spéculative. Sans le secteur financier et la spéculation, la production capitaliste est impossible.
Ce lien n’est pas seulement à considérer plus fortement dans le cadre d’une théorie des crises que ne le fait le marxisme traditionnel, il prend également de l’importance face à la critique actuelle de la « mondialisation ». Cette dernière apparaissant souvent comme une critique d’un capitalisme « déchaîné » dont les forces destructrices seraient entraînées par le système financier. Que le système financier pose les normes de rentabilité, auxquelles les entreprises individuelles doivent se plier si elles veulent, elles aussi, recevoir des crédits dans le futur, cela n’est aucunement un phénomène nouveau. Le système financier a toujours eu une telle
« fonction de pilotage ». Ce qui a changé en revanche, c’est que lors de ces dernières décennies, un système financier internationalisé s’est largement institué, dictant de plus en plus des normes internationales de la valorisation du capital. Qui voit dans l’augmentation de la spéculation dans les marchés financiers la cause principale des maux d’un capitalisme,qu’il faudrait par conséquent réguler, déchire le lien nécessaire entre système financier et production capitaliste, ce qui revient — du moins tendanciellement — à opposer un « bon » capitalisme productif à un
« mauvais » capitalisme de spéculation. Bien que la question ne soit pas réglée de savoir de quelle façon il serait possible de réguler le système financier international, pour contrôler efficacement les flux de capitaux — et à cet égard les demandes faites par les « critiques de la mondialisation » d’une plus grande régulation ne sont pas d’emblée irréalistes ou inapplicable — on peut toutefois douter que les satisfaire ferait disparaître les aspects négatifs du capitalisme. Même dans un capitalisme régulé, les buts de l’activité économique ne sont ni la satisfaction des besoins et la suppression des inégalités sociales ni non plus la vie bonne, mais la valorisation de la valeur et l’accumulation de la richesse abstraite. Face à ce but, les êtres humains et la nature ne sont que de simples moyens et sont donc traités en conséquence.