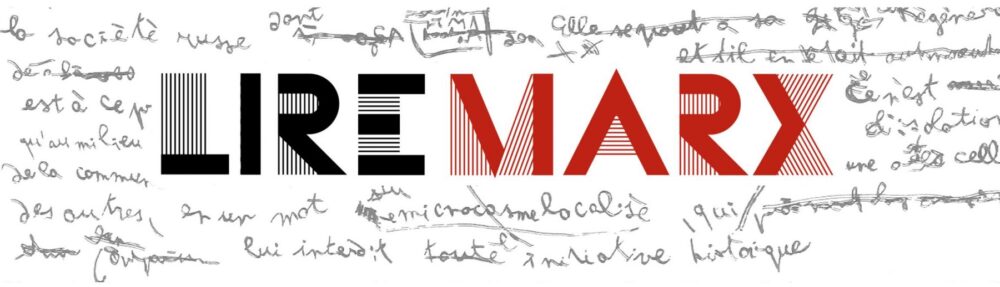L’éditorial du n° 179 de la « Gazette de Cologne »
Karl Marx
Juillet 1842
Cet article de Karl Marx a paru dans la Gazette rhénane n° 191, 193 et 195 des 10, 12 et 14 juillet 1842. Traduit d’après Karl Marx-Friedrich Engels : Œuvres, tome I, Berlin, 1958, pp. 86 à 104.
Dans les années 30 et au début des années 40 du XIXe siècle, la Gazette de Cologne défendait l’Eglise catholique contre le protestantisme, religion dominante en Prusse. Le publiciste réactionnaire Karl Heinrich Hermes, agent du gouvernement prussien, devint, en 1842, rédacteur politique de ce journal, qui engagea alors une bataille furieuse contre la Gazette rhénane rédigée par Marx.
Source : Karl Marx, Friedrich Engels, SUR LA RELIGION, Textes choisis, traduits et annotés par G. Badia, P. Bange et Émile Bottigelli (1968) en pdf: ici
Nous honorions jusqu’ici dans la Gazette de Cologne, sinon « le journal des intellectuels rhénans », du moins « la feuille d’annonces rhénane » 1. Nous considérons par excellence ses « éditoriaux politiques » comme un moyen aussi sage que choisi de dégoûter le lecteur de la politique afin qu’il aille se plonger avec d’autant plus de nostalgie dans la fraîcheur, la vie, le bouillonnement industrieux, l’esprit pétillant des petites annonces afin que se vérifie dans ce cas aussi la maxime : per aspera ad astra 2, par la politique jusqu’aux huîtres 3. Mais le bel équilibre que la Gazette de Cologne avait su maintenir jusqu’ici entre la politique et les annonces 4, a été troublé dans la dernière période par une catégorie d’annonces que l’on peut appeler les « annonces de l’industrie politique ». Ne sachant pas très bien au début où ce nouveau genre devait prendre place, on n’a pu éviter qu’une annonce se transformât en éditorial et l’éditorial en annonce, je veux dire en une de ces annonces que, dans le monde politique, on nomme une « dénonciation », mais qui, si elle est payée, s’appelle tout bonnement une « annonce » d’indicateur.
On a coutume, dans le Nord, avant les repas maigres, de faire servir aux hôtes des liqueurs exquises. Nous nous plions, à l’égard de notre hôte nordique, à cette coutume de servir les spiritueux avant le repas, avec d’autant plus d’empressement que nous constatons l’absence totale d’esprit 5 dans le plat lui-même, le très pitoyable 6 article du n° 179 de la Gazette de Cologne. Aussi commencerons-nous par servir une scène des Dialogues des dieux de Lucien, que nous donnons dans une traduction « accessible à tous 7 », car parmi nos lecteurs il s’en trouvera au moins un qui n’est pas Grec.
LUCIEN : DIALOGUES DES DIEUX
XXIV. — Les plaintes d’Hermès 8.
Hermès. — Y a-t-il vraiment dans le ciel un dieu plus malheureux que moi, ma mère ?
Maïa. — Garde-toi, Hermès, de tenir de tels propos.
Hermès. — Pourquoi m’en garderais-je, lorsque j’ai tant d’affaires sur les bras, que je suis seul à peiner et que je suis tiraillé entre tant de fonctions ! Dès le point du jour, il faut que je me lève pour balayer la salle de festin, mettre des housses aux lits de tables, arranger chaque chose, puis me tenir à la disposition de Zeus et porter ses messages en courant tout le jour par monts et par vaux et, à peine de retour, encore couvert de poussière, servir l’ambroisie. Avant l’arrivée de cet échanson dont il a fait récemment emplette, c’est de plus en plus terrible, c’est que, seul de tous les dieux, je ne dors même pas la nuit ; même alors il faut que je conduise les âmes à Pluton, que je guide les morts et que je me tienne près du tribunal. Ce n’est pas assez pour moi de travailler le jour, d’être dans les palestres, de faire office de héraut dans les assemblées, de donner des leçons aux orateurs : il faut encore que je prenne part à l’administration de tout ce qui concerne les morts.
Depuis qu’il a été chassé de l’Olympe, Hermès, c’est une vieille habitude, continue à « assurer le service d’un domestique » et à s’occuper de tout ce qui concerne les morts.
Est-ce Hermès en personne, ou son fils Pan, le dieu-bouc, qui a écrit l’article de bête 9 du n° 179, au lecteur d’en décider ; mais qu’il oublie par que l’Hermès grec était le dieu de l’éloquence et de la logique.
Il nous paraît également inadmissible de répandre par le canal des journaux ou de combattre dans les journaux les opinions philosophiques ou religieuses.
En entendant le vieillard bavarder ainsi, j’ai bien remarqué qu’il avait l’intention de nous débiter une ennuyeuse litanie d’oracles ; mais, me suis-je dit pour calmer mon impatience, comment ne pas croire cet homme perspicace, assez indépendant pour exprimer, dans sa propre maison, son opinion en toute franchise ? Et j’ai continué à lire. Mais, ô miracle, cet article, auquel on ne peut certes reprocher la moindre opinion philosophique, a, du moins, tendance à combattre des opinions philosophiques et à répandre des opinions religieuses.
Que peut bien nous importer un article qui conteste son propre droit à l’existence, qui se fait précéder d’une auto-déclaration d’incompétence ? C’est l’auteur prolixe qui va nous répondre. Il nous explique comment il faut lire ses articles prétentieux. Il se borne à donner des fragments qu’il laisse « à la perspicacité des lecteurs » le soin de « juxtaposer et de relier », ce qui est la méthode la mieux appropriée à cette sorte d’annonces dont il fait commerce. Nous allons « juxtaposer et relier » et ce n’est pas notre faute si le rosaire ne se transforme pas en couronne de roses.
L’auteur déclare ce qui suit :
Un parti qui utilise de tels moyens [c’est-à-dire qui répand et combat dans les journaux des opinions philosophiques et religieuses] montre par là, à notre avis, que ses intentions ne sont pas honnêtes et qu’il lui importe moins d’instruire et d’éclairer le peuple que d’atteindre d’autres objectifs extérieurs.
Si tel est son avis, l’article en question ne peut avoir d’autre intention que d’atteindre des objectifs extérieurs. Ces « objectifs extérieurs » ne vont pas tarder à se révéler.
L’Etat, lit-on encore, n’a pas seulement le droit, mais le devoir « de couper court aux menées des bavards non qualifiés ». L’auteur veut parler des adversaires de son opinion ; car depuis bien longtemps il est d’accord avec lui-même sur ce point : il est, lui, un bavard qualifié.
A notre avis, ce n’est pas une sévérité exagérée, mais plutôt un excès d’indulgence que l’on peut reprocher à l’Etat.
Mais l’éditorial se ravise. Il est dangereux de faire des reproches à l’Etat ; aussi se tourne-t-il vers les autorités, son accusation contre la liberté de la presse se transforme en accusation contre les censeurs ; il accuse les censeurs d’appliquer trop « peu de censure ».
Dans ce domaine aussi, sinon l’Etat, du moins certaines autorités, ont fait montre, jusqu’aujourd’hui, d’une indulgence blâmable en laissant la nouvelle école philosophique se permettre, dans des feuilles publiques et dans d’autres écrits qui ne sont pas seulement destinés à un cercle de lecteurs scientifiques, les sorties les plus indignes contre le christianisme.
De nouveau l’auteur s’arrête et de nouveau il se ravise, il a trouvé, il y a moins de huit jours, trop peu de liberté de la presse dans la liberté de censure ; il trouve maintenant dans la rigueur des censeurs trop peu de contrainte par la censure.
Il faut arranger cela :
Aussi longtemps qu’il existera une censure, c’est son devoir le plus pressant que d’interdire les excès d’une outrecuidance puérile aussi dégoûtants que ceux qui, à plusieurs reprises ces derniers jours, ont offensé nos regards.
Quelle vue basse ! Quelle vue basse ! 10 Et « la vue la plus basse sera offensée d’une tournure que l’entendement de la grande masse » aura seul incité à employer.
Si la censure adoucie laisse passer des excès dégoûtants, que donnera alors la liberté de la presse ? Si nos yeux sont trop faibles pour supporter « l’outrecuidance » 11 de la presse censurée, comment seraient-ils assez forts pour supporter le courage de la presse libre ?
« Aussi longtemps qu’il existera une censure, c’est son devoir le plus pressant. » Et dès lors qu’elle n’existera plus ? La phrase doit être interprétée de la manière suivante : le devoir le plus pressant de la censure est de se maintenir aussi longtemps que possible.
Et de nouveau l’auteur se ravise.
Ce n’est pas notre office de jouer le rôle d’accusateur public, aussi nous abstiendrons-nous de désigner quiconque avec plus de précision.
Quel ange de bonté que cet homme ! Il s’abstient de « désigner » avec plus de précision et ce n’est que par des signes très précis, très nets qu’il pourrait prouver et montrer où tend son opinion ; il laisse tomber seulement des paroles vagues, indistinctes, qui éveillent les soupçons ; ce n’est pas son office d’être accusateur public, c’est son office d’être accusateur caché.
Pour la dernière fois le malheureux homme s’avise que son office c’est d’écrire des éditoriaux libéraux, qu’il doit jouer le rôle du « loyal partisan de la liberté de la presse » ; il adopte donc une dernière position.
Nous n’avions pas le droit de ne pas protester contre une façon d’agir qui, si elle n’est pas la conséquence d’une négligence non préméditée, ne peut avoir d’autre but que de compromettre une plus grande liberté de mouvement de la presse aux yeux de l’opinion publique, pour faire le jeu de ses adversaires qui craignent de ne pouvoir atteindre leur objectif par des voies directes.
C’est la censure, nous apprend ce défenseur aussi hardi que sagace de la liberté de la presse, qui, si elle n’est pas le léopard anglais porteur de l’inscription : « I sleep, wake me not » 12, a agi de la sorte afin de compromettre une plus grande liberté de mouvement de la presse aux yeux de l’opinion publique.
Et un mouvement de la presse qui attire l’attention de la censure sur des « négligences non préméditées », qui attend sa renommée dans l’opinion publique des « ciseaux du censeur », a-t-il besoin, lui, d’être compromis davantage ?
On peut qualifier un tel mouvement de « libre », comme on dit aussi parfois que l’impudence est « sans bornes », et n’est-ce pas l’impudence de la sottise et de l’hypocrisie que se faire passer pour le défenseur d’une plus grande liberté de mouvement de la presse alors que l’on affirme sentencieusement que la presse roulerait instantanément dans le ruisseau, si deux gendarmes ne la soutenaient.
Et qu’avons-nous besoin de la censure, qu’avons-nous besoin de cet article de tête, s’il est vrai que la presse philosophique se compromet elle-même aux yeux de l’opinion publique ? Certes, l’auteur ne veut pas le moins du monde limiter « la liberté de la recherche scientifique ».
De nos jours la recherche scientifique jouit à juste titre du champ le plus vaste, le plus illimité.
Quant à la conception qu’a notre homme de la recherche scientifique, la déclaration suivante le montre :
Mais il faut établir une nette distinction entre ce qu’exige la liberté de la recherche scientifique qui ne peut que profiter au christianisme lui-même, et ce qui dépasse les bornes de la recherche scientifique.
Qui décidera des bornes de la recherche scientifique, si ce n’est la recherche scientifique elle-même ! Aux termes de l’article de tête, il faut prescrire des limites à la science. L’éditorial connaît donc une « raison officielle », qui n’a rien à apprendre de la recherche scientifique, mais lui donne des leçons, qui, savante providence, mesure la longueur de chaque poil, susceptible de faire d’une barbe scientifique une barbe laïque. L’éditorial croit à l’inspiration scientifique de la censure.
Avant de continuer à suivre ces « niaises » élucubrations de l’éditorial sur la « recherche scientifique », goûtons un instant quelques échantillons de la « philosophie religieuse » de Monsieur H[ermès], de sa « propre science » !
La religion est le fondement de l’Etat, comme elle est la condition la plus indispensable de tout groupement social qui ne vise pas seulement à quelque but superficiel !
Preuve : même sous sa forme la plus grossière, le fétichisme puéril, elle élève dans une certaine mesure l’homme au-dessus des désirs des sens, qui le ravalent au rang de l’animal s’il se laisse dominer exclusivement par eux, et le rendent incapable de réaliser tout dessein supérieur.
L’éditorial appelle le fétichisme « la forme la plus grossière » de la religion. Il concède donc, ce qui pour tous les hommes de la « recherche scientifique » est, qu’il le veuille ou non, un fait établi, que la « zoolâtrie » est une forme religieuse supérieure au fétichisme ; et la zoolâtrie ne ravale-t-elle pas l’homme au-dessous de l’animal, ne fait-elle pas de l’animal un dieu pour l’homme ?
Et maintenant, passons au « fétichisme » ! Quelle érudition pour magazine à deux sous ! Le fétichisme est si éloigné d’élever l’homme au-dessus du désir qu’il est, au contraire, « la religion du désir des sens ». L’imagination née du désir donne au fétichisme l’illusion qu’un « objet inanimé » va abandonner son caractère naturel pour approuver ses convoitises. D’où le fait que le désir grossier du fétichiste brise le fétiche lorsque celui-ci cesse d’être le serviteur très docile de ce désir.
Chez les nations qui ont atteint une importance historique supérieure, l’apogée de leur vie politique coïncide avec l’épanouissement suprême de leur sens religieux, la décadence de leur grandeur et de leur puissance avec la décadence de leur culture religieuse.
C’est en retournant exactement l’affirmation de l’auteur, qu’on obtient la vérité ; il a mis l’histoire la tête en bas. La Grèce et Rome son bien, n’est-ce pas, les pays de la plus haute « civilisation historique » parmi les peuples de l’antiquité. L’apogée de la Grèce à l’intérieur a lieu à l’époque de Périclès, à l’extérieur à l’époque d’Alexandre. A l’époque de Périclès, les sophistes, Socrate (que l’on peut appeler l’incarnation de la philosophie), l’art et la rhétorique avaient évincé la religion. L’époque d’Alexandre fut celle d’Aristote, qui rejeta l’idée de l’éternité de l’esprit « individuel » et le dieu des religions positives. Et Rome, maintenant ! Lisez Cicéron ! Les philosophes épicurienne, stoïcienne ou sceptique étaient les religions des Romains cultivés, alors que Rome avait atteint le point culminant de son histoire. Si la chute des Etats de l’antiquité entraîne la disparition des religions de ces Etats, il n’est pas besoin d’aller chercher d’autre explication, car la « vraie religion », des Anciens était le culte de « leur nationalité », de leur « Etat ». Ce n’est pas la ruine des religions antiques qui a entraîné la chute des Etats de l’antiquité, mais la chute des Etats de l’antiquité qui a entraîné la ruine des religions antiques. Et quelqu’un de l’ignorance dont fait preuve l’éditorial se proclame « législateur de la recherche scientifique » et prescrit des « décrets » à la philosophie.
Tout le monde antique était condamné à l’effondrement parce qu’avec les progrès que faisaient les peuples dans leur formation scientifique allait nécessairement de pair la découverte des erreurs sur lesquelles reposaient leurs conceptions religieuses.
Ainsi selon l’éditorial tout le monde antique disparut parce que la recherche scientifique dévoila les erreurs des religions antiques. Le monde antique n’aurait-il pas disparu, si la recherche avait passé les erreurs des religions sous silence, si les ouvrages de Lucrèce et de Lucien avaient été recommandés par l’auteur de l’éditorial à la censure des autorité romaines ?
Nous nous permettons au reste d’accroître d’une courte note l’érudition du sieur H[ermès].
Au moment même où la chute du monde antique était imminente, s’ouvrit l’école d’Alexandrie 13 qui s’ingéniait à toute force de démontrer « la vérité éternelle » de la mythologie grecque et son accord constant « avec les résultats de la recherche scientifique ». L’empereur Julien appartenait lui aussi encore à cette tendance, qui croyait faire disparaître l’esprit du temps dont l’aube se levait, en se bouchant les yeux pour ne pas le voir. Mais arrêtons-nous au résultat obtenu par H[ermès] ! Dans les religions antiques « le vague pressentiment du divin était voilé par les ténèbres les plus épaisses de l’erreur » et ne pouvait de ce fait résister aux découvertes scientifiques. Dans le christianisme, c’est tout le contraire, affirmera n’importe quelle mécanique pensante. Et de fait H[ermès] déclare :
Les plus hauts résultats de la recherche scientifique n’ont servi jusqu’ici qu’à confirmer les vérités de la religion chrétienne.
Abstraction faite de ce que toutes les philosophies du passé sans exception ont été accusées l’une après l’autre par les théologiens d’apostasier la religion chrétienne, même celle du pieux Malebranche et de l’inspiré Jacob Böhme, de ce que Leibniz a été accusé d’être un mécréant 14 par les paysans du Brunswick et d’être un athée de l’Anglais, Clarke et les autres partisans de Newton ; abstraction faite de ce que, comme l’affirme la fraction la plus éminente et la plus conséquente des théologiens protestants, il ne peut y avoir de concordance entre le christianisme et la raison, parce que la raison « temporelle » et la raison « spirituelle » se contredisent, ce que Tertulien exprime de la manière classique suivante : « verum est, quia absurdum est » 15 ; abstraction faite de tout cela, comment démontrer la concordance de la recherche scientifique et de la religion, sinon en obligeant la recherche scientifique à se fondre dans la religion en la laissant poursuivre sa propre démarche. Toute autre contrainte ne saurait en tout cas, être une preuve.
Ah ! bien sûr, dès l’abord, vous ne reconnaissez comme recherche scientifique que ce qui est votre façon de voir, il vous est facile de prophétiser ; mais en quoi votre affirmation est-elle alors plus valable que celle du brahmine indien qui démontre la sainteté des Védas 16 en se réservant à lui seul le droit de les lire !
H[ermès] dit bien « recherche scientifique ». Mais toute recherche qui contredit le christianisme, « s’arrête à mi-chemin » ou « fait fausse route ». Peut-on se rendre la démonstration plus commode ?
La recherche scientifique, à condition de s’expliquer à elle-même le contenu de ses découvertes n’entrera jamais en conflit avec les vérités du christianisme, mais, en même temps, l’Etat doit veiller à ce que cette « explication » soit impossible, car la science ne doit jamais s’adresser à la compréhension de la grande masse, c’est-à-dire qu’elle ne doit jamais s’expliquer à elle-même et devenir populaire. Même si elle est attaquée dans les journaux du royaume par des chercheurs non-scientifiques, elle doit demeurer modeste et se taire.
Le christianisme exclut la possibilité de « toute nouvelle décadence », mais la police doit veiller à ce que les journalistes philosophiques ne provoquent point cette décadence et y veiller avec la plus grande rigueur. Dans le combat contre la vérité, on reconnaîtra spontanément l’erreur pour telle, sans qu’il soit besoin de la réprimer par une force extérieure ; mais l’Etat doit faciliter ce combat de la vérité en privant les champions de « l’erreur » non pas de la liberté intérieure, dont il ne peut les priver, mais bien en leur ôtant ce qui rend possible cette liberté, la possibilité d’exister.
Le christianisme est sûr de sa victoire, mais, selon H[ermès] il n’en est pas si sûr qu’il en dédaigne l’aide de la police.
Si, a priori, tout ce qui contredit votre foi est erreur et doit être traité comme tel, qu’est-ce qui distingue votre prétention de la prétention du mahométan, de la prétention de toute autre religion ? La philosophie doit-elle, en vertu du dicton « autre pays, autres mœurs », admettre pour chaque pays, d’autres principes fondamentaux afin de ne pas entrer en conflit avec les vérités fondamentales du dogme ; doit-elle croire dans un pays que 3 fois 1 font 1, dans l’autre que les femmes n’ont pas d’âme, dans le troisième qu’on boit de la bière au paradis ? N’y a-t-il pas une nature humaine universelle, comme il y a une nature universelle des plantes et des astres ? La philosophie s’interroge sur ce qui est vrai, non sur ce qui est valable ; elle s’interroge sur ce qui est vrai pour tous les hommes, non sur ce qui est vrai pour quelques individus ; ses vérités métaphysiques ne connaissent pas les frontières de la géographie politique ; ses vérités politiques savent trop bien où les « frontières » commencent pour confondre l’horizon illusoire d’une conception particulière du monde et du peuple avec le véritable horizon de l’esprit humain. De tous les défenseurs du christianisme, H[ermès] est le plus faible.
La longueur de l’existence du christianisme est son unique preuve en faveur du christianisme. La philosophie de Thalès aussi, n’existe-t-elle pas jusqu’aujourd’hui, et selon H[ermès], n’a-t-elle pas, actuellement des prétentions et une opinion de son importance plus grandes que jamais ?
Comment H[ermès] apporte-t-il enfin la preuve que l’Etat est un Etat « chrétien », que sa fin est, au lieu d’une association libre d’êtres moraux, une association de croyants, au lieu de la réalisation de la liberté, la réalisation du dogme. « Tous nos Etats européens ont le christianisme pour bases. »
L’Etat français aussi ? La Charte 17, article 3 ne dit pas : « tout chrétien », ou « seul le chrétien », mais : « tous les Français sont également admissibles aux emplois civils et militaires » 18.
Dans le Code civil prussien également, deuxième partie, titre XIII 19, etc, on lit :
Le premier devoir du chef de l’Etat est de maintenir le calme et la sécurité aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur et de protéger tout individu et ses biens contre la violence et les troubles.
Selon le paragraphe 1, le chef de l’Etat réunit en sa personne tous les « devoirs et droits de l’Etat ». On ne dit pas que le premier devoir de l’Etat soit d’assurer la répression des hérésies et le bonheur de l’autre monde.
Mais s’il est vrai que quelques Etats européens sont fondés sur la christianisme, ces Etats répondent-ils à leur concept, « la simple existence » d’un état de fait le légitime-t-elle en droit ?
Selon notre H[ermès], sans aucun doute, car il rappelle aux Jeunes Hégéliens
que, selon les lois en vigueur dans la plus grande partie de l’Etat, un mariage sans consécration religieuse est regardé comme concubinage et, à ce titre, puni par la police.
Donc si « le mariage sans consécration religieuse » est regardé sur les bords du Rhin, selon le code Napoléon, comme « un mariage », et sur les bords de la Sprée, selon le Code civil prussien, comme un « concubinage », la punition « par la police » est un argument aux mains du « philosophe » pour démontrer qu’ici est juste ce qui est là une injustice, que ce n’est pas le code Napoléon, mais le Code civil prussien qui a l’apanage du concept scientifique et moral, du concept rationnel du mariage. Cette « philosophie des punitions par la police » peut emporter ailleurs la conviction, en Prusse, elle ne convainc pas. Au reste, pour voir à quel point le Code civil prussien a peu tendance à imposer des mariages « sacrés », lisons le § 12, deuxième partie, titre 1 :
Néanmoins un mariage, autorisé par les lois du pays, ne perd rien de sa validité civile, du fait que la dispense des autorités ecclésiastiques n’a pas été requise ou a été refusée.
Ici aussi le mariage est partiellement émancipé des « autorités ecclésiastiques » et on distingue sa validité « civile » de sa validité « religieuse ».
Que notre grand philosophe d’Etat chrétien n’ait pas une « haute » opinion de l’Etat, cela va de soi.
Comme nos Etats ne sont pas seulement des syndicats de défense des droits, mais en même temps de véritables établissements d’éducation qui, étendant leurs soins, c’est toute la différence, plus loin que les établissements destinés à l’éducation de la jeunesse, [etc…] l’éducation publique tout entière [repose] sur la base du christianisme.
L’éducation de notre jeunesse scolaire se fonde tout autant sur les classiques de l’antiquité et sur les sciences en général que sur le catéchisme.
L’Etat, d’après H[ermès], se distingue d’une pouponnière non par le contenu, mais par l’extension, il étend ses « soins » plus loin.
Or la véritable éducation « publique » de l’Etat réside au contraire dans l’existence rationnelle et publique de l’Etat ; l’Etat lui-même éduque ses membres en faisant d’eux de véritables membres de l’Etat, en transformant les buts individuels en buts généraux, l’instinct grossier en inclination morale, l’indépendance naturelle en liberté intellectuelle, en faisant que l’individu s’épanouisse dans la vie de l’ensemble et que l’ensemble vive dans l’esprit de l’individu.
Notre éditorial, par contre, fait de l’Etat, non une association d’hommes libres qui font mutuellement leur éducation, mais un troupeau d’adultes destinés à recevoir leur éducation d’en haut, et à passer de la salle de classe « étroite » dans la salle de classe « plus vaste ».
Cette théorie de l’éducation et de la mise en tutelle, c’est un partisan de la liberté de la presse qui l’expose, et qui, par amour pour cette belle, note les « négligences de la censure », qui s’entend à dépeindre à qui de droit « la compréhension de la masse » — (peut-être la compréhension de la masse apparaît-elle depuis peu, si précaire à la Gazette de Cologne parce que la masse ne comprend plus désormais les mérites de la Gazette non-philosophique ?) —, qui conseille aux savants d’avoir une opinion pour la scène et une autre opinion pour les coulisses !
Comme il nous a instruit sur sa conception mesquine de l’Etat, nous allons maintenant demander à l’éditorial de nous documenter sur sa basse opinion « du christianisme ».
Tous les articles de journaux du monde ne convaincront jamais une population, qui, dans l’ensemble, se sent bien et est heureuse de se trouver dans une situation funeste.
Et comment ! Le sentiment matériel du bien-être et du bonheur résiste mieux aux articles de journaux que la confiance bienheureuse et toujours victorieuse qu’inspire la foi ! H[ermès] ne chante pas : « Dieu est notre citadelle, notre refuge ». L’âme vraiment croyante de la « grande masse » serait donc plus exposée à la rouille du doute que la culture laïque raffinée du « petit nombre » !
« Même des provocations à l’émeute », sont pour H[ermès] moins redoutables « dans un Etat bien ordonné » que dans une « Eglise bien ordonnée », conduite par-dessus la marché, par « l’esprit de Dieu » vers la vérité. Un beau croyant ! et en voici maintenant la raison !… Les articles politiques seraient en effet accessibles à la masse, les articles philosophique lui seraient incompréhensibles !
Si, pour finir, on rapproche le clin d’œil de l’éditorial : « les demi-mesures que l’on a prises dans la dernière période contre les jeunes Hégéliens, ont eu les effets habituels de demi-mesures »,, du vœu loyal que les dernières entreprises des Hégéliens puissent ne pas avoir de « conséquences trop défavorables » pour eux, on comprend les paroles de Cornwall dans Le Roi Lear :
Il ne saurait flatter, lui !… c’est une âme honnête et franche : il faut qu’il dise la vérité. Si elle est bien reçue, tant mieux ; sinon, n’accusez que son franc-parler. Je connais de ces drôles qui, dans leur franchise, recèlent plus d’astuce et de pensées corrompues que vingt naïfs faiseurs de courbettes qui se confondent en hommages obséquieux 20.
Nous croirions faire injure aux lecteurs de la Gazette rhénane, si nous les croyions satisfaits du spectacle, plus comique que sérieux, qu’offre un ci-devant libéral, « un jeune homme d’autrefois » 21 rejeté dans les limites qui lui conviennent ; nous voulons dire quelques mots « sur le fond même de l’affaire ». Tant que nous étions occupés à polémiquer contre l’article de bête, c’eût été une faute de l’interrompre dans son œuvre d’autodestruction.
Tout d’abord se pose la question : « la philosophie doit-elle discuter les problèmes religieux également dans des articles de journaux ? »
On ne peut donner de réponse à cette question qu’en en faisant la critique.
La philosophie, surtout la philosophie allemande, a un penchant pour la solitude, pour l’isolement systématiquement, pour la froide contemplation de soi, qui l’oppose et la rend dès l’abord étrangère aux journaux, prompts à la riposte, pleins du bruit des événements du jour, qui ne réalisent leur caractère propre que dans la communication. La philosophie, prise dans son développement systématique, est non-populaire, son activité mystérieuse repliée sur elle-même apparaît à l’œil profane comme une occupation aussi extravagante que dépourvue de valeur pratique ; la philosophie passe pour un professeur de magie, dont les incantations semblent pleines de solennité parce qu’on ne les comprend pas.
La philosophie, de par son caractère, n’a jamais fait le premier pas pour échanger l’habit ascétique du prêtre contre le léger costume de convention des journaux. Seulement les philosophes ne poussent pas comme les champignons, ils sont les fruits de leur époque, de leur peuple, dont les humeurs les plus subtiles, les plus précieuses et les moins visibles circulent dans les idées philosophiques. C’est le même esprit qui édifie les systèmes philosophiques dans le cerveau des philosophes et qui construit les chemins de fer avec les mains des ouvriers. La philosophie n’est pas hors du monde, pas plus que le cerveau n’est extérieur à l’homme même s’il n’est pas dans son estomac ; mais il est sûr que la philosophie a pris contact avec le monde par le cerveau avant de toucher le sol avec ses pieds, tandis que maintes autres sphères humaines ont depuis longtemps leurs pieds bien plantés sur la terre, et de leurs mains cueillent les fruits du monde, avant de se douter que la « tête » aussi fait partie de ce monde, ou que ce monde est celui de la tête.
Parce que toute vraie philosophie est la quintessence intellectuelle de son époque, le temps doit venir nécessairement où la philosophie, non seulement intérieurement par sa manifestation, entrera en contact avec le monde réel de son époque et établira avec lui des échanges réciproque. La philosophie cessera alors d’être un système déterminé face à d’autres systèmes déterminés, elle deviendra la philosophie en général face au monde, elle deviendra la philosophie du monde actuel. Les signes extérieurs qui dénotent que la philosophie atteint cette importance, qu’elle devient l’âme vivante de la culture, que la philosophie devient « de ce monde » et que ce monde devient philosophique, ont été les mêmes à toutes les époques ; on peut ouvrir n’importe quel livre d’histoire, et l’on verra se répéter avec une fidélité inaltérable les rites les plus simples qui marquent, sans qu’on puisse s’y méprendre, son entrée dans les salons et les presbytères, dans les salles de rédaction des journaux et dans les antichambres des cours, dans le cœur rempli de haine ou d’amour des contemporains. L’entrée de la philosophie dans le monde est marquée par les cris de ses ennemis qui trahissent la contagion interne par les appels sauvages de détresse qu’ils lancent contre l’incendie allumé par les idées. Ces cris de ses ennemis, ont, pour la philosophie, la même importance que le premier vagissement d’un enfant à l’oreille inquiète de la mère. C’est le cri qui lui annonce que ses idées sont vivantes, qu’elles ont fait éclater la carapace sans défaut d’hiéroglyphes que formait le système, et qu’elles se sont métamorphosées en citoyens du monde. Les Corybantes et les Cabires 22, qui annoncent au monde à grand fracas la naissance de l’enfant Zeus, se tournent tout d’abord contre la partie religieuse des philosophies ; parce que c’est sur ce côté sentimental du public que l’instinct inquisiteur sait, avec le plus de sûreté, trouver appui ; aussi parce que le public, dont font partie aussi les adversaires de la philosophie, ne peut atteindre la sphère idéale de la philosophie que par des antennes idéales et que l’unique cercle d’idées à la valeur duquel le public croit presque autant qu’aux systèmes des besoins matériels, est le cercle des idées religieuses ; enfin parce que la religion ne polémique pas contre tel système déterminé de la philosophie, mais contre la philosophie en général des systèmes déterminés.
La philosophie vraie du présent ne connaît pas un sort différent de celui des philosophies vraies du passé. Ce destin est, au contraire, une preuve dont l’histoire était redevable à sa vérité.
Et depuis six ans les journaux allemands ont battu la charge, calomnié, dénaturé, mutilé 23 la partie religieuse de la philosophie. La Gazette générale d’Augsbourg a chanté les morceaux de bravoure, presque chaque ouverture reprenait ce thème : la philosophie ne mérite pas d’être commentée par la dame pleine de sagesse que je suis, elle n’est qu’une gasconnade pour jeunes gens, un article de mode pour coteries de snobs. Oui, mais malgré tout, on ne pouvait se débarrasser d’elle et on se remettait sans cesse à battre le tambour ; car la Gazette d’Augsbourg ne joue que d’un instrument dans ces cacophonies antiphilosophiques : la monotone grosse caisse. Toutes les feuilles allemandes, depuis l’Hebdomadaire politique berlinois et le Correspondant de Hambourg jusqu’aux feuilles de choux, jusqu’à la Gazette de Cologne retentirent des noms de Hegel et Schelling, Feuerbach et Bauer, des Annales allemandes, etc… Pour finir le public fut pris du désir de voir lui-même ce Léviathan, et d’un désir d’autant plus vif que des articles officieux menaçaient de dicter à la philosophie, depuis les chancelleries, le schéma de la ligne qu’il lui serait légitime de suivre ; et ce fut juste le moment où la philosophie fit son apparition dans les journaux. Pendant longtemps la philosophie avait gardé le silence vis-à-vis des journalistes prétentieux et superficiels qui se targuaient de faire disparaître d’un souffle, comme bulles de savon, en quelques pâles phrases insipides, les études poursuivies pendant des années par le génie, les fruits d’une solitude laborieuse et pleine d’abnégation, les résultats de ces combats de la méditation, combats invisibles mais qui rongent lentement les forces du philosophe ; la philosophie avait même protesté contre les journaux où elle voyait un terrain inadéquat, mais pour finir la philosophie dut rompre son silence, elle se fit correspondant de journaux et — diversion inouïe — voilà que, tout à coup, il vient à l’esprit des fournisseurs bavards de copie journalistique que la philosophie n’est pas une pâture pour le public des journaux et ils ne purent s’empêcher d’attirer l’attention des gouvernements sur le fait qu’il était malhonnête de faire entrer les questions philosophiques et religieuses dans le domaine journalistique et ce, non pour éclairer le public, mais pour atteindre des buts extérieurs.
Qu’est-ce que la philosophie pourrait dire de la religion ou d’elle-même, qui fût pire et plus frivole que ce que vos hurlements journalistiques lui ont imputé depuis longtemps ? Elle n’a qu’à répéter ce que vous avez prêché qu’elle était au cours de mille et mille controverses, capucins non-philosophes que vous êtes, et elle aura dit le pire.
Mais la philosophie parle des sujets religieux et philosophiques autrement que vous n’en avez parlé. 24 Vous parlez sans avoir sans avoir étudié, elle parle après avoir étudié ; vous vous adressez à la passion, elle s’adresse à l’intelligence ; vous injuriez, elle enseigne ; vous promettez le ciel et la terre, elle ne promet rien que la vérité ; vous exigez qu’on ait foi en votre foi, elle n’exige pas qu’on croie à ses résultats ; elle exige l’examen par le doute ; vous épouvantez, elle apaise. Et, en vérité, la philosophie connaît assez le monde pour savoir que ses résultats ne flagornent pas la recherche du plaisir et l’égoïsme pas plus dans le ciel que sur la terre ; mais le public épris de la vérité, de la connaissance pour elles-mêmes, pourra comparer sans doute son jugement et sa moralité au jugement et à la moralité de plumitifs ignares, serviles, inconséquents et stipendiés.
Certes, il arrivera que tel ou tel lecteur, par étroitesse de pensée et de sentiments, interprète faussement la philosophie mais, vous les protestants, ne croyez-vous pas que les catholiques interprètent faussement le christianisme, ne reprochez-vous pas à la religion chrétienne les périodes ignominieuses du VIIIe et du IXe siècles, la Saint-Barthélémy ou l’Inquisition 25 ?
Pour une grande part la haine de la théologie protestante contre les philosophes provient de la tolérance dont fait preuve la philosophie à l’égard de la confession particulière en tant que telle : il existe de ce fait des preuves évidentes. On a davantage reproché à Feuerbach, à Strauss de tenir les dogmes catholiques pour des dogmes chrétiens que d’avoir déclaré que les dogmes du christianisme n’étaient pas des dogmes de la raison.
Mais si quelques individus ne digèrent pas la philosophie moderne et meurent d’indigestion philosophique, cela ne constitue pas une preuve contre la philosophie ; pas plus que le fait que de temps en temps une chaudière à vapeur explose et projette en l’air quelques voyageurs, n’est une preuve contre la mécanique.
La question de savoir si des questions philosophiques et religieuses doivent être discutées dans les journaux, se trouve résolue par son vide même.
Si de tels problèmes intéressent le public sous forme de questions traitées dans les journaux, c’est qu’elles sont devenues des questions d’actualité, alors la question ne se pose pas de savoir si on doit les discuter ; alors la question se pose de savoir où et comment on doit en discuter : doivent-elles être traitées au sein des familles et dans les hôtels, les écoles et l’église mais pas dans la presse ? par les adversaires de la philosophie, mais pas par les philosophes ? dans le langage obscur de l’opinion privée, mais pas dans la langue de la raison publique qui clarifie les problèmes ? alors la question se pose de savoir si ce qui vit dans la réalité est du domaine de la presse ; mais alors ce n’est plus le problème d’un contenu particulier de la presse, c’est la question générale qui est posée : la presse doit-elle être une presse réelle, c’est-à-dire une presse libre ?
Quant à la seconde question, nous la séparerons complètement de la première : « La politique doit-elle être traitée philosophiquement par les journaux dans un Etat dit chrétien ? »
Si la religion devient une qualité politique, un sujet de la politique, il n’est presque plus nécessaire, semble-t-il, de noter que les journaux ont non seulement le droit mais l’obligation de discuter de sujets politiques. Il semble a priori que la sagesse de ce monde, la philosophie, a davantage le droit de se préoccuper du royaume de ce monde, de l’Etat, que la sagesse de l’autre monde, la religion. La question qui se pose alors est, non pas de savoir si l’on doit philosopher sur l’Etat : bien ou mal, philosophiquement ou antiphilosophiquement, avec préjugés ou sans préjugé, en pleine lucidité ou sans lucidité, avec esprit de suite ou sans esprit de suite, rationnellement à 100 % ou à moitié seulement. Si vous transformez la religion en théorie du droit public, vous faites de la religion elle-même une sorte de philosophie.
N’est-ce pas surtout le christianisme qui a séparé l’Eglise et l’Etat ?
Lisez Saint-Augustin, De civitate Dei 26, étudiez les Pères de l’Eglise et l’esprit du christianisme, et revenez ensuite nous dire si c’est l’Etat ou l’Eglise qui est « l’Etat chrétien » ! Ou bien est-ce que chaque instant de votre vie pratique ne dément pas votre théorie ? Tenez-vous pour injuste de faire appel aux tribunaux si vous êtes dupés ? Mais l’apôtre écrit que c’est injuste. Tendez-vous la joue droite quand on vous frappe à la joue gauche, ou bien n’intentez-vous pas un procès pour voies de fait ? Mais l’Evangile l’interdit. Demandez-vous une justice rationnelle en ce monde, ne grognez-vous pas à la moindre élévation d’un impôt, n’êtes-vous pas hors de vous-même à la moindre atteinte contre votre liberté personnelle ? Mais ne vous est-il pas dit que les souffrances temporelles ne sont rien comparées à la splendeur de la vie future, que se résigner à la souffrance et placer son bonheur dans l’espérance sont les vertus cardinales ?
La plus grande partie des procès que vous engagez et la plus grande partie des lois civiles, n’ont-ils pas trait à la propriété ? Mais il vous est dit que vos trésors ne sont pas de ce monde. Ou bien, si vous vous appuyez sur la parole qui dit qu’il faut rendre à César ce qui est à Céasar, et à Dieu ce qui est à Dieu, alors ne tenez pas seulement Mammon, le Dieu de l’or, mais au moins autant la libre raison pour le César de ce monde, et « l’exercice de la libre raison », nous la nommons philosophie.
Lorsqu’on voulut au début faire de la Sainte-Alliance 27 une alliance quasi religieuse entre Etats, la religion devenant l’armoirie des Etats européens, c’est le pape qui refusa d’adhérer à cette Sainte-Alliance, témoignant de beaucoup de profondeur et de la conséquence la plus stricte, car, dit-il, le lien chrétien universel entre les peuples c’est l’Eglise et non la diplomatie, non une alliance temporelle entre Etats.
L’Etat véritablement religieux est l’Etat théocratique ; le souverain, dans des Etats de ce genre, doit ou bien, comme c’est le cas dans l’Etat juif, être le dieu de la religion, le Jéhovah, ou bien, comme au Thibet, être le représentant du dieu, le Dalaï Lama, ou bien enfin, comme le demande à juste raison aux Etats chrétiens Görres dans son dernier ouvrage 28, tous doivent se soumettre à une Eglise, qui est une « Eglise infaillible », car lorsqu’il n’existe pas de chef suprême de l’Eglise, comme c’est le cas dans le protestantisme, la domination de la religion n’est rien d’autre que la religion de la domination, le culte de la volonté du gouvernement.
Dès qu’un Etat englobe plusieurs confessions égales en droits, il ne peut être un Etat religieux sans porter atteinte aux confession religieuses particulières, sans être une Eglise qui condamne tout fidèle d’une autre confession comme hérétique, qui fait dépendre chaque morceau de pain de la foi, qui fait du dogme le lien entre les individus et leur existence en tant que citoyens. Demandez-le aux habitants catholiques de la « pauvre, verte Erin » 29, demandez-le aux huguenots d’avant la Révolution française 30, ce n’est pas à la religion qu’ils en ont appelé, car leur religion n’était pas une religion d’Etat, mais aux « droits de l’humanité » ; et la philosophie interprète les droits de l’humanité, elle demande que l’Etat soit l’Etat de la nature humaine.
Mais, dit le rationaliste honteux, borné et aussi incroyant que théologien, c’est l’esprit universel du christianisme, abstraction faite des différences de confession, qui doit être l’esprit de l’Etat ! Voilà l’irréligiosité suprême, c’est outrecuidance de la raison temporelle que séparer l’esprit universel de la religion positive ; séparer ainsi la religion de ses dogmes et de ses institutions revient à affirmer que l’esprit universel du droit doit régner dans l’Etat, abstraction faite des lois déterminées et des institutions positives du droit.
Si vous prétendez vous placer tellement au-dessus de la religion que vous êtes justifiés à séparer l’esprit universel de celle-ci des institutions positives où elle se définit, qu’avez-vous à reprocher aux philosophes lorsqu’ils poussent cette séparation jusqu’à son terme et ne s’arrêtent pas à mi-chemin, lorsqu’ils disent que l’esprit universel de la religion, n’est pas l’esprit du christianisme mais l’esprit de l’humanité.
Les chrétiens habitent dans des Etats aux constitutions différentes, les uns en république, d’autres dans une monarchie absolue. Le christianisme ne décide pas dans quelle mesure les constitutions sont bonnes, car il ne connaît pas de différence entre les constitutions ; il enseigne, comme la religion doit le faire : soyez soumis à l’autorité, car toute autorité émane de Dieu. Ce n’est donc pas en partant du christianisme, mais de la nature propre, de l’essence de l’Etat que vous devez décider si les constitutions sont justes, non à partir de la nature de la société chrétienne, mais de la nature de la société humaine.
L’Etat byzantin a été l’Etat religieux par excellence, car les dogmes y étaient affaires d’Etat, mais l’Etat byzantin a été le plus mauvais des Etats. Les Etats de l’ancien régime ont été les Etat les plus chrétiens, mais ils n’en ont pas moins été les Etats où régnait « le bon plaisir de la cour ».
Il existe un dilemme auquel le « bon sens » ne saurait se soustraire.
Ou bien l’Etat chrétien répond au concept de l’Etat, qui est d’être une réalisation de la liberté selon la raison, et alors la seule exigence pour qu’un Etat soit chrétien est qu’il soit rationnel, et alors il suffit de déduire l’Etat du caractère rationnel des rapports humains, c’est à quoi s’emploie la philosophie. Ou bien l’Etat de la liberté selon la raison ne peut être déduit du christianisme et alors vous conviendrez vous-même que ce développement n’est pas inclus dans la tendance du christianisme puisque celui-ci ne peut vouloir un Etat mauvais et qu’un Etat qui n’est pas une réalisation de la liberté selon la raison, est un Etat mauvais.
Vous pouvez apporter à ce dilemme la réponse que vous voudrez : vous devrez bien convenir que l’Etat ne doit pas être construit à partir de la religion mais à partir du caractère rationnel de la liberté. Il n’y a que l’ignorance la plus crasse qui puisse soutenir que cette théorie du caractère autonome que prend le concept d’Etat est une fantaisie soudaine des philosophes modernes.
La philosophie n’a rien fait en matière de politique que n’aient accompli la physique, les mathématiques, la médecine, chaque science dans sa sphère respective. Bacon de Verulam a déclaré que la physique théologique était une vierge vouée à Dieu, et stérile : il a émancipé la physique de la théologie et elle est devenue féconde 31. Pas plus que vous ne demandez au médecin s’il est croyant, vous ne devez poser cette question au politique. Dans la période qui précède et qui suit immédiatement la grande découverte par Copernic du vrai système solaire, on découvrit également la loi de la gravitation de l’Etat ; on trouva son centre de gravité en lui-même et, les divers gouvernements européens cherchèrent à appliquer cette découverte, avec le manque de profondeur de toute première mise en pratique, dans le système de l’équilibre des pouvoirs, de même, d’abord Machiavel, Campanella, puis plus tard Hobbes, Spinoza, Hugo, Grotius, jusqu’à Rousseau, Fichte, Hegel se mirent à considérer l’Etat avec des yeux humains et à déduire ses lois naturelles de la raison et de l’expérience, et non de la théologie, tout comme Copernic, qui passa outre au fait que Josué eût ordonné au soleil de s’arrêter sur Gabaon et à la lune sur la vallée d’Ajalon. La philosophie moderne n’a fait que continuer un travail qu’Héraclite et Aristote déjà avaient entrepris. Vous ne polémiquez donc pas contre la raison de la philosophie moderne, vous polémiquez contre la philosophie toujours neuve de la raison. Certes, l’ignorance qui a fait découvrir pour la première fois, hier peut-être, ou avant-hier, à la Gazette rhénane ou à la Gazette de Königsberg les très vieilles idées sur l’Etat, cette ignorance tient les idées de l’histoire pour des fantaisies soudaines d’individus isolés parce qu’elles sont nouvelles pour elles et lui sont venues du jour au lendemain ; elle oublie qu’elle assume elle-même le vieux rôle du docteur de la Sorbonne qui estimait de son devoir d’accuser publiquement Montesquieu, parce que celui-ci avait eu la légèreté de déclarer que la qualité civique suprême était la vertu politique et non la vertu religieuse ; elle oublie qu’elle assume le rôle de Joachim Lange qui dénonça Wolff sous prétexte que sa doctrine de la prédestination entraînerait la désertion des soldats et par là le relâchement de la discipline militaire et enfin la dissolution de l’Etat ; elle oublie enfin que le Code civil prussien est sorti de l’école philosophique de ce « loup »-là précisément 32 et le code Napoléon non de l’Ancien Testament, mais des idées des Voltaire, Rousseau, Condorcet, Mirabeau, Montesquieu et de la Révolution française. L’ignorance est un démon ; il est à craindre qu’elle ne joue encore mainte tragédie ; les plus grands poètes grecs ont eu raison de la représenter dans les drames effroyables des familles royales de Mycène et de Thèbes sous les traits du destin tragique.
Mais si les professeurs de droit constitutionnel d’autrefois ont construit l’Etat à partir des instincts, soit de l’ambition, soit de la sociabilité, ou à partir de la raison certes, mais pas de la raison sociale, à partir de la raison de l’individu : eh ! bien, la conception de la philosophie moderne, plus profonde, déduit l’Etat de l’idée du tout. Elle considère l’Etat comme le grand organisme dans lequel les libertés juridique, morale et politique doivent se réaliser et dans lequel chaque citoyen, obéissant aux lois de l’Etat, ne fait qu’obéir aux lois naturelles de sa propre raison, de la raison humaine. Sapienti sat 33.
En conclusion, nous nous adressons encore une fois à la Gazette de Cologne avec un mot d’adieu philosophique. Il était raisonnable de sa part de s’attacher un libéral « d’antan ». On peut être à la fois libéral et réactionnaire de la manière la plus commode ; il suffit simplement d’être assez habile pour s’adresser toujours aux libéraux du passé le plus récent qui ne connaissait d’autre dilemme que celui de Vidocq « prisonnier ou geôlier ». Il était encore plus raisonnable que le libéral du passé le plus récent combattît les libéraux d’aujourd’hui. Sans partis pas d’évolution, sans séparation pas de progrès. Nous espérons que l’éditorial du n° 179 inaugure pour la Gazette de Cologne une ère nouvelle, l’ère du caractère.
Notes
1 Jeu de mots intraduisible sur Intelligenz (les intellectuels) et Intelligensblatt (feuille d’annonces).
2 Par les sentiers raboteux jusqu’aux étoiles.
3 Marx joue pareillement sur les mots Astra et Austern (huîtres).
4 Tout le passage est bâti sur la double sens des Anzeige (annonce, dénonciation).
5 Jeu de mots sur spiritueux, esprit.
6 Jeu de mots entre leitender Artikel (éditorial) et leidender Artikel (article pitoyable)
7 Cité d’après Lucien de Samosate : œuvres complètes (3 vol., paris, s.d.). Traduction par Emile Chambry. Tome I, pp. 149-150.
8 Allusion au nom du rédacteur de la Gazette de Cologne.
9 Même jeu de mots : leitender, leidender Artikel, que nous avons essayé de rendre ici par article de tête, article de bête.
10 Jeu de mots sur blöd qui signifie bas en parlant de la vue, et aussi : stupide.
11 Jeu de mots intraduisible entre Uebermut (outrecuidance) et Mut (courage).
12 Je dors, ne me réveillez pas.
13 L’école d’Alexandrie représente la philosophie au moment de l’agonie de la société esclavagiste. Dans les dernières décennies qui précèdent notre ère, à Alexandrie devenue le centre de la vie intellectuelle de l’époque, les philosophes de cette école se mirent à combiner la philosophie idéaliste grecque avec le mysticisme oriental. Les principaux représentants de cette philosophie qui, au cours de son évolution, connut trois tendances (tendance judéo-alexandrine, néo-pythagoricienne et néo-platonicienne) furent Philon (né vers l’an 20 avant notre ère, mort en 54 de notre ère), le « vrai père du christianisme » (Engels) et Plotin (204-270).
14 Jeu de mots en allemand sur le nom de Leibniz et sur Löwenix, déformation de Glaubenichts, mécréant.
15 C’est vrai parce que c’est absurde.
16 Les Védas sont les plus anciens monuments en vers et en prose de la littérature et de la religion indiennes ; ils virent le jour au long de plusieurs siècles, antérieurement au VIe siècle avant notre ère.
17 Il s’agit de la Charte constitutionnelle qui fut promulguée en France après la révolution bourgeoise de 1830 et était la constitution de la Monarchie de Juillet.
18 En français dans le texte.
19 Code civil général des Etats prussiens, 4e vol., 2e édition, Berlin, 1794, p. 895.
20 Shakespeare : Le Roi Lear, acte II, scène 2.
21 Allusion au fait que le rédacteur de la Gazette de Cologne, Hermès, avait participé dans sa jeunesse au mouvement d’opposition des étudiants allemands.
22 Corybantes : prêtres de la déesse phrygienne Cybèle. Caribes : prêtres des dieux de la Grèce antique.
Les Corybantes et les Cabires furent assimilés en Asie mineure aux Curètes de Crète, prêtres de la mère de Zeus, la déesse Rhéa. Un mythe raconte que les Curètes couvrirent les cris de Zeus nouveau-né du bruit de leurs épées frappées contre leurs boucliers.
23 Marx fait allusion à la polémique hargneuse de la presse réactionnaire allemande contre la critique philosophique de la religion ; cette critique avait été ouverte par le livre de David Friedrich Strauss : La Vie de Jésus, dont le premier volume a paru en 1835 et le second en 1836.
24 Marx fait, de toute évidence, allusion à l’instauration du monopole de l’Eglise catholique dans le domaine de la culture et de l’idéologie, à cette époque du haut moyen âge où, selon Friedrich Engels, la civilisation antique, la philosophie, la politique, la jurisprudence antiques furent exterminées. « Le résultat fut que, de même qu’à toutes les étapes primitives de développement, les prêtres reçurent le monopole de la culture intellectuelle, et la culture elle-même prit un caractère essentiellement théologiques. Entre les mains des prêtres, la politique et la jurisprudence restèrent, comme toutes les autres sciences, de simples branches de la théologie… » (Friedrich Engels : La Guerre des paysans en Allemagne — cf. infra p. 99). En même temps que la philosophie antique, tombèrent aussi en décadence les disciplines des sciences de la nature et les mathématiques furent également mis au service de l’Eglise. La littérature devint l’histoire de la vie des saints et l’histoire, la chronique de l’Eglise. La philosophie se transformera en servante de la théologie ; dans tous les domaines de la connaissance humaine, l’Eglise soutint des conceptions antiscientifiques et réactionnaires.
25 Institution de police et de justice de l’Eglise catholique, créée au XIIIe siècle pour liquider par la violence les hérétiques et les suspects d’hérésie. L’Inquisition fut une arme dans le combat contre le mouvement antiféodal et anticatholique, et contre toute forme de pensée libre. Elle utilisa tous les moyens : l’espionnage, la corruption des témoins, les tortures bestiales et les tribunaux ecclésiastiques secrets. Ses jugements se distinguaient par leur extrême cruauté. Sur les bûchers et dans les chambres de torture de l’Inquisition périrent des centaines de milliers d’innocents et, parmi eux, beaucoup de grands savants. Vers le milieu du XIXe siècle, l’Inquisition perdit une partie de ses fonctions, néanmoins elle continua à combattre les opinions progressistes et révolutionnaires.
26 La Cité de Dieu.
27 La Sainte-Alliance fut une alliance des puissances contre-révolutionnaires contre tous les mouvements progressistes en Europe. Elle fut créée à Paris après la victoire sur Napoléon, le 26 septembre 1815 a l’initiative du tsar Alexandre Ier. Avec l’Autriche et la Prusse, y adhèrent presque tous les Etats européens. Les monarques s’engageaient à soutenir mutuellement, à maintenir le système monarchique et la religion chrétienne et à préserver leurs Etats des secousses révolutionnaires.
28 Il s’agit de l’ouvrage de Joseph Görres : l’Eglise et l’Etat à la fin de l’erreur de Cologne, 1842.
29 Ancien nom de l’Irlande.
30 La masse principale du mouvement huguenot qui se réclamait de la doctrine de Calvin, se composa, dans la première période (XVIe siècle) d’éléments venus de la bourgeoisie et de l’artisanat. Plus tard le rôle dominant fut joué par la noblesse provinciale du midi de la France et la partie de l’aristocratie féodale qui était en désaccord avec la politique centralisatrice du pouvoir royal. Le développement du mouvement huguenot conduisit à la guerre civile entre catholiques et huguenots qui commença en 1562, prit un caractère particulièrement aigu après la Saint-Barthélémy et se poursuivit sans interruption jusqu’en 1594. L’Edit de Nantes, en 1598, accorda aux huguenots la liberté de croyance. Pourtant le gouvernement et l’Eglise catholique continuèrent leurs persécutions contre les huguenots jusqu’à la Révolution. Louis XIV révoqua l’Edit de Nantes en 1685.
31 Voir le passage : « … Causarum finalium inquisitio sterilis est, et tanquam virgo Deo consacrata, nihil parit » (La recherche des causes finales est stérile, et n’enfante rien, semblable à une vierge vouée à Dieu) in Francis Bacon : De dignitate et augmentis scientiarum, Liber III, Cap. V (De la dignité et de l’avancement des sciences) dans l’édition Wirceburg, 1779, tome I, p. 252.
32 Loup : en allemand Wolf ; jeu de mots sur le nom du philosophe Wolff.
33 Cela suffit au sage (à l’initié).