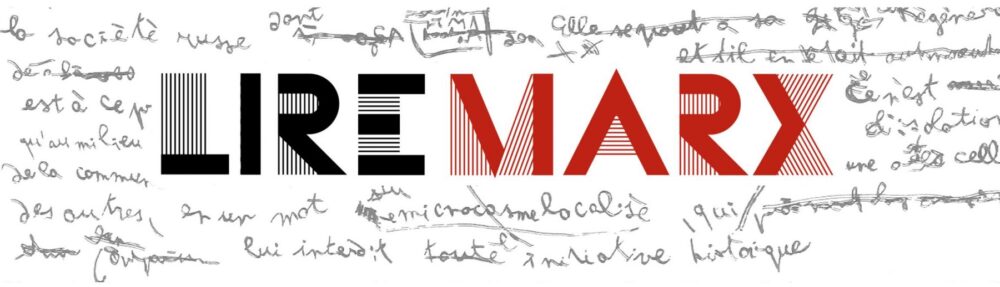Interview donnée à Phase et parue le 2 août 2001. Texte source à retrouver ici.
Le terme « mondialisation » recouvre des idées et des concepts très divers. Que désigne-t-il exactement ?
Heinrich : Ce terme désigne les nouvelles évolutions du système capitaliste mondial, les transformations économiques et politiques qui se sont dessinées au cours des 10 à 15 dernières années.
L’interdépendance économique mondiale s’est considérablement intensifiée. De ce fait, la politique des différents États nationaux a dû s’adapter à de nouvelles contraintes. Cependant, l’ampleur et les répercussions de ces transformations sont controversées. Tant les néolibéraux que certains sociaux-démocrates soulignent les « opportunités » qu’offre la mondialisation afin de retrouver un capitalisme prospère qui profitera à tous, tôt ou tard. De nombreux syndicats, ONG, mais aussi certains conservateurs soulignent en revanche les dangers qui pèsent sur l’État providence, la protection de l’environnement ou encore la marge de manœuvre des États. Les raisons et les objectifs politiques de ces « détracteurs de la mondialisation » sont toutefois très divergents. Enfin, certains défendent également l’idée que la « mondialisation » ne serait qu’un mythe, une construction idéologique permettant de mieux légitimer des politiques favorables au capitalisme.
Si la « mondialisation » est une catégorie pertinente, de quels processus s’agit-il concrètement ?
Heinrich : Tout d’abord, dans les années 70 et 80, un système financier largement internationalisé s’est développé, un système qui définit les « normes », c’est-à-dire les critères de valorisation du capital, pour une grande partie de l’économie. Puis, à la fin des années 80, l’Union soviétique s’est effondrée. Les pays d’Europe de l’Est entretenaient bien sûr déjà des relations commerciales et financières avec les pays capitalistes occidentaux, mais ce n’est qu’après 1989 et la chute du mur de Berlin qu’ils ont amorcé leur transformation capitaliste. Depuis que la Chine, elle aussi, est entrée dans une phase de développement capitaliste, il n’y a pratiquement plus de frontières géographiques au capital. Dans le même temps, l’interdépendance s’est considérablement accrue entre les différents pays capitalistes, non seulement entre les pays développés d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord, mais aussi entre les pays dits émergents d’Asie de l’Est et, partiellement, d’Amérique latine, notamment grâce aux possibilités nouvelles et moins coûteuses en matière de transport et de communication. Le cadre « national » revêt une importance moindre pour une part importante (et croissante) du capital. Cela se traduit également par une transformation du rôle politique des États-nations ; leur marge de manœuvre en matière de politique économique se trouve notamment sérieusement réduite comparée aux décennies précédentes.
Tu décris une internationalisation croissante des relations capitalistes. Mais cette tendance n’a-t-elle pas toujours existé ? Qu’y a-t-il vraiment de nouveau dans la mondialisation ?
Heinrich : Bien sûr, le capital a toujours eu tendance à s’étendre et à dépasser toutes les frontières. Cela était déjà vrai lors de la phase initiale du capitalisme commercial aux XVIe et XVIIe siècles, et cela a également été le cas lors de l’avènement du capitalisme industriel au XIXe siècle. On a souvent fait observer qu’avant le début de la Première Guerre mondiale, le commerce international, les migrations, etc. avaient atteint des proportions similaires à aujourd’hui. En effet, à la fin du XIXe siècle, on a assisté à une première vague de mondialisation qui reposait sur les bases atteintes par le capitalisme industriel. Toutefois, cette dynamique était encore limitée : l’Angleterre était la puissance hégémonique, la France, l’Allemagne et les États-Unis commençaient tout juste à rattraper leur retard et, à part cela, il n’y avait qu’un capitalisme de périphérie, ainsi que des colonies capitalistes. La « mondialisation » reposait sur une base limitée et un système financier nettement moins internationalisé qu’aujourd’hui. Cette dynamique de mondialisation a pris fin avec la Première Guerre mondiale et la crise économique de 1929. Dans les années 1930, le commerce mondial s’est littéralement effondré, les dynamiques « nationales » ont pris le dessus (le « New Deal » aux États-Unis, les régimes fascistes en Allemagne et en Italie, mais aussi l’Union soviétique avec sa tentative de rattrapage d’accumulation). Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont certes redevenus une puissance hégémonique incontestable, mais ils avaient en l’Union soviétique un adversaire qui imposait des limites à leur expansion géographique et qui, à la suite de l’indépendance obtenue par la plupart des colonies, est également devenu l’adversaire du monde capitaliste occidental dans ce qu’on appelait le Tiers-Monde (soit dit en passant, ce n’est pas parce que l’URSS s’est opposée à l’Occident ne signifie pas qu’elle ait incarné un projet émancipateur). Au cours de la première moitié du XXe siècle, le monde dans son ensemble était, d’une certaine manière, plus fragmenté qu’au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, situation qui n’a radicalement changé qu’au cours des 10 à 15 dernières années, mais qui repose désormais sur une base tout à fait différente et plus étendue, tant sur le plan économique (en particulier le système financier) que politique.
Tu as mentionné à plusieurs reprises le système financier. Quel rôle joue ce système et en quoi est-il si important qu’il soit aujourd’hui plus internationalisé qu’auparavant ?
Heinrich : Le système financier, c’est-à-dire principalement les marchés de capitaux sur lesquels sont négociés des obligations, des actions, des devises ainsi que divers instruments dérivés, options, produits financiers, etc., est en quelque sorte le « centre de pilotage » d’une économie capitaliste. Non pas au sens où il serait contrôlé consciemment par un groupe particulier de personnes, mais dans un sens structurel. L’orientation et l’ampleur de l’accumulation de capital sont essentiellement déterminées par les conditions qui prévalent sur les marchés financiers : augmentation ou restriction de l’octroi de crédits, montant des taux d’intérêt, évaluation des actions, etc. Le système financier assurait déjà cette fonction de pilotage auparavant, mais il était alors essentiellement organisé au niveau national (avec quelques centres internationaux). Au cours des 20 dernières années, un système toujours plus internationalisé s’est constitué, définissant des normes mondiales pour le capital. Nous sommes certes encore loin d’un capitalisme mondial uniforme, mais nous n’avons plus non plus de capitalisme national, guidé principalement par des taux d’intérêt et des taux de profit définis au sein d’un espace économique national.
C’est précisément dans le contexte de ces processus que l’on parle parfois de la dissolution des États-nations dans le sillage de la mondialisation. Le « dépérissement de l’État » dont parlait Engels dans le cadre du socialisme a-t-il donc déjà lieu sous le capitalisme ?
Heinrich : Non, on ne peut pas parler de « dépérissement » des États-nations. C’est la politique des États qui, par la déréglementation des systèmes financiers dans les années 70, a considérablement accéléré leur internationalisation. Ce sont les représentants des États-nations qui décident, dans le cadre de l’OMC, du cadre futur pour le commerce mondial, et ce sont encore les États qui continuent de mener des guerres. Cependant, la politique des États-nations s’inscrit aujourd’hui dans un contexte différent. Les marges de manœuvre en matière de politique économique ont par exemple changé, notamment en ce qui concerne le contrôle des taux d’intérêt et des taux de change. Tout cela n’a toutefois pas conduit à la disparition de l’État, mais à sa transformation : même si les États-nations ne disparaissent pas, les formes « transnationales » d’État jouent un rôle toujours plus important (OMC, OTAN, FMI, etc.) et, dans certains cas, de nouvelles formes « internationales » d’État voient le jour, à l’image de l’UE. Les États-nations opèrent simultanément sur plusieurs niveaux supranationaux, ce qui rend les conflits plus complexes : des États qui font la guerre ensemble dans le cadre de l’OTAN peuvent très bien défendre des positions opposées au sein de l’OMC, etc.
Dans le contexte de la mondialisation, on parle souvent de « capitalisme débridé », un capitalisme qui menace la société et qui doit être maîtrisé avec l’aide de l’État. Penses-tu que cette analyse est pertinente ?
Heinrich : Qualifier le capitalisme actuel de « débridé » repose sur l’idée que le capitalisme était autrefois plus « bridé », en quelque sorte plus humain. Cela revient à faire une généralisation d’une représentation (déjà idéalisée) du capitalisme d’après-guerre. Entre 1950 et 1975, il pouvait sembler que le capitalisme (du moins dans les métropoles) était devenu pratiquement dépourvu de crises. Des taux de croissance élevés rendaient apparemment compatibles la réalisation de profits importants et l’augmentation des salaires réels ou encore le renforcement de l’État social.
« …nous atteignons en fait historiquement la situation que Marx avait à l’esprit lorsqu’il a voulu analyser dans Le Capital le mode de production capitaliste « dans sa moyenne idéale »…
Ce « miracle économique » (particulièrement visible en Allemagne de l’Ouest) était toutefois lié à des conditions historiques spécifiques qui ont disparu au cours de ce même miracle économique. Le capitalisme « débridé » d’aujourd’hui, qui détruit toutes les relations sociales qui ne s’inscrivent pas dans la logique de valorisation du capital, est en revanche le capitalisme « normal ». Dans la mesure où ce capitalisme, qui s’accompagne de crises et de processus de paupérisation croissants, s’impose désormais à l’échelle mondiale, il se libère d’une série d’obstacles et s’établit comme un capitalisme concurrentiel mondial, de telle sorte que nous atteignons en fait historiquement la situation que Marx avait à l’esprit lorsqu’il a voulu analyser dans Le Capital le mode de production capitaliste « dans sa moyenne idéale » et a constaté que « le marché mondial […] constitue la base et l’atmosphère vitale » du capitalisme.
« …le plein emploi, la sécurité sociale, l’élimination de la pauvreté, etc. ne sont pas les objectifs du processus de valorisation, mais tout au plus ses déchets temporaires… »
Si l’on exige désormais de l’État qu’il régule socialement ce capitalisme débridé, on suppose alors que la politique des Etats pourrait être tout autre si seulement le gouvernement le voulait, s’il se soustrayait à l’influence du capital et faisait enfin ce qui est bon et juste. Certes, la politique dépend toujours des luttes sociales et est donc dans une certaine mesure ouverte ; il existe toujours différentes voies qui peuvent être empruntées. Cependant, il ne faut pas perdre de vue les contraintes structurelles, qui sont beaucoup plus importantes que les bonnes ou mauvaises intentions du gouvernement. Quel que soit le parti au pouvoir, « l’économie » doit fonctionner, ce qui signifie, dans un contexte capitaliste, qu’une valorisation suffisante doit être possible. Sans profits suffisants, il n’y a pas d’accumulation, et sans accumulation, les recettes fiscales sont insuffisantes, tandis que les dépenses sociales sont élevées en raison de la hausse du chômage. Même sans corruption, sans collusion, etc., l’État doit avant tout veiller à une « bonne » valorisation du capital. Et le plein emploi, la sécurité sociale, l’élimination de la pauvreté, etc. ne sont pas les objectifs du processus de valorisation, mais tout au plus ses déchets temporaires. Un capitalisme social, écologique ou je ne sais quoi d’autre n’existera que dans la mesure où cela sera possible du point de vue de la valorisation – et au plus tard lors de la prochaine crise, les améliorations sociales qui auront été obtenues à un moment donné seront à nouveau remises en question.
Le mot-clé « crise » nous amène à la question suivante. Les nombreux krachs boursiers et monétaires des années 90 ont souvent été interprétés comme les signes avant-coureurs d’un effondrement définitif du capitalisme. Que penses-tu des prévisions de ces théories de la crise ? Le capitalisme a-t-il vraiment atteint ses limites ?
Heinrich : Au contraire, le capitalisme mondialisé et concurrentiel n’en est qu’à ses débuts, et les krachs boursiers et les crises sont non seulement normaux, mais également nécessaires au développement futur du capitalisme : les dérives, les blocages de l’accumulation, etc. ne peuvent être éliminés autrement dans une économie capitaliste. Le fait que ces krachs détruisent de nombreux moyens de subsistance, qu’ils engendrent la misère et qu’ils causent la ruine de nombreuses entreprises constitue en quelque sorte une « cure de jouvence » pour le capitalisme dans son ensemble, en tant que système. Les théories de l’effondrement, qui sont revenues à la mode dans les années 90, ne sont en aucun cas nouvelles. Elles font partie depuis un siècle de l’arsenal de base du marxisme ouvrier. Ces théories ne sont pas seulement influencées par la brutalité des crises, suivant l’idée qu’avec tant de destructions, le capitalisme ne peut guère continuer d’exister. Elles sont également dominées par la recherche d’une limite « objective » du capitalisme, d’une limite au développement au-delà de laquelle le capitalisme ne peut tout simplement plus aller. Je considère cette idée comme une illusion, car jusqu’à présent, le capitalisme a toujours surmonté chacune de ces limites prétendument objectives. Les théories de l’effondrement des années 90 intégraient toutefois une autre idée, à savoir que le capitalisme du miracle économique des années 60 et du début des années 70 représentait le capitalisme « normal » et qu’un capitalisme caractérisé par le chômage de masse et une tendance à la paupérisation sonnait donc son propre glas. Le capitalisme du miracle économique est en effet révolu, et le « plein emploi » n’existera probablement plus dans un avenir prévisible. Mais cela signifie seulement que nous atteignons la fin d’une certaine phase du capitalisme, et non la fin du capitalisme en soi.
L’exacerbation des contradictions et l’aggravation des contradictions sociales dans le capitalisme concurrentiel mondial ne pourraient-elles pas également créer une nouvelle dynamique pour un mouvement anticapitaliste ?
Heinrich : Eh bien, il ne faut pas perdre espoir. Cependant, il faut d’abord s’attendre à une augmentation des courants de droite au sens large, qui incluent toutes sortes de tendances fascistes et racistes. Même pour beaucoup de choses qui peuvent sembler anticapitalistes à première vue, je resterais prudent quant à savoir s’il s’agit vraiment d’un anticapitalisme fondamental ou seulement d’un capitalisme « meilleur », peut-être national.
Actuellement, la gauche radicale se demande s’il est judicieux d’intégrer ses idées anticapitalistes dans le mouvement altermondialiste. Cela pourrait-il être une perspective ?
Heinrich : En ce qui concerne le mouvement altermondialiste, il faut tenir compte du fait qu’il est tellement hétérogène qu’il ne s’agit en réalité pas d’un seul mouvement, mais de plusieurs mouvements qui ont – parfois – un ennemi commun. Le spectre s’étend des (rares) approches anticapitalistes aux courants réformistes qui veulent un capitalisme « meilleur » et régulé, en passant par des tendances plutôt conservatrices qui veulent avant tout sauver leur propre « nation » et les acquis sociaux que cette nation est censée garantir. Et entre les deux, il y a encore beaucoup de recoupements. Je trouverais erroné de simplement adhérer à ce mouvement avec le vague espoir de pouvoir un jour apporter quelque chose de différent. Il serait nécessaire de mener une réflexion critique sur les points de vue qui prédominent dans le mouvement altermondialiste, ce qui n’exclut pas du tout la possibilité de mener des actions communes avec certains groupes.
Quelle forme d’intervention politique a encore un sens aujourd’hui ? Tu as toi-même critiqué à Göttingen la conception classique de la politique comme étant ce qui est possible et faisable. Le mieux est-il de rester chez soi à lire des livres intelligents ?
Heinrich : Eh bien, je n’ai pas non plus de recette miracle pour la « bonne » forme d’intervention. En tout cas, lire des livres intelligents n’est certainement pas une mauvaise chose, mais cette lecture devrait ensuite être diffusée à l’extérieur. Ces dernières années, on constate un regain d’engagement chez les jeunes, qui, après un certain temps, ne se contentent plus de chercher la bonne forme d’action, mais veulent aussi mieux comprendre les tenants et aboutissants. Or, il existe souvent peu d’offres permettant de transmettre ne serait-ce que les analyses déjà existantes. L’étude de la « théorie » revêt toutefois une importance fondamentale pour la politique de gauche. Si l’on agit à partir d’une position radicalement anticapitaliste, il faut non seulement être conscient que la destruction du capitalisme ne sera probablement pas à l’ordre du jour dans les 20 ou 30 prochaines années, mais aussi être toujours conscient de l’énorme pouvoir d’intégration du système capitaliste dans son ensemble. Un système parlementaire qui fonctionne ne consiste pas simplement à imposer les intérêts financiers existants. Ces intérêts doivent d’abord être articulés, harmonisés entre eux, et la résistance à ces intérêts joue également un rôle, cette résistance pouvant être tout à fait productive à long terme pour le système dans son ensemble (si toutes les centrales nucléaires initialement prévues avaient été construites dans les années 70 et 80, de nombreuses entreprises de l’énergie seraient probablement en faillite aujourd’hui). Il est toujours possible d’intégrer certaines de ses propres revendications dans le processus politique (qui se déroule non seulement dans les parlements, mais aussi dans l’opinion publique et dans les médias), et l’on peut alors espérer qu’en s’impliquant davantage dans le système, on finira par fonder le bon parti et gagner en influence dans les parlements, ou en occupant une fonction dans un comité consultatif important, ou en apparaissant dans des médias importants, etc. – on pourrait alors obtenir encore plus. Et pour mieux s’intégrer dans le système, on fait alors très lentement concession après concession. On en arrive ainsi à considérer la politique comme « l’art du possible ». Face à la suprématie du capitalisme, la gauche court toujours le risque de se résigner, de se limiter aux fameux petits pas et de devenir peu à peu un rouage bien huilé de la machine qu’elle voulait à l’origine abolir. Il est alors très utile, en particulier lorsqu’il n’existe pas de mouvement de masse radical, de se rappeler sans cesse dans quel type de société on vit, de s’intéresser au fonctionnement de l’État et du capital. La condition préalable à toute intervention est de ne pas se laisser piéger de quelque façon que ce soit, mais de maintenir une critique radicale de la domination étatique et de l’exploitation capitaliste – une critique qui ne se limite pas à des phrases toutes faites, mais qui est formulée à la hauteur du développement de l’État et du capital, ce qui n’est pas si simple.
Traduit par I. J.