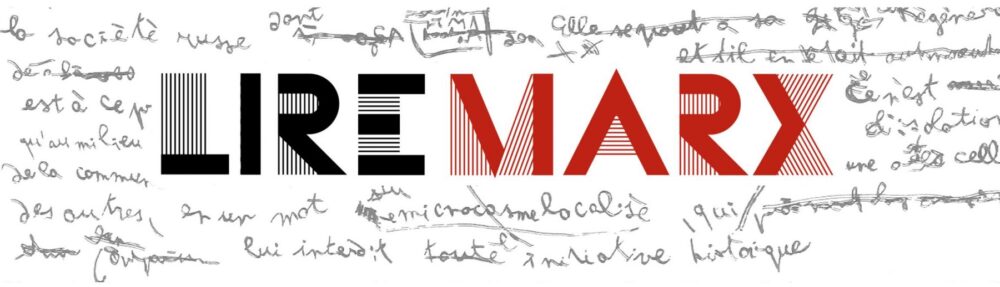Commentaire de K. Marx & F. Engels,
L’idéologie allemande, I, « Feuerbach »
Ce texte rédigé de concert par Marx et Engels en 1845-1846 s’inscrit dans une tradition de pensée à laquelle ils cherchent à répondre. Cette tradition c’est celle des philosophies de l’histoire, et particulièrement celle dont ils héritent conjointement de par leur formation allemande, celle de Hegel et de ses élèves. Mais plus encore que cette critique ciblée, ce que les auteurs mettent en œuvre ici, c’est une critique du fondement de toutes les philosophies de l’histoire, de la philosophie de l’histoire en tant que telle, pour y substituer une approche objective, qui s’attache aux faits. Au cœur de cette critique se trouve formulée une tension cruciale entre deux axes dont l’indossiciabilité est le propre de la théorie marxiste : les dimensions descriptive et normative.
Il s’agit pour Marx et Engels dans ce texte de montrer ce qui est déterminant dans le processus de développement historique. L’enjeu réside dans la détermination des éléments matériels et de leur influence dans le mouvement de l’histoire, ce qui revient à critiquer un fatalisme historique sous-jacent à l’idéalisme, c’est-à-dire, à rendre leur rôle aux acteurs de l’histoire. Or, en explicitant ce qui est déterminant par une approche descriptive il est simultanément énoncé où réside la force motrice du développement historique, et par conséquent, par qui et comment cette force est mise en œuvre. Ainsi, il est affirmé apparemment paradoxalement que si c’est l’ensemble des conditions matérielles d’existence des hommes (rapports de production, à la nature, aux individus) qui explique l’histoire, la force motrice de l’histoire, ce ne sont pas ces conditions. Elles expriment plutôt la force d’inertie de l’histoire. Ce qui constitue la force motrice de l’histoire c’est la formation de consciences révolutionnaires.
Afin de démontrer ce qui est à faire, il faut identifier ce qui est déterminant pour l’action. Or, pour pouvoir prescrire il faut avant tout décrire, et c’est ainsi que, passant d’une démarche descriptive en premier lieu de la méthode du matérialisme historique, puis ensuite de celle de l’historiographie elle-même, les auteurs en tirent les conséquences pratiques qui sont impliquées, en réalité toujours déjà dans leur conception matérialiste de l’histoire, en ce que celle-ci est en soi avant tout un ensemble de pratiques. La description de la méthode a un contenu prescriptif elle-même puis, explicitation de ce que cela « montre », puis ce que cela implique en termes normatifs (ce qu’il faut faire). Le mouvement s’effectue du descriptif au normatif, puis du prescriptif théorique (ce qu’il ne faut pas penser) au prescriptif pratique (ce qu’il faut faire) pour revenir à la signification théorique de ce renversement (ce que cela rend impensable).
—
La tâche à laquelle s’attèle les deux auteurs est semblable à celle que les philosophies de la vie se sont donnée : trouver un chemin afin de revenir au mouvement de la vie qui a été figé dans les concepts (par exemple, Georg Misch ou Wilhelm Dilthey), pour Marx et Engels, comprendre la pensée à partir de la vie dont elle est la pensée. Il s’agit donc en un premier moment de déterminer par quoi s’explique l’histoire. Autrement dit, expliciter en quoi la conception traditionnelle est invalide. Pour cela les auteurs explicitent pourquoi l’histoire ne s’explique pas par des idées ou une idée.
L’histoire se laisse aisément, voire par une tendance naturelle, mystifier, et ceci en ce qu’elle est un résultat. Ce résultat est constitué par les actions des individus qui leurs paraissent à eux-mêmes comme la manifestation d’une puissance extérieure, en ce qu’effectivement, ce qui s’y réalise ce ne sont pas les désirs de chacun mais une sorte de combinaison d’actions moléculaires. Conçue comme une succession d’époque, l’histoire se présente selon les polémistes plutôt comme une succession de « modes de production ». Le matérialisme dont se réclame Marx au début de l’ouvrage est ce qui est impliqué par sa position sur l’histoire : « Nous ne connaissons qu’une seule science, celle de l’histoire (p.14). Conditionnée par la base matérielle, cette base subit également des influences de facteurs idéels tout en étant le produit de l’action historique. Cela signifie que le développement de la production détermine la transformation des rapports sociaux, les formes diverses de domination de classes, et les modes d’existence matérielle et morale de tous les individus. Le sens du matérialisme défendu alors est à comprendre en tant que critique des conceptions idéalistes de l’histoire. Et effectivement, le titre de l’ouvrage fait référence à la mystification sociale et au produit nécessaire de la société bourgeoise qu’est la philosophie allemande à l’époque de Marx et Engels. On peut dire donc que dans le cadre du développement de la pensée de Marx et d’Engels, cette ouvrage marque l’amorce d’une analyse scientifique des conditions objectives et concrètes de la lutte dont ce passage est représentatif.
La tension première qui traverse ce passage de l’Idéologie allemande est épistémologique, ce qui est caractéristique de cet ouvrage, en ce qu’il annonce l’idée d’une science de l’histoire. Cette approche est la conséquence nécessaire de ce qui est constaté au paragraphe précédent, qui clame que tout renversement révolutionnaire se doit de « balayer toute la pourriture du vieux système qui lui colle après et de devenir apte à fonder la société sur des bases nouvelles. ». Ce geste consiste en un rétablissement de « l’ordre réel », tel que le formulait déjà Engels dans La Sainte Famille : « L’histoire ne fait rien, elle ne possède pas de « richesse énorme », elle « ne livre pas de combats » ! C’est au contraire l’homme, l’homme réel et vivant qui fait tout cela, possède tout cela et livre tous ces combats… [l’histoire] n’est rien d’autre que l’activité de l’homme poursuivant ses fins. » (VI, 2). Il s’agit donc d’un point de vue épistémologique de déterminer les causes à rattacher à un ensemble d’effets dont la somme constitue un processus, une marche, celle de l’histoire humaine. L’histoire est comprise comme l’étude du « système de liens matériels entre les hommes qui est conditionné par les besoins et le mode de production ». Pour cela, il est nécessaire de poser cette question en termes épistémologiques, car elle est « jusqu’ici » restée aux prises avec une fatale aporie. Effectivement, la « marche de l’histoire » est jusque-là comprise comme le processus de déploiement de l’esprit à lui-même. Or, si l’histoire s’explique par le déploiement de la Conscience de soi en temps qu’Esprit de l’esprit, cette explication doit non seulement chercher des catégories dans chaque période, et expliquer la pratique par l’idée, mais surtout n’est-il pas alors exclut par là même que l’histoire n’est pas faite par les hommes ? Peut-on pour l’expliquer faire abstraction de ce qui en réalité est déterminant, les circonstances et les hommes ? Cette tension épistémologique fonde la nécessité d’une nouvelle conception de l’histoire portée par un corpus d’affirmations explicitées en un premier moment par les auteurs.
Se déplaçant sur le terrain des idées, celui de leurs adversaires, Marx et Engels accèdent à la matérialité de la genèse, non seulement de l’histoire, mais également des idées. En un certain sens, ils privent leurs adversaires de leur sol, pour y substituer le leur, celui « du procès réel de la production » (l.2), « de la production matérielle de la vie immédiate » (l.3), ou encore « la pratique matérielle » (l.19), etc… Cet artifice argumentatif à la puissance redoutable est indissociablement un fondement pour la méthode que prônent les auteurs afin d’expliquer l’histoire.
Cette méthode permet de relier généalogiquement (« engendre ») les différentes formes d’existence matérielles et idéelles de l’homme pour en faire des modes particuliers de la production (Manuscrits, p. 145). Le mode de production désigne encore, comme dans les Manuscrits de 1844, le mode de vie en vigueur à une époque déterminée (IA 15). Cette méthode qu’ils décrivent permet d’expliquer le développement de la « forme des relations humaines » (l.4), que les auteurs nomment également « la société civile » (l.6) aussi bien que toutes les autres productions théoriques, notamment l’Etat. L’Etat devient par cela une « représentation » du procès réel de la production « dans son action ». S’ensuit que l’Etat constitue la forme des relations humaines en tant qu’elles sont liées et engendrées par le mode de production matérielle de la vie immédiate. L’Etat, ce n’est donc pas, le résultat « fantastique » de la génération du Genre par lui-même, comme l’écrivent les auteurs un peu plus tôt, et concevant par là-même la société comme un sujet qui dans une perspective idéaliste spéculative est un Esprit qui se révèle progressivement à lui-même, qui s’élève de la contingence propre à la matérialité par l’effort incessant provoqué par son incarnation sensible.
La particularité de cet Esprit dont se distinguent les auteurs à travers cette phrase, c’est son unité. Effectivement, pour Hegel, ce qui constitue la totalité, c’est « l’esprit du temps », un principe unique « qui s’exprime dans l’état politique comme il se manifeste dans la religion, l’art, les mœurs sociales,… » (Introduction à l’Histoire de la philosophie). Or, pour Marx et Engels, s’il y a unité, c’est seulement dans le fait que la base prenne toujours de nouvelles formes, c’est-à-dire, qu’elle engendre toutes les diverses productions théoriques, les formes de conscience, etc… Cette base n’a alors plus rien d’un esprit « substantiel d’une période, d’un peuple, d’un temps » (ibid). Plutôt que de s’expliquer par lui-même, c’est-à-dire, de se réaliser soi-même pour devenir absolue Conscience de soi à elle-même révélée, ces stades de l’histoire sont engendrés. L’engendrement est le mode de reproduction propre à une espèce, qui établit un lien de filiation, ce qui montre bien le caractère vital de ce processus (rappelons-nous « Ce n’est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience »). Mais cette critique de la conception de l’Etat permet également d’en dégager l’illusion hégélienne de sa rationalité. De plus, « l’illusion étatique » (terme apparaissant dans La Critique de la philosophie du droit de Hegel) soutient toute forme d’émancipation nécessairement illusoire, car elle s’effectue sous la forme de la citoyenneté abstraite, telle qu’elle apparaît dans la révolution politique française de 1789. A un autre niveau encore, mais qui suit scrupuleusement les conséquences des prescriptions méthodologiques, cet Etat n’est qu’une idéalité au sein de laquelle des intérêts de classe, par le recours à l’universalisation, s’expriment.
Ainsi est articulé le renversement de la conception de l’histoire, en suivant une méthode qui ne ramène plus la matérialité à une détermination idéelle du type de la prise de conscience par la Conscience de soi par elle-même, pour devenir esprit de l’Esprit. Sa méthode est de ne prendre en compte que la composante des modes de production et des formes qui les caractérisent, qu’ils prennent la forme d’institutions ou encore d’idées. Jusqu’à présent les auteurs se sont limités à décrire ce par quoi doit être expliquée l’histoire, en ayant plutôt considération pour ce qui constitue sa base, et ce qui est véhiculé par la conception idéaliste, sans encore expliciter la signification de ce nouveau principe explicatif pour l’histoire elle-même. L’histoire n’avait donc pas été considérée jusque-là (l.26) en terme de « science » (le terme n’est pas dit dans le passage, mais l’aspect méthodologique et la prétention à l’objectivité le suggèrent) qui doit faire l’objet d’une refonte afin de ne pas se leurrer sur les causes efficientes dans l’objet de son étude. Mais qu’est-ce que cette conception nous « montre »-t-elle (l.29) ?
—
Effectivement, il n’est alors plus question de la conception de l’histoire, mais immédiatement de l’histoire elle-même, ce qui en constitue par exemple « la force motrice » (l.27). Il est bien question non pas de la conception de l’histoire mais de ce que cette conception « montre », par exemple, sur sa possible finalité. Si elle s’explique par le développement du processus « réel » de la production quelle est la force motrice de l’histoire, ce qui fait qu’elle change ? En écrivant que la « force motrice de l’histoire » est la révolution, il est non seulement dit, et ceci explicitement, que ce n’est pas la critique intellectuelle qui est l’origine de changements de formes des liens matériels et du mode de production (inclus la vie idéelle) mais également, que le procès réel de la production n’est qu’une base. En tant que base, elle n’est donc pas, par distinction au renversement révolutionnaire, une force motrice, mais une force inertielle. Et effectivement, en ce qu’elle conditionne chaque stade en en faisant un « résultat » composé de forces productives à partir duquel les hommes vont agir. Ainsi, cette base conditionne tout en rendant possible une modification les conditions d’existence d’une nouvelle génération. Elle est bien ce mouvement qui sans frottement se poursuit à l’infini. Cette base constitue simultanément l’ensemble des conditions de possibilité, que d’impossibilité, et en cette formulation devient visible que l’évaluation de l’une ou l’autre des tendances répond à la question « Que puis-je faire ? ».
L’enjeu de ce moment purement descriptif est donc de ne pas tomber dans un déterminisme qui mènerait au fatalisme, c’est-à-dire, à l’inaction politique, radicalement opposé au projet marxien d’émancipation. En effet, une approche déterministe prônerait la toute-puissance des causalités auxquelles les hommes sont soumis. Ces causes sont ici réunies sous le terme « circonstances » (l.36, 40, 41) lesquelles « impriment un développement déterminé » (l.38-39) et pour éviter l’écueil susmentionné sont posées comme elles-mêmes produites par les hommes : « les circonstances font tout autant les hommes que les hommes font les circonstances » (l.40-41). Dans cette phrase se concentre la tension identifiée comme constitutive entre la dimension descriptive (scientifique) et normative (révolutionnaire) de la théorie de Marx et Engels.
Ainsi, l’histoire est constitué de « stades », qui se présentent comme un résultat matériel « double ». Ce caractère double correspond à une opération logique de division du concept « stade » en deux autres exclusifs qui recouvrent totalement le domaine de validité du premier. Cette dichotomie provient d’une considération générique d’une part et holiste de l’autre du stade historique. Premièrement, le stade génériquement observé est considéré comme ce qui est « donné » dans un double aspect, d’un côté comme « la somme » de forces productives, de l’autre, comme des « rapports » à la nature et rapports entre les individus. La force productive, c’est la puissance des individus agissant, la force du travail vivant. Les rapports entre les individus et à la nature constituent les rapports de production, c’est-à-dire, « la forme des relations humaines liée à un mode de production » (l.4). Toutes ces composantes ont été « créées » (« geschaffen ») historiquement, c’est-à-dire qu’elle n’ont pas l’immanence (toujours médiatisée tout de même) de « la vie immédiate » (l.3). Le stade historique est ici considéré comme résultat donc quantitatif et structurel, une somme, et un ensemble de formes (des rapports et leur développement). Deuxièmement, holistiquement, c’est « la masse » qui constitue la totalité d’un stade, comprenant non pas des forces productives mais des forces de production ainsi que des capitaux et des circonstances. Etonnamment, la traduction inverse les termes de Produktionskräften en forces productives et Produktivkräften en forces de production (MEW Bd. 3, 38), ce qui n’a pas le privilège de rendre clair le lieu où nous verrons, se rencontrent ces deux dimensions. Le stade historique considéré en tant que somme et ensemble de formes est considéré à l’horizon de son origine, des différents rapports constitutifs pour celui-ci, alors que dans la considération massique, il n’est pas question de forme ou de somme, mais d’unités encore indistinguées et indivisibles, c’est-à-dire, d’hommes, d’argent réel déposé dans des coffres, mais surtout le lieu du possible : du circonstanciel.
Que le stade considéré d’un point de vue massique soit le lieu du circonstanciel exprime, qu’en distinction, le circonstanciel ne se trouve pas dans le stade considéré quantitativement et formellement. Le stade considéré comme tel est appréhendé dans la nature historique de l’ensemble des formes dont il est constitué qui ne sont pas circonstancielles, et par conséquent, ne répondent pas à la contingence afférente à cette notion, mais sont nécessaires. C’est donc en tant que somme et ensemble de formes que les stades de l’histoire peuvent être appréhendés « scientifiquement », c’est-à-dire comme répondant à des lois pouvant faire l’objet d’une science, mais surtout, tel qu’il est formulé : « dictent » (l.37). Alors que ces stades considérés comme « masses » ne dictent pas mais peuvent se faire « modifier » par les nouvelles générations. La dualité entre normatif et descriptif se dédouble : c’est la dimension normative de l’histoire qui rend possible sa description (elle dicte), mais c’est en ce qu’elle est un ensemble qui ne répond qu’aux lois des hommes qui la constituent actuellement (pouvant modifier), qu’elle n’est pas descriptible, mais répond à une nécessité d’ordre moral et appelant un discours normatif sur ce qui doit être réalisé.
C’est dans cette perspective que peut être totalement comprise la phrase « les circonstances font tout autant les hommes que les hommes font les circonstances » (l.41-42). Il n’est pas question des mêmes circonstances, mais d’une part des circonstances comme somme et ensemble de formes, et de l’autre des circonstances comme masse. La nature mathématique du terme « somme » n’est pas choisie par hasard, associée à la mathématique est la rigueur scientifique, alors que du côté de la masse, s’il y a certainement la nature scientifique de la physique qui peut également apparaître, ne faut-il pas plutôt y voir mise en avant la matérialité, et avec elle la maléabilité de l’objet désigné ? Une masse n’a pas de forme, mais le stade historique qualitatif et formel est bien considéré sous l’angle d’un ensemble de formes. La masse est informe et demande à être manipulée, elle est un ensemble d’atomes qui connaissent une certaine concentration rendant possible des liaisons et des ruptures. Les premières circonstances sont donc l’objet d’une science méthodique visant à mettre à jour les lois à l’œuvre dans l’histoire, et les deuxièmes, ce sont celles qui sont l’objet de la manipulation. Or, les comprendre ainsi implique le risque toujours très proche de les substantialiser et d’accorder à chacune de ces natures du stade historique une sorte d’autonomie. Cette autonomie disparaît quand on observe la manière dont ces deux dimensions du stade historique se rencontrent : quand les rapports de production se retrouvent en inadéquation avec les forces productives. Les rapports de production s’insèrent bien dans le stade historique considéré comme somme et ensemble de formes, alors que les forces productives appartiennent bien plutôt à ce stade considéré comme masse (d’où notre impression que traduire « Produktionskräften » par « forces productives » pour le stade considéré comme somme soit inapproprié).
Cette approche que nous avons appelé « dichotomique » et dont la non-exclusivité des termes nous fixe les limites de cette appellation, tout en la justifiant, est amenée par les auteurs au niveau de la production intellectuelle. Il est remarquable qu’à nouveau il est question du stade historique considéré comme somme de « forces » et « formes de relations sociales » (l.41). Ces forces nous les avons identifiées plus haut à la force inertielle de l’histoire, par distinction à la force motrice, ce qui recoupe encore la distinction somme, ensemble de formes/masse par inertie/moteur. Ainsi, la force correspondante au stade considéré comme somme et ensemble de formes est l’inertie alors que la force correspondante au stade considéré comme masse est motrice. Le stade historique comme somme et ensemble de formes correspond alors à ce que les auteurs résument dans les termes « données existantes » (l.44). Le stade considéré comme tel exerce donc la force inertielle qui s’exprime au travers d’idéologues. Ainsi, par cette conception du stade et de la nature de la force qu’il exerce, c’est le chemin vers la remontée à ce qui est l’origine vitale du concept de « substance », et d’ « essence de l’homme » qui est ouvert.
La fin de cette partie entre en résonnance avec son commencement : en identifiant ce qui constitue la force motrice de l’histoire, les auteurs en avaient exclu la Critique, ce contre quoi à nouveau ils s’adressent, mais en ayant révélé entre temps que la production intellectuelle de leurs adversaires n’est que le produit de la force inertielle, et non de la force motrice. Les philosophes qui se révoltent contre cette base ne la touche pas, et cela est rendu visible par le fait que les hommes qui vivent sur cette base, qui devrait être commune, ne sont pas affectés par ces révoltes idéelles. Ces philosophes ne sont pas anonymes : ils se révoltent « en qualité de » écrivent les auteurs. C’est-à-dire, que c’est en se considérant d’une manière particulière soi-même, se donnant un nom hégélien de « Conscience de soi » et stirnerien, d’ « Unique ». Par cette référence, les auteurs montrent que eux s’adressent bien à quelqu’un, mais à un quelqu’un qui se prend pour un « autre chose ». C’est un processus d’autopersuasion, d’illusion, dirons-nous même, d’aliénation négative qu’ils mettent ici à jour : ces philosophes se révoltent contre la base concrète en l’appelant « substance » et en se prenant pour des « Conscience de soi » ou des « Unique ». La portée polémique du texte résonne ici sans aucun doute, mais sans pour autant abandonner la substance (!) de la critique adressée, mais la renforcer, lui donner « du corps ».
—
La troisième partie nous propose une pensée du changement. Le stade considéré comme somme et ensemble de formes devient alors « conditions de vie » (l.51). Il s’agit de d’identifier dans quelle mesure le stade historique qualitatif et formel « détermine si » (l.52-53). Dans ce passage, les auteurs élargissent encore la définition du stade historique quantitatif et formel pour le constituer comme le fondement « absolu ». Effectivement, le stade historique en tant que somme et ensemble de formes devient la base « de tout ce qui existe » (l.55). Ce que le stade historique considéré comme tel, et identifié à la « base concrète » (l.44), rend possible ou impossible, c’est donc sa propre anihilation : le stade historique quantitatif et formel, c’est ce qui détermine si « la secousse révolutionnaire…sera assez forte pour renverser les bases de tout ce qui existe » (l.53-55).
La secousse révolutionnaire, c’est ce qui a été identifié comme la force motrice de l’histoire, se distinguant alors de la Critique intellectuelle (l.26-27). Elle est constituée à nouveau d’une somme et d’une masse, d’une somme de « forces productives » et d’une « masse révolutionnaire qui fasse la révolution » (l.56-58). Si on retrouve les mêmes catégories que celles par lesquelles avaient été définis les stades historiques, la seconde, celle de masse gagne une profondeur remarquable : elle est « consciences ». Dans une certaine mesure, c’est bien la pluralité de la conscience qui se révèle être ici être mise en potre à faux à la « Conscience de soi » hégélienne. Ainsi, la force motrice de l’histoire est la formation de consciences, c’est le fait de donner une forme à la masse. Quelque part on voit encore ici se rencontrer les deux dimensions, quantitative et formelle avec celle massique, mais à un autre niveau, celui où la masse prend forme. C’est uniquement par ce moyen que la masse peut agir sur elle-même, et devenir malléable, c’est en étant « formée ». C’est donc considérée comme consciences que la masse peut agir sur elle-même, et transformer jusqu’aux bases quantitatives et formelles qui constitue « tout ce qui existe ». C’est donc en passant d’une masse indistinguée et indivisible à des consciences formées, et par là se distinguant les unes des autres, que la secousse révolutionnaire peut avoir lieu, tout en étant intimement liée aux « forces productives existantes », le donné.
Mais les auteurs vont un peu plus loin encore, car l’indétermination caractéristique du « faire la révolution » est en réalité insatisfaisante. Ce qui se « reproduit régulièrement dans l’histoire » (l.53-54), qui stricto sensu, suit comme un astre une trajectoire sur une orbite régulière, revêt fortement l’aspect d’une force inertielle, justement, non caractéristique de la révolution. Pour être véritablement force motrice donc, la révolution telle qu’elle est ici présentée doit être orientée : « contre » une même chose, ses conditions d’existence, mais sur trois niveaux différents.
Le premier niveau de l’orientation du mouvement révolutionnaire se situe à la contingence « des conditions particulières de la société passée » (l.59). C’est-à-dire, ce qui constitue la base du stade historique considéré quantitativement et formellement, comme l’agencement de la « somme » des forces de production, et des formes afférentes à un mode de production particulier. Ce niveau peut être qualifié de la dimension sociale de la production de l’existence, en ce que c’est l’ensemble des formes que prend cette production et reproduction. Dans un mouvement rétrograde il faut cependant « remonter » à un autre niveau « antérieur » (l.60). Cet autre niveau, c’est celui de la « production de la vie ». C’est ce qui a été identifié de manière moins elliptique au début de ca passage comme constituant le point de départ de la base de la conception de l’histoire proposée : la base étant le « développement du procès réel de la production » et son point de départ « la production matérielle de la vie immédiate » (l.1-3). Ainsi, se tourner contre la production de la vie, c’est interroger la dimension historique des rapports que les hommes nouent, et remettre en question, en dernière instance la dimension naturelle qui pourrait lui être attribuée, tel que le firent Ricardo et Smith. Ces derniers effectivement tenaient pour naturel ce que Marx se borne à reconnaître comme une simple étape (IA, p.14-15). Mais c’est églament une des pierres de touche de l’historiographie marxiste qui est mise en évidence ici : il y a production et reproduction des moyens d’existence pour la simple raison que les hommes doivent vivre. C’est ce qui peut être qualifié comme le point de départ matérialiste. C’est le stade où il n’est pas encore question d’économie et de ses superstructures.
Or, ce n’est pas encore contre le « fondement » que se dirige la révolution. Ce fondement, les auteurs l’appellent « l’ensemble de l’activité » dans lequel se fonde donc le « point de départ de la base » de l’historiographie. Si les auteurs ici précisent l’ensemble de l’activité, c’est qu’auparavant les domaines évoqués contre lesquels la révolution doit se tourner, ne recouvraient pas « l’ensemble », mais en présentaient des fragments. Ainsi, l’ensemble des agissements humains ne se résume pas à la production de la vie matérielle immédiate, ou encore à la production de conditions particulières. Car l’ensemble des activités humaines ne se limite pas à la production et reproduction matérielles, mais comprend aussi, tel qu’il est explicité au début de ce passage « l’ensemble des diverses productions théoriques et des formes de la conscience, religion, philosophie, morale, etc. » (l.9-10). On touche ici à la signification de « formation » en tant qu’acquisition par une masse indistinguée de la forme de la pluralité de consciences, ces consciences ayant donc également à se tourner contre ce qui est de même nature qu’elles. L’idée semble tout de même étrange, que le fondement de la production de la vie se trouve dans l’ensemble des activités théoriques. En réalité, elle ne l’est pas, car ici, par l’insertion de toutes les activités dans le processus de renversement révolutionnaire, c’est une congénialité qui se révèle, bien plutôt qu’une prédominance. Le fondement identifié contre lequel les consciences révolutionnaires doivent se tourner correspond donc à la totalité des activités, c’est-à-dire, ne doivent pas se limiter à une des activités humaines. Si une distinction a lieu, elle n’est par conséquent que formelle et non substantielle. Ainsi, l’homme n’est pas scindé entre son activité productive et reproductive matérielles et son activité « théorique » de production de consciences et de ses formes. Cela correspond à l’entreprise des auteurs qui en assignant une origine matérielle à la production des idées entérinent en réalité leur indissociabilité.
La possibilité même d’un renversement total des bases de tout ce qui existe est constituée par l’ensemble de ces « conditions » (l.63). De préciser cela permet aux auteurs de rappeler que l’énonciation de ces conditions ne suffit pas, que cela n’a qu’un caractère idéel. L’idéalité de cette énonciation qui revient donc en réalité à faire de ce bouleversement une « Idée » ne peut donc avoir aucune influence par elle-même. Par elle-même, puisque doivent également être réunies les conditions énoncées. L’idée n’est donc pas vidée de sa force et de son effectivité possible sur la réalité matérielle, mais elle répond en quelque sorte à ces conditions pour les montrer en tant que conditions du bouleversement. Ce que l’idée peut faire, c’est donc exprimer le lien qui n’est pas immédiatement visible entre les différents éléments composant la période dans laquelle pourrait avoir lieu ce bouleversement. Pour justifier cela, les auteurs se fondent sur « l’histoire du communisme » (l.65). Une phrase du Manifeste du Parti Communiste (1848) nous éclaire sur la signification que doit prendre cette histoire mais surtout du rapport des idées soient-elles communistes ou non dans le processus historique : « Lorsqu’on parle d’idées qui révolutionnent une société tout entière, on énonce seulement ce fait que, dans le sein de la vieille société, les éléments d’une société nouvelle se sont formés et que la dissolution des vieilles idées marche de pair avec la dissolution des anciennes conditions d’existence. » (MPC, p.20). Ainsi, l’histoire du communisme dont il est question ici, c’est celle de l’énonciation par les classes dominantes d’idées qui permettent de résoudre l’acuité des antagonismes de classes, ou bien d’une simple réactualisation des idées pour qu’elles correspondent aux nouvelles conditions d’existence. Plus précisément, ce sont le socialisme féodal, qui en énonçant la nécessité d’un renversement s’illusione (« Ils déguisent si peu, d’ailleurs, le caractère réactionnaire de leur critique que leur principal grief contre la bourgeoisie est justement de dire qu’elle assure, sous son régime le développement d’une classe qui fera sauter tout l’ancien ordre social. » MPC, p.21) ou encore le socialisme petit-bourgeois réactionnaire et utopique, le « vrai » socialisme allemand, etc… Dans un certain sens, le fait qu’ils n’aient pas pris en compte la composante matérielle implique qu’ils n’aient pas perçu la réelle force de l’idée révolutionnaire.
Ce qui a été énoncé donc dans ce passage était la « base réelle » qui avait jusque-là toujours été absente des conceptions de l’histoire (l.67). Dans le dernier paragraphe, c’est presque une forme de modestie qui transparaît, comme si les auteurs n’avaient simplement que réintroduit le réel dans l’histoire. Ce réel, ce sol, cette base, permet d’avoir un point de départ assuré et empirique pour comprendre ensuite toute genèse des productions humaines. Cette genèse, c’est le mouvement réel, appelé la « marche » (Verlauf) par les auteurs ayant en français la double signification du mouvement réel, mais aussi, de fonctionnement (« Comment ça marche ? »). Saisir la logique interne de l’histoire, c’est donc saisir ce qui fait qu’elle se meuve, ce qui doit la mettre en branle : les conditions de la révolution prolétarienne.
—
En partant de la résolution d’une question épistémologique, par la prescription d’une méthode d’observation du développement de l’histoire, les auteurs ont émis deux thèses : premièrement, la nécessité de ne s’attacher qu’à la vitalité à l’origine de toutes les productions humaines en ce que cette méthode prend uniquement en compte la composante des modes de production et des formes qui les caractérisent et deuxièmement, que ce fondement empirique rend possible une observation objective, c’est-à-dire, une science de l’histoire comme l’étude du « système de liens matériels entre les hommes qui est conditionné par les besoins et le mode de production ». Cette prescription méthodologique a ensuite débouché sur des considérations sur l’histoire elle-même, autrement dit, les conséquences qu’elle implique sur ce qu’est l’histoire. Comprendre ce qu’elle est revient à en identifier ce qui constitue son mouvement : la force motrice. Celle-ci se retrouve en porte-à-faux avec une force inertielle qui n’aboutit pas à des ruptures dans le mouvement de l’histoire mais seulement à des soubressauts qui permettent la réadaptation des modes de production aux forces productives. Cette distinction permet de penser la force de l’idée et l’influence de la prise de conscience dans son lien avec les conditions contre lesquelles elle s’élève.
Une distinction dans la détermination des stades historiques entre quantitatif, formel et massique est ce qui a permis de situer au niveau de l’étude historique la différenciation entre force motrice et inertielle. Cette distinction a pu rendre l’articulation cruciale entre déterminantes externes au bouleversement de toute chose existante (stade historique formel et quantitatif absolutisé) et les déterminantes appartenant au mouvement réel des hommes, dont la force motrice elle-même est la prise de conscience. En résulte que la formation de la masse informe des forces productives en consciences combinée à un ensemble de conditions, la base formelle et quantitative, mais aussi la direction et la radicalité de l’entreprise révolutionnaire. On peut dire qu’il en résulte que c’est un « moment » qui rend possible de renverser tout ce qui existe, un moment dans lequel se combinent déterminantes objectives et subjectives.
La réduction au théorique et le confinement de la critique à l’ordre du concept est caractéristique de la pensée des Jeunes Hégéliens qui n’est autre qu’une formulation sublime du fatalisme régnant au cœur des consciences des nouvelles générations. C’est contre ces idéologues et simultanément pour la formation de la conscience des nouvelles générations que ce texte prend les armes. Afin d’effectuer cette critique, une évidence apparaît : l’ineptie de dissocier la description de l’histoire du devoir de former des consciences révolutionnaires. Dans ce passage de l’Idéologie allemande, c’est donc par ce moyen que « l’immanence de la prospective » est apparue. C’est-à-dire, l’immanence du diagnostic à la formulation des conditions de la transformation, émettant par là l’idée que comprendre l’histoire et ce qui peut la transformer sont inséparables. Cette immanence est déjà succintement condensée dans la 11ème thèse sur Feuerbach, qui dit en substance qu’interpréter le monde c’est rendre intelligible ce qui importe : le transformer. C’est ce qui sera encore formulé plus tard dans la Postface de 1873 à la 2nde édition du Capital : « l’intelligence positive de l’état de choses existant… inclut du même coup l’intelligence de sa négation. » (p.17-18).