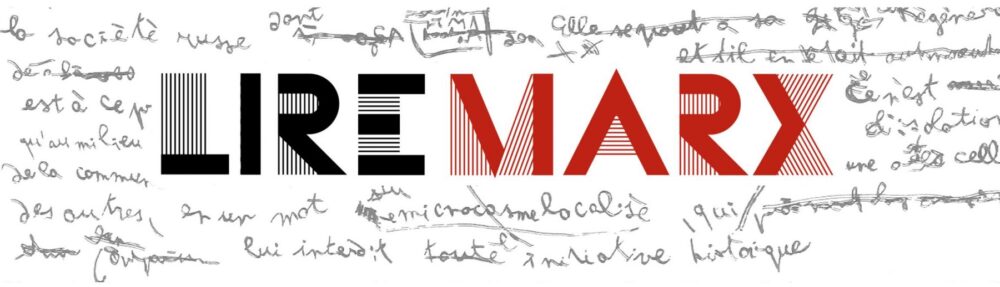Commentaire du texte d’Aristote,
Métaphysique, Lambda, 7, 1072b-1073a3
Dans ce texte, Aristote définit ce qu’il faut entendre par le premier principe. La difficulté principale dans la compréhension de ce principe est l’obstacle que constitue notre entente de la mise en mouvement sur le modèle causal. Or, ce qui fait que la substance immobile est l’objet de la métaphysique, provient du fait qu’elle n’a aucun principe commun avec les autres espèces de substances (1069b). Pour mettre en évidence une différence qui, somme toute donc, concentre la tension entre la physique et la métaphysique, Aristote opérera une remontée génétique en allant du mouvement en général vers le premier moteur. En cherchant à répondre à la question de l’origine du mouvement, il pourra ensuite en arriver à définir la nature du premier mouvement, et le distinguer de son moteur. Cela lui permettra de déduire un ensemble d’autres qualités propres au Premier Moteur, et ainsi remettre en question la thèse selon laquelle ce moteur serait à identifier à une cause. La difficulté de cette distinction provient notamment du fait que « toutes les causes sont des principes » (Métaphysique, Delta, 11013a18). Après avoir démontré la nécessité qui découle de l’essence du premier moteur d’être tel qu’il est, Aristote précisera ce qu’il entend par nécessité et cela l’amènera à pouvoir discuter la thèse de la nature de Dieu compris comme un vivant éternel et parfait. Cette triple définition permettra de rendre la distinction entre cause efficiente et principe plus claire. Mais face à cette conclusion, il faudra comprendre pour quelle raison Aristote initie son raisonnement par la tentative d’introduire une sorte de cause, la cause finale, parmi les êtres immobiles. Aristote doit rendre raison de la nature du premier principe en ce qu’il est l’objet de la métaphysique, et en ce qu’il a été mécompris par de nombreux philosophes, en particulier car ils n’en ont pas saisi adéquatement la nature immatérielle. Cette démonstration entre dans une partie essentielle de la Métaphysique, le livre Lambda qui a pour particularité de développer ce qu’il faut entendre par l’être en tant que tel.
La tâche qu’Aristote assigne à la philosophie première est de chercher le principe, qui est autre que les causes efficientes, et qui est ce dont provient le commencement du mouvement (Métaphysique, Alpha, 3984a). Afin d’en arriver à la détermination de la nature du premier moteur, Aristote part d’une objection qui pourrait lui être faite. Cette objection est sous-entendue dans la première phrase. On pourrait en effet croire que la cause finale n’appartient pas aux êtres immobiles, c’est-à-dire qu’elle « résiderait » dans les êtres mobiles. Les êtres mobiles sont tous les êtres mus, que ce soit selon la substance, le lieu, la quantité ou la qualité. La cause finale ne résiderait pas parmi les êtres immobiles de par une nécessité qui provient de sa définition, c’est-à-dire la signification qu’elle revêt. Le principe de toute démonstration est l’essence, connaissance à la quelle on arrive par les propriétés, et qui ensuite doivent être par un mouvement descendant, connaissables par les définitions trouvées (Physique, VII). La signification de la cause finale est double en ce qu’elle peut désigner le but, comme le bonheur, et celui pour qui elle est un but, par exemple, Socrate. Et c’est seulement en tant qu’elle est un but que la cause finale appartient aux êtres immobiles. L’impossible appartenance aux « êtres immobiles » de la cause finale entendue comme « Socrate » provient du fait que Socrate est mu par la cause finale, et qu’ainsi, il est par définition, mobile, changeant. Aristote a mis en évidence pourquoi la cause finale « peut » résider parmi les êtres immobiles, il n’a pas encore affirmé qu’elle en était un ou qu’elle y existait effectivement. Il a mis en un premier temps en évidence la possibilité de sa résidence parmi les êtres immobiles par sa définition.
C’est dans le lien à présent que cette cause finale entretient avec ce qu’elle meut qu’il sera possible de mettre en évidence que son existence est non seulement immatérielle, mais surtout nécessaire. Ainsi, la cause finale entraîne le mouvement parce qu’elle est un objet pour un sujet, en ce que celui-ci est désirant. Il semble qu’ici le mouvement provienne plutôt du désirant que du désiré mais ce serait mal comprendre ce que dit Aristote. Au paragraphe précédent, il affirme en effet qu’une chose est désirée parce qu’elle nous semble bonne et non pas qu’elle est bonne parce que nous la désirons, ce à quoi il rajoute, « le principe, c’est la pensée ». Ce qu’il y a de premier n’est pas le désir mais la nature de la chose désirée et l’intelligibilité que nous en avons, autrement dit, le mouvement provient de la nature bonne de la chose désirée. Ainsi, le mouvant est mu par la nature du moteur. La cause finale a la puissance de provoquer le mouvement de par sa nature bonne.
La deuxième partie de la phrase, « et elle meut les autres choses par une chose qui est mue » détermine un rapport de médiation, « par », qui précise le processus par lequel il y a mouvement. Cette chose qui est mue et qui est ce par quoi l’objet du désir meut semble ici encore impossible à déterminer. La traduction Tricot nous permet de sortir d’une certaine obscurité dans la formulation en ce qu’il traduit « et toutes les autres choses meuvent parce qu’elle sont mues elles-mêmes ». Cette traduction met en évidence un rapport de nécessité définitionnelle (« parce que »), qui fait que tout ce qui est désirant met en mouvement, en plus d’être soi-même mu. C’est donc en vertu du fait qu’une chose est désirante, c’est-à-dire animée par une cause finale, qu’elle devient cause elle-même.
Quelle conséquence a le fait d’être en mouvement sur la nature, ou l’essence d’une chose, ce qui fait qu’elle est ce qu’elle est et non pas autre chose ? Justement, que cette essence n’est pas fixe, qu’elle peut être autrement que ce qu’elle est, c’est-à-dire qu’elle entre dans le règne de la contingence, du hasard. Elle perd la nécessité d’être selon sa propre nature. Cette perte de nécessité provient de la possibilité (« elle peut aussi ») ouverte par la nature du mouvement même. Pouvoir être autrement que ce que l’on est s’entend selon les quatre modalités du mouvement, l’altération, la corruption, la translation, l’accroissement. Alors qu’il est question ici du mouvement tel qu’il a lieu en tant qu’il est désiré, qu’en est-il du premier mouvement ? D’une définition qui portait sur le mouvement en général et son origine, Aristote le spécifie pour un mouvement particulier, le premier. Celui avant quoi il n’y a pas de mouvement. Il établit un rapport de conséquence (« Par conséquent ») qui est confronté à une difficulté (« même si »). Cette difficulté est que le premier « déplacement » soit « aussi acte ». La traduction Tricot met ici en évidence qu’il s’agit du mouvement de translation chez celui qui est maintenant susceptible d’être autrement du fait qu’il est mu par une cause finale. Il ne s’agit donc pas du premier déplacement dans l’absolu, mais dans l’individu animé d’un désir. Cette traduction met en évidence que le premier mouvement possible est celui de translation, d’un mouvement dans l’espace. Pourtant, même mu par le désir provoqué par la nature d’une cause finale, et donc sujet possible du changement, Aristote précise que ce changement ne s’opère que sous la modalité du lieu, et pas de sa substance, c’est-à-dire qu’il n’y a pas encore de principe à sa génération ou à sa corruption. Cette nécessité provient du fait que tout processus de génération implique l’existence d’un terme.
Cependant, le développement n’a pas permis de mettre en évidence la nature immobile de la cause finale, mais bien plutôt de ce en vertu de quoi elle meut. Dans cette mesure, il faut s’attacher à présent à ce « quelque chose qui meut tout en étant lui-même immobile ». Aristote part donc ici d’un présupposé, celui selon lequel il y a quelque chose qui meut tout en étant immobile, que cette chose existe. Du fait de cette existence découle la nécessité dans sa définition de ne pas être possiblement autrement qu’il n’est. Comment comprendre le fait que ce quelque chose soit l’immobile et qu’il soit « en acte ». Qu’est-il « en acte » ? Pour cela, il faut remonter un peu dans le livre Lambda, au chapitre précédent où il est démontré qu’il faut « qu’il existe un principe tel que l’acte même de mouvoir en soit l’essence » (1071b). Être en acte signifie être parfait ou achevé par opposition à la puissance, la potentialité, et c’est pourquoi un existant singulier est un être en acte, alors que la matière indéterminée est un être en puissance. Cette perfection provient de la nécessité reconnue plus tôt que le mouvement est éternel, et que pour cette raison, il doit y avoir un mouvement qui ne s’arrête jamais, et donc quelque chose qui meut sans être mu, mais dont le principe doit être de mouvoir.
Ce qu’Aristote énonce ici, et que nous avons reconnu comme étant une présupposition sans argument démonstratif, à savoir qu’il existe quelque chose dont l’acte est de mouvoir tout en étant immobile, découle (« en effet ») de la nature même du premier déplacement. Il faut remarquer le changement de modalité dans l’énoncé. Alors qu’en premier lieu il s’agissait de déterminer une possibilité, celle de la cause finale à résider parmi les êtres immobiles, il s’agit à présent d’affirmer pleinement une existence, ce qui est rendu manifeste par la copule « être », laquelle sert à signifier qu’une proposition est vraie (troisième définition d’être dans le livre Delta).
Le premier mouvement a été reconnu comme étant nécessairement selon le lieu et non selon la substance, or l’éternité du mouvement nécessite qu’il n’ai pas d’arrêt, et cette possibilité est donnée par la circularité. Ceci a déjà été énoncé plus avant, « il n’y a de mouvement continu que dans le lieu, et encore faut-il que ce mouvement soit circulaire » (1071b). Cette proposition n’est pas démontrée dans la Métaphysique, mais dans la Physique (VIII, 8, 261b27, 264a). C’est en vertu du fait que le déplacement circulaire est le premier déplacement, dont le moteur immobile est le moteur, que ce dernier existe (« il y a quelque chose qui meut… ») et qu’il ne peut pas être autrement qu’il n’est (proposition précédente qui devait être prouvée (« en effet ») par ce développement). Cela signifie que le premier moteur immobile ne peut pas être contingent, et, de par la nature du mouvement de translation circulaire, il pourrait en être le sujet, si ce n’était pas lui qui le produisait. Le moteur immobile existe donc de par le fait qu’il produit le mouvement de translation circulaire. Car il n’aurait pas été en contradiction avec son essence qu’il soit sujet d’un tel déplacement, puisque ce dernier n’implique pas ni arrêt, ni changement qui aurait fait que le moteur immobile soit autrement qu’il n’est.
Il s’ensuit (« donc ») que cet être échappe à la contingence. Échapper à la contingence rend possible dans le système aristotélicien d’avoir une science de la chose observée. L’origine de l’impossibilité d’avoir une science du particulier, et seulement de l’universel, provient du principe d’indétermination introduit par la matière qui la rend inintelligible. C’est pour cette raison qu’il peut y avoir connaissance du particulier s’il est immatériel seulement, comme dans le monde supralunaire (Métaphysique, Z, 15). L’essentiel pour avoir connaissance d’une chose revient dont à devoir mettre en évidence sa nécessité. En plus d’en rendre possible la connaissance possible, la nécessité permet à Aristote de mettre en évidence des rapports d’identité : ce qui est nécessaire est « de la nature du beau », ou Tricot, « il est le Bien » (traduction qui omet cependant l’absence du kagathos, et par conséquent ne signifie que « beau », sans lien donc avec l’idéal de la conduite personnelle signifiée par le kagathos et induite dans la notion de Bien), et ce qui est nécessaire est « un principe » (Tricot, « il est principe du mouvement »). L’originalité du développement aristotélicien est à comprendre dans la perspective où, en distinction avec la démarche platonicienne, il fonde ici l’existence du bien et du beau par le lien qu’entretiennent choses mues et le moteur. C’est-à-dire qu’il ne fonde pas l’existence de principes par leur universalité, mais bien par leur nécessité. L’absence de distinction radicale entre le singulier et l’universel est le principe formulé par Aristote contre la théorie platonicienne des Idées, et il est fondé dans l’inséparabilité de la forme spécifique et de l’individu.
L’appartenance du moteur immobile à la nature du beau en fait un principe (« et, de cette manière »). Or, comment comprendre le lien qu’établit ici Aristote entre le fait qu’une chose appartienne au beau et qu’elle soit un principe ? On trouve un éclaircissement sur ce rapport dans Métaphysique, Delta, 1, 1013a22 : « pour beaucoup de choses le principe de la connaissance et du mouvement, c’est le Bien et le Beau ».
Et c’est en raison de la centralité du concept de nécessité qu’il sera l’objet d’un développement particulier à nouveau dans ce texte. Ce sont trois significations qui sont dégagées par Aristote dans ce passage. Le nécessaire au sens de contrainte et de force, en tant que condition du bien (boire le remède pour ne pas être malade), et en tant que « ce en vertu de quoi il est impossible qu’une chose soit autrement ». Cette dernière définition entre en résonance avec la première définition du nécessaire donnée dans le livre Delta, 5, et qui fait du nécessaire une condition par distinction de la cause : « ce sans quoi, pris comme condition, il n’est pas possible de vivre » (1015a). Comment comprendre l’absence ici de la définition finale proposée par Aristote dans le livre Delta ?
En effet, il la définit alors, « dans son sens premier et fondamental » comme ce qui a en soi la source de sa nécessité, ce à quoi il ajoute, « Si donc il y a des êtres éternels et immobiles rien ne saurait violenter ou contrarier leur nature » (1015b). Cette dernière définition permet de mettre en évidence que selon Aristote, la première définition donnée du nécessaire dans ce livre Lambda, à savoir, la contrainte et la force, ne peut pas appartenir à la nature du principe moteur immobile. Le rapport d’identité établi précédemment entre le moteur et le beau (« il est de la nature du beau ») permet également d’exclure la deuxième définition comme étant adéquate à l’entente de la nécessité propre au moteur. Effectivement, la deuxième définition le pose comme condition du bien, et non comme de même nature, ou identique au bien (traduction Tricot). C’est donc seul au sens de ce en vertu de quoi il est impossible qu’une chose soit autrement que le nécessaire est ici compris.
Il s’agit à présent pour Aristote de rendre raison du caractère divin de l’intellect. Après avoir établi la nature nécessaire du dieu, en tant que moteur immobile produisant un mouvement de translation uniforme et éternel car circulaire, Aristote cherche à rendre intelligible la nature de l’acte divin dans son rapport au plaisir, à l’intellection, et plus généralement par rapport à ce qui appartient en propre à l’homme. C’est l’occurrence du « pour nous » qui permet de voir que le point de vue adopté par Aristote est différent de celui de l’inférence de la nature nécessaire du moteur immobile par le rapport qu’entretiennent le mu, le moteur mobile et celui immobile.
Immédiatement, il n’est plus question du principe lui-même mais de ce qui en dépend : « D’un tel principe dépendent le ciel et la nature ». Le ciel correspond à l’espace supralunaire, et la nature à celui sublunaire. La nature est le nom donné à la matière investie du principe de mouvement (Métaphysique, Delta, 4, 1015a17). Le monde sublunaire est caractérisé en distinction à celui supra lunaire par son imperfection. Au-delà de leurs différences, les deux mondes sont pourtant dans un rapport de dépendance à la même chose, au principe qu’est le moteur immobile.
« …nous demandons : quel principe ? afin d’aboutir à une réalité plus connaissable » affirme Aristote en Métaphysique, Z, 16. Il semble que c’est suivant cette volonté de rendre plus connaissable qu’il développe une comparaison de « son genre de vie » avec le nôtre. Ce genre de vie, qui dans son terme grec signifie la contemplation du beau, la fin pratique et l’idéal de toute vie, est caractérisé par son excellence. La différence se situe dans la limitation de sa durée pour nous, alors que pour ce principe, il ne cesse pas : il est « toujours ainsi ». L’origine de cette uniformité dans l’excellence, Aristote la situe dans le fait que son acte soit aussi plaisir (« puisque »). Ce qu’énonce ici Aristote, c’est que le lien intime du plaisir et de la vie bonne est valable autant pour les hommes que pour la vie divine. On retrouve cette affirmation centrale également dans Ethique à Eudème, VII, 15, 1154b, Dieu, acte pur et pensée de la pensée, « jouit perpétuellement d’un plaisir un et simple ; car il y a non seulement une activité de mouvement, mais encore une activité d’immobilité, et le plaisir consiste plutôt dans le repos que dans le mouvement ». Il s’agit ici d’une théorie du plaisir qui se distingue de celui de Platon (République, IX, 584a), ou d’Aristippe pour lesquels le plaisir est un mouvement, une poursuite, alors que pour Aristote, il est dans la possession. L’importance de la possession apparaîtra à nouveau plus loin dans le texte alors que se posera la question du rapport entre la substance et l’intelligible.
Pour soutenir son propos selon lequel l’acte divin est aussi plaisir, Aristote affirme comme étant la conséquente, que pour nous, l’éveil, la sensation et l’intellection « sont les plus grands plaisirs ». Toutes ces modalités de la vie humaine ont pour caractéristique d’être en acte. Elles se distinguent d’autres qui, comme le sommeil, sont imparfaites, car seulement une autre activité en puissance. Il les distinguent ici des espoirs et des souvenirs, qui ont la particularité de n’être des plaisirs « que par leur intermédiaire ». Ainsi, il semble que par la médiation, ces modalités perdent en quantité de plaisir. Le terme « quantité » est certainement peu approprié au plaisir, en ce que la quantité se dit de ce qui est divisible, et qu’il est peu concevable que le plaisir soit divisible. Don cil y a un rapport de grandeurs différentes entre des plaisirs distincts.
La phrase suivante propose une articulation entre l’activité d’intellection et son objet : la forme particulière d’intellection qui est « par soi », et l’intellection « à son plus haut point », sont nécessairement intellection du meilleur. L’intellection par soi est cette activité non médiatisée, dont on a vu qu’elle perdait en grandeur de plaisir si elle était médiatisée, par exemple lorsqu’elle rentrait en action dans le souvenir. L’immédiateté est effectivement un des sens du « par soi » isolé par Aristote en Métaphysique, Delta 18,1022a. Ce qui n’était qu’une différence dans la grandeur du plaisir ressenti dans l’acte d’intellection se trouve être maintenant formulé selon la qualité de ce qui est intelligé. La complétude de l’activité qui se tient par elle-même et se réalise elle-même a donc nécessairement l’objet intelligible le meilleur. La notion « d’intellect par soi » est alors précisée par Aristote comme étant l’intellection par l’intellect de lui-même. L’objet de l’intellection ne semble plus être le même dans l’intellection par soi, puisque c’était le meilleur par soi, alors qu’à présent c’est l’intellect. C’est qu’Aristote décrit à présent ce qu’il faut entendre par l’acte qui est l’intellection par soi. Il apparaît alors une forme de médiation manifestement, en ce que « l’intellect a l’intellection de lui-même par… » quelque chose. Cette chose est « une saisie de l’intelligible », c’est-à-dire une saisie de ce que l’intellect peut saisir, il ne s’agit donc pas d’intellection du sensible par exemple. C’est donc lorsqu’il saisi ce qui est intelligible qu’il devient intelligible pour lui-même, ce qui amène Aristote à établir un rapport d’identité entre l’intellect et l’intelligible. On retrouve cette identité entre le sens percevant et lui-même dans la saisie du perçu, c’est-à-dire une forme de réalisation parfaite du sens dans l’acte de percevoir dans le De anima. L’origine de cette idée est (« En effet ») que le fait d’être en acte est ce qui confère son caractère divin à l’intellect. Il comporte sinon une forme d’incomplétude, ou tel qu’Aristote le formule : « cet acte, plus que la puissance, est ce que l’intellect semble avoir de divin ». Ainsi, l’intellect en puissance, c’est-à-dire sans saisi de l’intelligible n’est pas, ou moins, divin, c’est seulement en acte qu’il acquiert ce caractère. Il est étonnant qu’il puisse y avoir du plus ou du moins divin, de même qu’il l’est d’avoir plus ou moins de plaisir, si ces déterminations ont la caractéristique d’être parfaites ou en tout cas, l’expression d’une forme de perfection. Mais cette gradation dans la perfection même se retrouve régulièrement dans le développement d’Aristote.
Cette affirmation selon laquelle l’intellect est divin en acte, c’est-à-dire quand il se touche lui-même, permet d’affirmer que c’est dans la contemplation que le plaisir et le bien sont les plus grands. La conséquence en est l’admiration que doit susciter pour nous le divin, de par sa perfection et le plaisir qui sont chez lui au plus haut point et perpétuellement. Dans l’admiration il y a la reconnaissance d’une absence de commune mesure, alors même qu’il y a du semblable, ici dans l’actualité de l’intellect. Il en découle pour Aristote que Dieu est vivant. Vivre c’est principalement sentir et penser pour Aristote, et c’est pour cette raison qu’il est possible d’affirmer que Dieu est vivant. C’est seulement dans la mesure où l’intellection est une action immanente qu’elle est acte du parfait et peut être appelée mouvement, alors même que le mouvement est l’acte de l’imparfait. C’est ainsi qu’il est possible d’affirmer que la vie du Dieu est acte, en ce que l’acte n’est pas à comprendre comme une action transitive mais bien immanente, elle se réalise dans l’agent lui-même et non à travers une matière extérieure. Et puisqu’être en acte abolit toute forme de durée, d’un point de vue de la chose considérée, être en acte signifie être sans début ni fin, et donc de durée continue, c’est-à-dire éternel.
Ainsi, Aristote a fondé l’éternité, la vitalité et la qualité de meilleur du divin par l’actualité. C’est le fait qu’il ne soit que sur le mode actuel qui implique que le divin soit divin et qu’il n’ait ni début ni fin, alors même que les choses telles que le ciel et la nature dépendent de lui, et donc qu’il agit sur quelque chose. Ceci établi, Aristote peut répondre à des thèses contraires qui ont motivées la nécessité du développement de cette argumentation. Ceux qui ont conçu l’origine du beau et du parfait comme se trouvant dans des éléments (Métaphysique, Alpha, 3) ont commis une erreur qui cette fois est considérée du point de vue du niveau d’antériorité auquel ils se sont limité. L’antériorité est toujours sous un mode particulier au sens où il peut y avoir antériorité selon le lieu, le temps, le mouvement, la puissance, l’ordre, la connaissance, la nature, etc… (Métaphysique, Delta, 11). Les causes considérées en tant que ce d’où proviennent les choses sont les causes matérielles ou formelles, alors que la semence ou l’agent, « toutes ces causes sont comme des principes de changement ou d’arrêt » et à ce titre, sont des causes dites efficientes (Métaphysique, Delta, 2).
Or, selon les philosophes qu’Aristote récuse, le beau et le parfait ne se rencontrent que dans les êtres qui dérivent de causes. Et ils en concluent que le beau et le parfait ne se trouvent pas dans un principe autre mais sont dans les causes elles-mêmes. Cette thèse ne peut pas être soutenable selon Aristote, en ce que les causes efficientes, tel que la semence qu’il prend pour illustration, ne contiennent pas la perfection plus que ce qui est antérieur à la semence, par exemple, l’être dont elle provient. Cela lui permet de conclure que la perfection ne se trouve pas dans des êtres antérieurs, mais dans ce qui est parfait. Or, il a été démontré plus haut que ce qui est le plus parfait, c’est le dieu vivant et éternel, principe du commencement du mouvement. Ce dernier argument, qui se fonde sur l’expérience de la génération permet de rendre saisissable que l’origine de la perfection doive nécessairement se trouver dans ce qui est parfait, alors que les causes efficientes ne peuvent être parfaites, en ce qu’elles-mêmes proviennent d’autres êtres, qui eux sont parfaits. S’arrêter à une antériorité telle que la semence, ce n’est pas se donner les moyens de saisir la nature du principe, dans ce qu’il a de parfait, d’éternel, et d’immuable. Et par conséquent, c’est situer la perfection dans ce qui est générateur d’un mouvement et non du premier mouvement. Et à ce premier mouvement revient la perfection ainsi que les autres attributs isolés dans le développement.