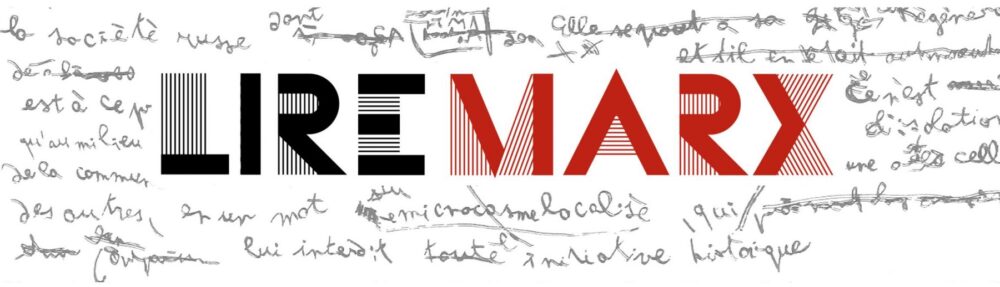L’ouvrage est la thèse de philosophie (remaniée) de Paul Guillibert (université Paris-Nanterre). Dans ce livre, l’auteur entend « actualiser le projet communiste » pour l’adapter à l’urgence climatique en intégrant les non-humains dans l’équation stratégique. Pour cela, il serait nécessaire de se libérer de certains présupposés qui sont associés à la notion de communisme telle qu’elle s’est développée à partir des écrits de Marx, à l’instar du productivisme. Il s’agit pour l’auteur de transformer l’ordre existant en prenant en compte les non-humains, en intégrant les conditions environnementales de l’histoire humaine. L’auteur défend un « communisme vivant » qu’il définit à partir de L’Idéologie allemande comme un mouvement « attentif aux formes immanentes du mouvement réel d’abolition de la valeur » 1. Pour Paul Guillibert, il faut « inscrire à l’agenda du communisme la défense des ‘communs multispécifiques’ » 2. Il entend ainsi tracer une troisième voie entre l’anti-naturalisme des sciences sociales et le naturalisme naïf du retour à la terre.
L’ouvrage s’articule en quatre chapitres. Le chapitre 1 identifie les grands thèmes qu’il faut retenir du « matérialisme historique ». Le chapitre 2 se concentre sur l’analyse de la nature chez Marx. Le chapitre 3 porte sur le rôle de la culture dans la transformation du rapport à la nature. Enfin, le chapitre 4 s’ouvre sur une étude des analyses par Engels et Marx des mouvements historiques et se poursuit avec l’analyse de la contribution de Carlos José Mariategui sur les stratégies à adopter face à des communautés fonctionnant sur la base de la propriété collective.
L’auteur annonce son projet de manière à ce que la curiosité inquiète s’éveille immédiatement : les termes choisis répondent à un ensemble de problématiques et de réseaux sémantiques propres à la recherche en sciences humaines universitaires. Selon Paul Guillibert, la « catastrophe écologique n’éloigne pas le spectre du communisme, elle appelle au contraire sa présence » 3. Pour ce faire, il est cependant nécessaire que le communisme (entendre, le « matérialisme historique ») se débarrasse de son productivisme pour « faire sienne la dimension utopique des communes rurales » 4. Il faut également intégrer les intérêts des milieux et des espèces qui se passent de mots pour agir, et pour les intégrer dans les considérations politiques, il faut « comprendre le type d’agentivité qui est propre au vivant » 5. Pour rendre le communisme écologiste et prouver que l’écologie ne peut être révolutionnaire qu’en étant communiste, l’auteur procède à une sélection dans « ce que nous devons hériter du communisme » 6. L’enjeu principal étant de penser un communisme sans naturalisme déshistoricisé, ce qui se trouverait justement dans le « matérialisme historique » de Marx.
Le projet de l’auteur semble répondre à une problématique stratégique en partant des questions suivantes : comment orienter le localisme territorialiste des ZAD et des communautés autonomes autogérées vers le communisme ? En quoi ces expériences et ces modes d’organisation, de vie, doivent-elles être prises en compte dans la stratégie des communistes au point de la transformer elle, puisqu’elle doit prendre en compte les particularités du sol social et culturel sur lesquels elle germe ?
L’auteur initie son développement en tentant d’identifier ce qui doit être conservé du « communisme de Marx » et découpe cet héritage de la manière suivante dans le premier chapitre : la matérialité de la catastrophe, l’abolition de la propriété privée, l’écologie de la lutte des classes, le refus du naturalisme, le multinaturalisme historique, que la nature est autonome et historique et multiple.
L’auteur identifie le communisme au matérialisme historique « non vulgaire » : il s’agit du matérialisme historique tel qu’il est formulé dans L’Introduction de 1857 à la Contribution, mais sans déterminisme ou productivisme 7, ou encore dans L’Idéologie allemande, où l’on trouve l’idée que « la structure d’une société dépend du mode de relation à la nature autorisé par les rapports de production » 8. Selon l’auteur, il faudrait en tirer un « enseignement fondamental » : qu’il est « impossible de naturaliser les rapports à la nature » 9. Voici ce dont on doit hériter du marxisme, le rapport de co-causalité entre nature et sociétés.
S’inscrivant dans cette continuité, l’auteur affirme que « l’une des thèses essentielles de la pensée de Marx » est la suivante : « les transformations que les sociétés imposent à la nature modifient les sociétés elles-mêmes » 10, autrement dit que « l’histoire sociale des la nature est inséparable de l’histoire écologique des sociétés » 11. Notre méfiance s’éveille toujours à ces formules nous annonçant livrer le cœur de la pensée d’un auteur, surtout de Marx. Le « matérialisme historique non vulgaire » est reconstruit à partir des Grundrisse, en particulier du chapitre « Formes antérieures à la production capitaliste », dans lequel on trouverait déjà des traces d’une « histoire matérialiste de l’environnement », une « étude des rapports de propriété dans des sociétés communautaires non capitalistes » 12.

Exemple d’agriculture inca.
D’après l’auteur, le concept de métabolisme permet, comme celui d’écologie aujourd’hui, d’« articuler une théorie des interactions constantes entre les vivants et leur environnement dans une totalité dynamique non statique de processus ouverts » 13. Rappelant la lecture faite par Judith Butler des Manuscrits de 1844, il opère la distinction entre corps organique et corps inorganique 14.
L’auteur rend compte de manière très précise de la question du mir, de la commune rurale russe, des enjeux politiques postérieurs autour du narodnisme (de la page 88 à 107), qui est marxologiquement très intéressante, d’autant plus que le travail de l’auteur sur ce point est synthétique et complet, passant au crible les lettres et les brouillons de lettres à Vera Zassoulitch.
Ceci permet à l’auteur de montrer que les réflexions de Marx ne sont pas dénuées de questionnement écologique, mais aussi que les usages qui en ont été faits ont relativisé le « moment politique » 15. La tendance qui se dessine actuellement est de remplacer le déterminisme économique par un déterminisme écologique, comme si les « pratiques politiques n’étaient que des effets déterminés ‘ en dernière instance ‘ par les rapports matériels à la nature » 16. Quel est alors le problème ? Ainsi conçus, ces rapports « laissent encore trop peu de place aux discours, aux représentations et aux imaginaires dans la transformation du nouveau régime environnemental » 17. Bien entendu, le déterminisme en général laisse peu de place aux discours, à l’imagination etc., mais il laisse aussi bien peu de place à l’action, si nous nous rappelons les débats de la jeune sociale-démocratie allemande.
La culture comme lieu d’affrontement stratégique
Un chapitre entier du livre est consacré au « naturalisme culturel » de Raymond Williams, c’est-à-dire à une réflexion sur la manière dont la « culture », les représentations partagées dans une société, produit des rapports spécifiques à la nature ; inversant le rapport de causalité « intuitif » qui ferait des représentations de la nature un résultat de nos rapports à elle. Pour lier écologisme et communisme, les symboles jouent alors un rôle prépondérant :
« Une révolution écologiste suppose aussi une lutte idéologique et le naturalisme historique doit pouvoir penser les effets stratégiques d’une grande diversité de socialisations symboliques de l’environnement. D’où la nécessité d’élaborer une théorie matérialiste des cultures de la nature » 18.
Une grande partie du projet politique de l’auteur consiste à faire de la culture « un lieu d’affrontement stratégique » 19, si bien qu’il porte souvent sur l’imaginaire et les inventions, c’est sa dimension utopique assumée et réfléchie : pour « replacer le vivant au cœur d’une politique communiste » il faut « refonder sa cosmologie sur un naturalisme renouvelé » 20, il faut inventer une nouvelle propriété collective du vivant et donc « imaginer » de nouvelles relations à la nature 21. Actualiser ce projet, cela veut dire aussi se passer d’un certain vocabulaire, comme de « mode de production » pour lui préférer « mode de vie » (suivant Hartley) 22.
A partir des écrits de Raymond Williams, l’auteur étudie en quoi les représentations de la nature, de la ville et de la campagne peuvent modifier le rapport au réel et faire évoluer les formes culturelles. Cette insistance sur l’imaginaire à créer et sur la sphère de la représentation occupe une place non négligeable dans l’ouvrage. Si l’on ne peut que reconnaître qu’il est nécessaire d’avoir d’autres images de la nature et de « l’environnement » pour changer notre société, que cette composante est à prendre en compte dans la stratégie politique révolutionnaire, alors un champ de questions concrètes s’ouvre. C’est bien l’intérêt de ce livre que d’ouvrir ce champ de questions, peut-être une de ses limites que de ne pas les poser : les questions de stratégie hégémonique posent nécessairement celles liées aux formes d’intervention dans la production culturelle, qui est un secteur ayant des enjeux bien concrets et spécifiques et dont les acteurs sont identifiables.
L’auteur va progressivement ainsi se déplacer sur les terrains mouvants de thématiques dont les luttes anticapitalistes se saisissent parfois sans identifier les éléments fascistes qui potentiellement les traversent. Ainsi l’auteur se demande quelles significations il faut accorder à la « réinvention de la culture matérielle » à laquelle on assiste aujourd’hui ? N’est-elle qu’une résurgence d’un motif réactionnaire de l’enracinement de la communauté ou peut-on percevoir l’idéal d’une communauté harmonieuse contre la dépossession du monde 23 ? Ceci amène nécessairement à une réflexion sur le rapport à la tradition et aux communautés dans lesquelles il n’existe pas de propriété privée, ce qui constitue l’objet du quatrième chapitre.
S’inscrivant dans la continuité avec José Carlos Mariategui, l’auteur entend « renouer avec une sensibilité au narodnisme écologique », ce qu’il précise en citant le commentaire qu’en fait Michael Löwy : c’est l’idée que le socialisme moderne « devra s’enraciner dans les traditions vernaculaires, dans la mémoire collective paysanne et populaire, dans les survivances sociales et culturelles de la vie communautaire pré-capitaliste, dans les pratiques d’entraide, solidarité et propriété collective de la Gemeinschaft rurale » 24.
Autrement dit, il faut ancrer le projet communiste dans les singularités sociales spécifiques à son lieu d’apparition. Ce vœu pieux est en fait le début du problème : quelle limite fixer à ces singularités sociales, y inclut-on le nationalisme, la baguette de pain, le patriarcat, nos bonnes vieilles traditions ? Ces éléments, puisqu’ils constituent parfois la culture commune des acteurs des luttes, sont présents, ceci est évident. Affirmer que le projet communiste doit s’ancrer dans ces singularités ne nous dit pas grand chose, puisqu’il l’est de fait, et que le problème consiste à identifier celles avec lesquelles il est incompatible ; ce qui, dans l’ensemble de ces singularités, est le terreau de la reproduction de rapports sociaux capitalistes ou ce qui n’est pas contradictoire avec la logique capitaliste.
Soulignons tout de même que l’auteur ne circonscrit pas du tout le lieu d’affrontement à la culture et aux représentations. En établissant une discussion avec les contributions contemporaines du marxisme écologique, il évalue les apports et les limites de ces réflexions stratégiques. Ainsi, Paul Guillibert estime que « la portée de la régulation étatique restera limitée tant qu’elle ne posera pas le problème du rôle de l’État dans la reproduction écologique des rapports de classe » 25. Or « les causes de la catastrophe environnementale sont inscrites dans la structure de classe du capitalisme » 26. En réponse à Andreas Malm, l’auteur accorde qu’une prise de pouvoir permet de défendre l’intérêt écologique, seulement à condition qu’elle soit « orientée vers le dépérissement de l’État » 27. Si nous ne pouvons que nous accorder sur ce point, il n’en reste pas moins que la ligne stratégique de dépérissement de l’Etat telle que l’avait envisagée Engels dans l’Anti-Dühring est très vague.
En tant que l’ensemble du livre pose une question de stratégie, il se termine sur une réflexion sur l’actualité du « double-pouvoir » qui a existé entre février et octobre 1917 en Russie. Il manquait seulement à cette réflexion de stratégie politique un certain ancrage historique que l’auteur apporte enfin, sans faire l’erreur de raccourcis grossiers, et en proposant une analyse fine de ce que peut nous dire aujourd’hui la Révolution russe 28. Si l’auteur semble donc s’orienter vers un marxisme « culturaliste », il ne s’y circonscrit pas, et tente en fait d’articuler en les mettant en dialogues des traditions marxistes qui bien souvent, au mieux, s’ignorent cordialement.

Wohn- und Schlafraum in der Manteuffelstraße 64 in Berlin, aufgenommen am 27.6.1910: Raummaße: 4,00m lang, 2,75m breit, 2,60m hoch. (© picture-alliance, ZB)
Propriété et échange
Plutôt que de céder aux sirènes de cosmologies primitives se trouvant dans un rapport soi-disant plus authentique à la nature, l’auteur défend qu’« il n’est pas nécessaire de se détourner du naturalisme en tant que tel pour élaborer une cosmologie plus respectueuse des mondes non humains » 29. Paul Guillibert propose, comme il le dit, un retour à la terre dans une philosophie politique tournée vers l’avenir du communisme. Avec son sens de la formule, l’auteur dépose une prose vivifiante et stimulante d’autant qu’elle est porteuse d’orientations politiques claires et fondées théoriquement. Il convient cependant de nous attarder quelque peu sur un des thèmes centraux du livre, la notion de communisme.
Paul Guillibert part de la réflexion suivante sur le concept de communisme : « il faut donner un contenu positif et utopique à la révolution pour que sa dimension critique et destructrice soit effective » 30. Si nous allons donc à la recherche de définitions de communisme, on trouve comme élément central la notion de propriété privée. Cette mise en avant de la propriété privée se justifierait de la manière suivante :
« La communauté de la terre est le fondement de rapports sociaux moins aliénés entre humains » 31.
On se demande bien de quelle aliénation il s’agit, si c’est celle des Manuscrits de 1844, elle est certes indissociable de la séparation des moyens de subsistance, mais c’est tout de même l’activité, le travail, qui manifeste le caractère aliéné de l’homme, travaillant pour sa subsistance, comme un étranger à lui-même.
La revendication de la propriété de la terre est le propre aussi de revendications nationalistes et chauvines. En partant des réflexions d’Ernst Bloch dans Héritage de ce temps, l’auteur explicite en quoi, même si la mystique de la terre a été assimilée par le fascisme pour faire triompher le capital, « la non-contemporanéité des revendications liées à la terre et à l’enracinement n’est pas ‘dépassée’, mais exprime au contraire ‘la richesse incomplète du passé’ » 32.
Nous trouvons une définition du communisme à la page 171 qui nous conforte dans l’idée que l’auteur en a une vision assez réduite, qui est proche de celle du Manifeste communiste, un moment où Marx n’a pas encore élaboré sa critique de l’économie politique de manière très aboutie : « Le communisme est le mouvement d’abolition de la propriété privée des moyens de production par une classe révolutionnaire qui lutte contre son exploitation ». En effet, le potentiel émancipateur et révolutionnaire du communisme est identifié par l’auteur à sa capacité à faire de la propriété privée un facteur décisif du rapport social et du rapport des sociétés à la nature. Il en résulte nécessairement que la revendication à porter est celle de la propriété collective de la terre, qui est en fait une pratique sociale pré-capitaliste, mais qui peut connaître des formes spécifiques aussi dans le capitalisme (autogestion, auto-exploitation, capitalisme d’Etat, coopératives de production agricoles, etc.). En étudiant les effets spécifiques des productions culturelles, l’auteur entend proposer une stratégie pour construire un imaginaire susceptible de porter aussi cette revendication. La puissance de son ouvrage résulte de la constante interrogation sur les limites de cette revendication, limite fasciste notamment par le mythe d’une terre et de rapports sociaux archaïques idéalisés pour construire le communisme.
Cependant la limitation du projet communiste à la question de la propriété porte le sceau d’un marxisme idéologique réducteur. Si l’extension de la problématique à la propriété de la terre intègre alors une dimension bien spécifique qui dépasse les « moyens de production », une analyse précise d’un point de vue du capital du rôle et de la fonction de la nature révélerait qu’il n’est pas seulement question de propriété de ce facteur de production pour considérer la question communiste.
Suivant cette même lecture, un présupposé qui gagnerait à être interrogé par l’auteur est le suivant : en effet, il affirme que les mouvements pacifistes, l’écologie ou les féminismes « ne sont pas réductibles aux mécanismes de la production, parce qu’ils s’y refusent le plus souvent », ils sont exclus de « la logique marchande de la valeur », et incarnent une nouvelle « structure du sentiment » 33. Or se refuser à une logique marchande de la valeur ne garantit aucunement d’en être effectivement exclu, notamment en ce que cette logique prend des formes extrêmement diverses, autant émotionnelles, affectives, que culturelles et structurelles qui dérivent de et reproduisent les formes spécifiques à la marchandise et à l’échange. En ne posant la question communiste que depuis le prisme de la propriété, disparaît nécessairement l’ensemble de la problématique relative au marché et à son rapport complexe et ambiguë à la propriété privée.
Conclusion
Si l’on peut parfois regretter un phrasée universitaire qui dessert un propos politique fort, cohérent et très bien résumé dans la Conclusion, ce livre est incontournable pour qui entend s’orienter dans l’action face aux insuffisantes propositions des collapsologues, des réformistes et des léninistes afin de résoudre la question écologique. La clarification politique sur des enjeux centraux autour de la terre, de la communauté, de l’utopie et de la nature fournit une base solide à un projet communiste écologiste et révolutionnaire qui se refuse à tout léninisme ou programmatisme, sans pour autant tomber dans le primitivisme tant en vogue. Les références au cours de l’ouvrage à des auteurs bien peu « marxistes » (comme Bruno Latour ou Philippe Descola), ou bien l’utilisation fréquente de termes sans définition claire ni évocation des débats importants qui les entourent (comme celui d’« anthropocène ») font cependant s’immiscer une méfiance persistante.
Si l’auteur se déplace sur des terrains glissants de revendications qui portent le sceau du conservatisme, il identifie constamment ces dangers et la possibilité/nécessité qu’il y a à s’emparer de revendications de la sorte. La riche discussion que l’auteur mène à partir des marxismes écologiques contemporains (Malm, Saïto, Tanuro, Zetkine Collective, etc.) est incontournable pour qui souhaite avoir un aperçu aussi large que précis des termes et des enjeux de celle-ci et s’orienter dans ces diverses propositions politiques.
Mais ne nous y trompons pas, il s’agit bien d’une discussion sur le marxisme bien plus que sur ou à partir de l’œuvre de Marx. Par conséquent, le seul point noir plutôt problématique est l’usage quelque peu superficiel des textes de Marx, notamment par la reconstruction unificatrice de sa pensée en un « matérialisme historique » pour en faire un « naturalisme historique », ou le cherry picking dans son œuvre. Pour autant, aucun texte du corpus marxien invoqué au cours de l’argumentation n’est amené pour être brandi comme un argument d’autorité ; c’est bien à chaque fois la pertinence du texte cité et la perspicacité de son auteur qui est la justification ultime de sa présence.
Enfin, la définition extrêmement réductrice du communisme comme mouvement d’abolition de la propriété privée ne permet pas d’avoir une réflexion aboutie sur l’ensemble des enjeux liés spécifiquement à la logique marchande capitaliste à l’œuvre dans l’extension mondiale du capitalisme, notamment sur la fonction du marché. Le mode de socialisation et de production capitalistes ne peuvent pas être dépassés et abolis par le seul passage de la propriété privée à la propriété commune de la terre, et ce même si la propriété privée intervient à toutes les strates des rapports (à soi, aux autres humains, aux non-humains).
I.J.
1p. 228, sauf mention expresse, toutes les références sont celles de l’ouvrage recensé.
2p. 228.
3p. 26.
4Ibid.
5p. 27.
6Ibid.
7p. 23.
8p. 33, reformulé par l’auteur.
9p.52.
10p. 33.
11p. 34.
12p. 65.
13p. 72.
14Voir Judith Bulter, Deux lectures du jeune Marx, Editions sociales, 2019.
15p. 122.
16Ibid.
17p. 122.
18p.122 sq.
19p. 160.
20p. 229.
21p. 127.
22p. 160.
23p. 160.
24p. 183, cité de Michael Löwy, « L’indigénisme marxiste de José Carlos Mariategui, Actuel Marx, n°56, 2014, p. 13-22.
25p. 237.
26Ibid.
27p. 239-240.
28p. 240-241.
29p. 224.
30p. 206.
31p. 184.
32p. 204.
33p. 160.