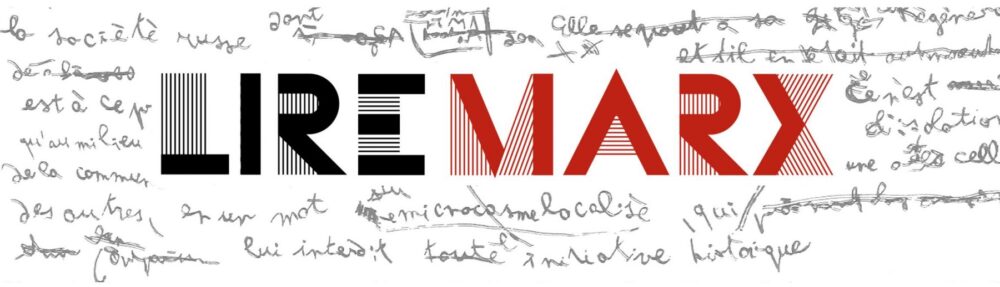Contrairement aux autres écrits de Marx, qu’ils soient des articles ou des livres, on ne trouvera pas explicitement ici une pensée développée finie. Ce questionnaire propose simplement des outils permettant de donner à sa vie une forme qui répond à des nécessités qui doivent encore être identifiées. Il est l’écrit de Marx le plus décentré qui soit, le plus en quête de la source d’organisation collective : il fournit une méthode pour prendre le temps de s’interroger sur sa vie et ses conditions de vie, qui sont pour l’essentiel des conditions de travail.
Contrairement aux autres écrits de Marx, qu’ils soient des articles ou des livres, on ne trouvera pas explicitement ici une pensée développée finie. Ce questionnaire propose simplement des outils permettant de donner à sa vie une forme qui répond à des nécessités qui doivent encore être identifiées. Il est l’écrit de Marx le plus décentré qui soit, le plus en quête de la source d’organisation collective : il fournit une méthode pour prendre le temps de s’interroger sur sa vie et ses conditions de vie, qui sont pour l’essentiel des conditions de travail.
Initialement publié dans la Revue socialiste, cet ensemble de 101 points essentiellement constitué de questions fut repris par La Vie ouvrière. L’enquête fut ensuite publiée par Maximilien Rubel dans le tome I des Oeuvres complètes à la Pléiade. Dans son Essai de biographie intellectuelle (1957, Klincksiek, 2016), Rubel dresse un parallèle particulièrement intéressant entre la structure du Capital et celle de cette enquête qu’il rédige et publie anonymement en 1880 (vous trouverez ce texte ici).
Alors qu’Engels rédige son enquête sur la situation de la classe laborieuse en Angleterre (1844) essentiellement à partir de données récoltées « par le haut », et que Marx lui-même encore dans le Capital utilisera ces mêmes sources, ce texte marque une rupture car il met en acte une réflexion portant sur la nature des données utilisées pour analyser le capitalisme.
Si dans le Capital, Marx se réjouit de l’intérêt témoigné par la bourgeoisie pour les conditions de travail des ouvriers au travers des structures étatiques dont elle s’est dotée, il est évident que cet intérêt est intimement lié à la nécessité qu’il y a pour l’État de veiller sur la santé de sa population, notamment de ses armées. C’est le moment où l’État agit alors comme un « capitaliste en idée », comme dira Engels, se trouvant alors en contradiction ouverte avec les capitalistes individuels et leur nécessité de déteriorer les conditions de travail des ouvriers. L’État mène alors des « enquêtes parlementaires » en vue d’opérer des réformes de la législation du travail contraignant les capitalistes. C’est en effet alors à ce moment, comme le rappelle Laurent Vogel en Postface, que convergent l’hygiénisme et la statistique.
Divisé en quatre sections, l’ensemble de questions, parfois formulées de manière injonctive (« donnez ») nécessite parfois que l’ouvrier fasse ses comptes, aille poser des questions à d’autres personnes travaillant sur place, ou qu’il envoie les statuts et règlements d’organisations. Il doit parfois décrire le contrat de travail de quelqu’un d’autre. Il est donc manifeste que certaines de ces demandes sont inappropriées à la situation dans laquelle se trouve un ouvrier, qu’elles peuvent parfois le mener vers d’autres, et à cet endroit, avoir un réel intérêt.
Dans cette édition chez LitPol, l’ouvrage est agrémenté de la note qui a accompagné sa parution en 1880 et d’une postface de Laurent Vogel. Ce professeur publie notamment dans Hesamag, le magazine de l’Institut syndical européen, où il est chercheur dans l’unité « Conditions de travail, santé et sécurité » ; il enseigne à l’Université libre de Bruxelles et à l’Université Paris 13 (droit du travail, droit de la santé au travail).
Dans sa Postface, Laurent Vogel réinscrit tout d’abord la démarche de l’enquête ouvrière dans le cadre des enjeux historiques des années 1880 liés à l’utilité pour les organisations de travailleurs et de travailleuses de disposer de cet instrument à trois lames : il permet 1) à la classe ouvrière d’apercevoir le caractère international de sa communauté de situation 2) de rendre aux ouvriers isolés une connaissance de l’ensemble du procès de production, connaissance dont ils sont privés car elle appartient aux managers de la production 3) de recruter des ouvriers pour leurs organisations.
Laurent Vogel retrace la manière dont la démarche de l’enquête ouvrière a pu être ensuite utilisée, notamment à partir des années 1960, avec les Quaderni Rossi en Italie, puis précise en quoi en France, elle a pu être un réel instrument pour modifier les organisations, notamment celles en rupture avec le stalinisme. Si l’ensemble des questions que Marx pose suivent un ordre bien spécifique qui lui permet de faire s’élaborer une pensée de sa propre condition et surtout de l’ignorance que l’on en a, c’est surtout un aspect bien spécifique de la méthode qu’il emploie qui ressort de sa démarche : elle « implique un lien étroit entre la production de connaissances et l’action collective » particulièrement adaptée « aux multiples figures nouvelles de la condition salariale » (p. 49 sq.).
La nécessité de publier cette enquête à part entière, sans pour autant l’extraire de l’ensemble de la logique d’évolution du mouvement ouvrier, est évidente. Il aurait été nécessaire, d’un point de vue marxologique, de rendre raison de ce mouvement qui s’opère vers une connaissance issue des exploités eux-mêmes, que cela soit pour des raisons épistémologiques ou bien stratégiques. Pour ces dernières, le lien entre Marx et la Première Internationale aurait nécessité d’être approfondi, au risque d’entrer dans de complexes discussions bien éloignées de l’objet de départ, et plus centrées sur un auteur, qui, pour la première publication n’avait pas signé. Et d’ailleurs, pourquoi ? Cette question mérite aussi qu’on s’y attarde. Ce choix de l’anonymat témoigne de la simple volonté de Marx de participer, en tant qu’acteur, activement à la construction d’un mouvement ouvrier révolutionnaire, mais aussi de son choix de s’assurer une source de connaissance nouvelle pour analyser le capitalisme. Mais il témoigne aussi du peu de reconnaissance qu’avait Marx à cette époque dans le mouvement ouvrier, voire même d’une forme de rejet. Analyser ce choix de l’anonymat est nécessaire aussi bien pour comprendre Marx, que pour saisir ce qui créé ce rejet, et donc empêche de le lire.
Enfin, s’il est un intérêt d’extraire des textes des Œuvres complètes de la Pléiade, cela est de les rendre accessibles, ce qui est en contradiction avec le prix de l’ouvrage (10 euros pour 62 pages). Ceci est regrettable, mais reste compréhensible. Tout comme le fait qu’il n’existe plus aucune revue de classe disposant d’une audience assez large pour lancer une telle enquête, même si cela est déplorable.
Il est certain que la pratique de l’enquête ouvrière nous donne un étalon pour mesurer la propension d’une organisation à être un lieu d’expression, d’autoréflexion et conjointement, de lutte d’une classe. Cet ouvrage donne des éléments essentiels pour élaborer nos propres questionnaires, adaptés aux lieux de travail qui nous concernent. Néanmoins, il ne faut pas omettre que les conditions de travail actuelles impliquent que se donner le temps de mener ce genre d’enquête est bien trop souvent un luxe. Ceci induit l’application d’un prisme : s’opère une sélection dans celles et ceux qui s’expriment, quand, sur quoi, comment, etc. Enfin, rappelons qu’une enquête ouvrière ne permet pas aux ouvriers de « prendre conscience » de leur condition, mais bien qu’ils et elles se créent des organes « à leur image ».
I.J.