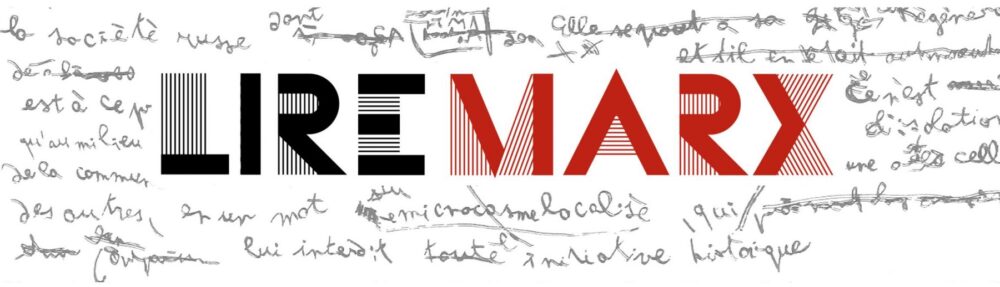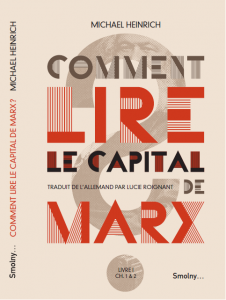 Dans le présent ouvrage, Michael Heinrich développe une approche inédite et éminemment didactique du chef d’œuvre de Marx en offrant aux lecteurs, paragraphe après paragraphe, un commentaire très serré des deux premiers chapitres du Capital, dont la densité de raisonnement et l’importance des fondements conceptuels qu’ils introduisent (travail abstrait, forme-valeur, forme-monnaie, caractère fétiche de la marchandise, etc.) en rendent la lecture souvent ardue. L’auteur répond ainsi à une attente profonde de Marx, qui faisait du mode d’exposition une dimension essentielle de sa méthode. Sans partir d’évidences souvent établies a posteriori, ou de présupposés politiques, ce livre est à ce jour le seul véritable manuel d’exploration scientifique du Capital, dont la lecture doit être concomitante.
Dans le présent ouvrage, Michael Heinrich développe une approche inédite et éminemment didactique du chef d’œuvre de Marx en offrant aux lecteurs, paragraphe après paragraphe, un commentaire très serré des deux premiers chapitres du Capital, dont la densité de raisonnement et l’importance des fondements conceptuels qu’ils introduisent (travail abstrait, forme-valeur, forme-monnaie, caractère fétiche de la marchandise, etc.) en rendent la lecture souvent ardue. L’auteur répond ainsi à une attente profonde de Marx, qui faisait du mode d’exposition une dimension essentielle de sa méthode. Sans partir d’évidences souvent établies a posteriori, ou de présupposés politiques, ce livre est à ce jour le seul véritable manuel d’exploration scientifique du Capital, dont la lecture doit être concomitante.
Le texte de référence est celui de la quatrième édition allemande du Capital, disponible dans la traduction coordonnée par Jean-Pierre Lefebvre — PUF, collection Quadrige (1993-2009) — ou celle revue par ses soins aux Éditions Sociales (2015).
Avant-propos
À la fin des années soixante et dans les années soixante-dix, dans de nombreux pays d’Europe de l’Ouest, on a pu constater à la suite des mouvements étudiants de mai 68 un regain d’intérêt pour Marx. Par la même occasion, les voies de l’interprétation de Marx, tant et tant parcourues par une multitude de partis socialistes et communistes, se voient contestées. On voit apparaître de nombreuses contributions traitant non seulement du Capital mais aussi de manuscrits importants tels que les Grundrisse ou les Théories sur la plus-value ; on peut à raison parler d’un « renouveau de la lecture de Marx » 1 dépassant l’orientation économique unilatérale des types de lecture prédominant jusqu’alors. Au même moment, l’étude de Marx devient un quasi-phénomène de masse. Chez les étudiants, étudiantes et jeunes universitaires, notamment en sciences sociales et sciences de l’éducation, Marx devient un passage presque obligé, du moins pour celles et ceux qui veulent passer pour éclairés et progressistes. Cette évolution influence également de nombreux lycéens, apprentis et jeunes travailleurs, ainsi que bon nombre de syndicalistes. Les cours sur le Capital se multiplient dans de nombreuses universités d’Allemagne de l’Ouest et de Berlin-Ouest, qu’il s’agisse de cours officiels ou de groupes de lecture autogérés, auxquels les étudiants ne sont souvent pas les seuls à participer. Des questions telles que l’« opposition entre la valeur d’usage et la valeur » ou la « suraccumulation du capital » deviennent incontournables dans de nombreux débats. Mais ces études de la pensée de Marx demeurent souvent plutôt superficielles, la plupart des participants à ces séminaires sur le Capital arrêtant souvent leur lecture au cours du livre I. Sans l’être exclusivement, l’étude de Marx est aussi un phénomène de mode.
En République démocratique allemande, si les références à Marx sont de l’ordre de l’évidence officielle, le « marxisme-léninisme » omniprésent enseigné dans les écoles et les universités est plus ou moins fait de citations marquantes et de résumés didactiques des « classiques », qui servent avant tout d’idéologie visant à légitimer le « socialisme réel existant » 2. Seuls de petits cercles d’experts ne se contentent pas des manuels d’« Économie politique du capitalisme et du socialisme » et mènent des discussions réellement approfondies du Capital de Marx. Dans les années soixante-dix, le lancement de la MEGA (la grande édition allemande des œuvres complètes de Marx et d’Engels, qui publie tous les textes et les manuscrits existants) approfondit et enrichit les discussions en RDA, mais celles-ci n’ont pour ainsi dire aucun retentissement sur le reste de la société.
Le fait que l’étude de Marx devienne à l’ouest un tel phénomène de mode s’explique également par le fait qu’on espérait vivre des changements politiques et sociaux à court terme. Dans les années soixante, le mouvement étudiant s’était développé en quelques années à peine et avait fait quelques vagues dans la République fédérale allemande en état de léthargie. Dans d’autres pays, on avait pu observer la même évolution. Et il existait dans le « tiers-monde » des mouvements armés aux revendications sociales et révolutionnaires qui, comme les Vietcong par exemple, se mesuraient aux États-Unis, la puissance capitaliste dominante. Il suffisait donc que le marxisme prenne de l’ampleur dans les classes laborieuses des métropoles, supposition qui semblait alors évidente, pour pouvoir envisager une perspective révolutionnaire. Les fondateurs des K-Gruppen (cercles et petits partis communistes 3), pour la plupart des étudiants qui ne tardèrent pas à se diviser sur la question de la voie « juste », n’étaient pas les seuls à y croire dans l’Allemagne du début des années soixante-dix ; nombreux étaient ceux qui y adhéraient.
À la fin des années soixante-dix, il devient clair que l’on ne va pas retirer grand chose de l’optimisme et de l’espoir qui régnaient au début de la décennie. Si les Vietcong, les Khmers rouges et les troupes du Nord-Vietnam ont chassé du Sud-Vietnam et du Cambodge l’armée américaine et les gouvernements soutenus par les États-Unis, il s’avère rapidement que les dictatures du « socialisme réel » du Tiers-Monde, qui viennent d’arriver au pouvoir, ne proposent pas de perspectives d’émancipation ; au Cambodge, cela conduit même au génocide par les Khmers rouges de leur propre population. Les espoirs d’une prise de conscience révolutionnaire de la classe ouvrière sont également déçus dans les métropoles. Que ce soit par le biais traditionnaliste de la construction d’un parti de cadres « marxiste-léniniste » ou par des tentatives d’organisation fédératrices volontairement non centralisées telles que le « Sozialistisches Büro » 4, l’étincelle révolutionnaire refuse de prendre, que ce soit parmi les masses allemandes ou dans d’autres pays où la lutte des classes était déjà beaucoup plus avancée. Les manifestations et les bombes de peinture ne touchent plus les politiciens et les médias comme elles le faisaient à la fin des années soixante, elles ne les inquiètent même plus. Sans plus de façons, de nombreuses personnes de gauche qualifient alors de « crise du marxisme » cette déception de leurs attentes politiques, un diagnostic venant de France et d’Italie qui a pris racine dans des circonstances politiques autres et que l’on admet souvent sans la moindre objection. Au lieu de prendre du recul pour examiner l’origine de ces attentes, qui avaient été exagérées dès le départ et sont désormais déçues, et donc de critiquer les mécanismes par lesquels ils ont assimilé et utilisé la théorie de Marx, les anciens militants sont nombreux à considérer, sans élaborer la moindre critique, que leurs attentes sont le résultat de cette même théorie et concluent son échec de leur propre déception.
Nombreux parmi ceux qui, quelques années plus tôt, ne semblaient jamais rassasiés des grandes théories (et qui les utilisaient souvent comme moyens de domination rhétoriques), annoncent à la fin des années soixante-dix et tout au long des années quatre-vingt la fin des grandes théories en général et de celle de Marx en particulier. Là où le marxisme a été très en vogue quelques années plus tôt, on ne voit désormais plus que postures désabusées prônant son rejet. Il n’est alors pas rare de croiser l’archétype du vieux gauchiste, à l’air tranquille et entendu, connaissant soi-disant son Marx sur le bout des doigts et sachant désormais que la classe ouvrière, le capitalisme et la politique ne fonctionnent absolument pas de la manière dont Marx l’a toujours affirmé. À plus forte raison, après l’effondrement du « socialisme réel » en 1989-1990, la théorie de Marx semble anéantie pour de bon. Ce discrédit jeté sur une alternative sociale au capitalisme fait également fi des tentatives, déjà anciennes, de critiquer le socialisme d’État autoritaire de type soviétique avec l’appui de la théorie de Marx.
La fin de la guerre froide n’aboutit cependant ni à un système étatique plus pacifique ni à un capitalisme plus stable (ou encore plus social). Les guerres et les crises sont plus nombreuses que dans les décennies précédentes et jusqu’à aujourd’hui, le niveau de protection sociale des salariés acquis pendant les Trente Glorieuses est la cible d’attaques quasi incessantes. Depuis la deuxième moitié des années quatre-vingt-dix cependant, des signes de résistance à ces évolutions se sont répétés à différents niveaux. Certes, le contenu d’une grande partie de ces protestations est demeuré plutôt limité, se contentant souvent de se défendre contre la menace de dégradations imminentes ou d’exiger de l’État, supposé protéger ses citoyens face à l’impudence du capital, une politique « meilleure ». Mais malgré sa lenteur et ses limites, on constate un changement dans le climat social, et il semble bel et bien que le néo-libéralisme, hégémonique depuis le début des années quatre-vingt, ainsi que son culte du marché et de la concurrence connaissent leurs premières failles.
Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, on peut remarquer en Allemagne (mais aussi dans d’autres pays) une recrudescence de l’intérêt pour la théorie de Marx. Si la discussion est encore loin d’avoir atteint l’ampleur qu’elle avait à l’Ouest dans les années soixante-dix, il semble qu’une nouvelle génération de personnes actives politiquement et issues de milieux divers, qu’elles soient originaires de l’Est ou de l’Ouest, soient en passe de s’approprier la critique marxienne de l’économie politique. Cette appropriation s’accompagne d’attentes politiques bien moindres que dans les années soixante-dix, et on est loin de la supériorité et de l’arrogance que l’on pouvait trouver parfois à l’époque. C’est une démarche qui fait preuve d’un positionnement curieux et ouvert et qui n’attend pas de la théorie de Marx qu’elle réponde de manière immédiate et définitive à toutes les grandes questions. Ce ne sont donc pas de mauvaises conditions pour se mettre sérieusement à l’étude.
On se heurte cependant à l’absence d’une infrastructure qui, sans plus de complications, rendrait possible une étude plus appuyée de la théorie de Marx. Qui souhaite étudier le Capital aujourd’hui ne peut pas s’attendre à trouver ce genre de cours à l’université ou dans le milieu académique, et dans d’autres lieux, comme dans les centres de formation syndicale par exemple, la situation n’est en règle générale guère plus avantageuse. Il n’existe pour ainsi dire plus de débat sur Marx dans les institutions académiques officielles — ce qui donne néanmoins l’opportunité de mener ce type de discussion indépendamment des contraintes institutionnelles. Le présent livre a pour but d’offrir aux personnes intéressées une aide dans cette démarche. Il a été pensé pour des individus ou des groupes qui n’ont pas de connaissances préalables particulières et qui, de manière autonome, veulent s’atteler à une lecture appuyée et rigoureuse du Capital.
Ce sont surtout les deux premiers chapitres du Capital qui posent aux lecteurs et aux lectrices le plus grand nombre de difficultés, car il s’agit des parties les plus complexes de l’ensemble du livre. Ces chapitres liminaires revêtent également une importance centrale pour la suite de l’argumentation, à tel point que sa compréhension en dépend. C’est la raison pour laquelle ces deux chapitres seront commentés en détail dans le présent ouvrage. Tout en facilitant la lecture, cela explicitera le contenu de ces chapitres ainsi que des éléments qui auraient pu échapper lors d’une première lecture. Celles et ceux qui ont déjà lu le début du Capital apprendront donc peut-être aussi quelque chose de nouveau.
Les premiers chapitres traitent du rapport entre valeur, travail et argent. Marx s’est attaqué plusieurs fois à cette problématique fondamentale de la critique de l’économie politique. On la trouve au début des Grundrisse (1857–58), elle forme le contenu de la Critique de l’économie politique (1859), on la trouve dans la première édition du Capital (1867) et elle a été considérablement modifiée pour la deuxième édition (1872–1873). Ces différentes versions ne sont pas de simples répétitions, on constate dans leurs différences tantôt une avancée dans la réflexion, tantôt des simplifications qui ne vont pas sans poser de problèmes, tantôt des variations dans l’importance accordée aux différents aspects. En ce sens, il m’a semblé pertinent de ne pas m’arrêter au commentaire des dernières variantes en date présentes dans les éditions courantes du Capital, mais de m’appuyer également sur les autres versions. Ce sera le cas autant au fil du commentaire que dans les annexes. Ainsi, une étude assidue de la théorie de la valeur de Marx devrait être rendue possible tant pour celles et ceux qui sont des lecteurs débutants du Capital que pour d’autres déjà plus « avancés ».
Il sera alors plus aisé de distinguer le présent ouvrage de mon Introduction à la critique de l’économie politique (Heinrich, 2004), qui visait à donner un premier aperçu des trois livres du Capital. Si dans l’Introduction, j’insiste à plusieurs reprises sur le fait qu’elle ne peut remplacer une lecture propre du Capital, elle ne propose qu’une aide limitée à une lecture autonome du texte de Marx. La théorie de la valeur y joue un rôle important (le chapitre qui y est consacré est le plus détaillé de tout le livre) mais seuls des points relevant du contexte global ont pu y être traités. Le présent ouvrage en revanche offre une étude détaillée du texte du Capital.
Je suis bien conscient du fait que la langue allemande ignore les femmes, en ceci que le masculin l’emporte sur le féminin. J’ai cependant renoncé à féminiser les formes. Ce livre est un commentaire et une interprétation du texte de Marx, lequel ignorait ce biais linguistique. Si l’on ne change pas les citations et les renvois aux citations, un va-et-vient continuel entre une écriture masculine et un mode neutre aurait été nécessaire, ce qui n’aurait fait que compliquer la lecture. Au lieu d’utiliser la féminisation des termes, je parlerai souvent de « lecteurs et de lectrices », de « travailleurs et de travailleuses », etc.
Lors de la préparation de ce livre, j’ai été secondé par des personnes qui ont effectué des lectures critiques des versions antérieures du manuscrit. Pour leurs lectures et même parfois leurs relectures, pour nos discussions enrichissantes et leurs remarques obligeantes, je remercie tout particulièrement Ingo Elbe, Andreas Hirt, Kolja Lindner, Urs Lindner, Hermann Lührs, Arno Netzbandt, Sabine Nuss, Paul Sandner, Oliver Schlaudt, Anne Steckner, Ingo Stützle et Wolfgang Veiglhuber.
Avant-propos à la seconde édition
Qu’un second tirage soit déjà nécessaire un an après la publication de ce commentaire est un indice objectif de l’intérêt grandissant pour le Capital de Marx — et, espérons-le, également de l’utilité des explications de ce livre. Un certain nombre de fautes d’orthographe ont été corrigées dans cette édition et certaines formulations ont été explicitées, sans pour autant modifier la teneur de l’ouvrage.
Au titre du livre a été ajoutée la mention « première partie » : la deuxième comportera un commentaire des chapitres 3 à 5 du livre I du Capital. En outre, plusieurs annexes aborderont d’autres textes de Marx en rapport étroit avec les chapitres 3 à 5, traitant par exemple de la « transition de l’argent au capital », de la loi d’appropriation de la circulation simple ainsi que du concept de survaleur relative. La deuxième partie est prévue pour l’année 2010 5.
1« Neue Marx-Lektüre » ou « New Marx Reading » [NdT].
2Ou aussi « socialisme réellement existant » au gré des formulations de l’époque.
3Dont l’acronyme en allemand commençaient souvent par l’adjectif « communiste », d’où l’appellation de « K-Gruppen ».
4Le « Sozialistisches Büro » ou « SB » est fondé en 1969 pour fédérer les forces socialistes en Allemagne de l’Ouest. Il articule principalement son activité autour de la revue links qui paraît jusqu’en 1997.
5L’ouvrage est finalement paru en 2013 : référence.