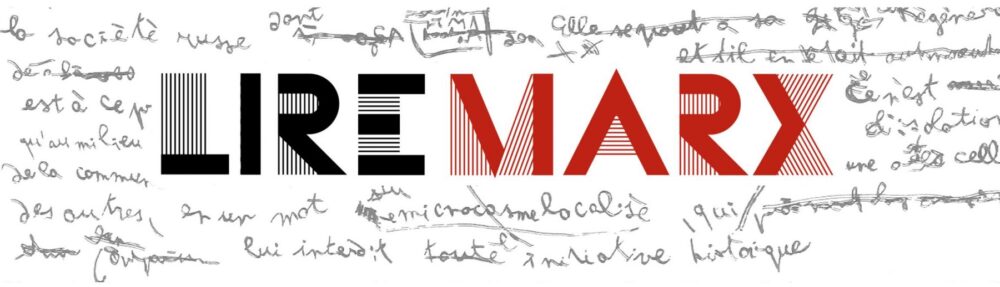« Virtuosité » de la maîtrise du general intellect.
Note de lecture de
Paolo Virno, Grammaire de la multitude, Pour une analyse des formes de vie contemporaines
Après le mouvement de Seattle, le fossé qui séparait les partis communistes traditionnels des « mouvements sociaux » trouva une assise théorique dans le concept de « multitude ». Inscrit dans la ligne pragmatiste-pluraliste de Deleuze et Foucault, les théories autour de la multitude prirent corps dans un premier livre de Negri et Hardt, Multitude1. Ainsi, le livre de Paolo Virno se trouve dans la droite ligne de l’analyse de ce qui n’est pas réductible à une essence (comme la classe ou le capital), au profit d’une appréhension des phénomènes tels qu’ils se donnent, et ceci tout en se voulant être une actualisation du projet marxien de lutte des classes. Notons tout de même que Paolo Virno se distingue de la lecture de Negri et Hardt, en ce que pour lui, le concept de classe peut bien être le synonyme de multitude.
Dans ce livre, Paolo Virno prétend donc faire une analyse des dimensions concrètes d’une forme de vie qui n’est pas le peuple homogène constitué d’individus individués, pris comme totalités finies, mais de ce qui s’appelle la multitude : les individus en cours d’individuation, et qui, dans ce processus sont soumis à des conditionnements autant comportementaux que grammatico-linguistiques. Cette analyse lui permet d’instituer comme principe explicatif la notion de general intellect. Cette notion qui se trouve dans les Grundrisse de Marx lui permet de rendre compte d’une expansion du capitalisme dans les sphères de l’intimité individuelle, qui a le mérite de rendre compte de processus de soumission au mode de production capitaliste. C’est un concept qui permet de répondre à la problématique volonté générale de Rousseau, en indiquant que ce n’est non pas les volontés qui réunissent les producteurs, mais l’intellect. Il permet également une réélaboration matérialiste du concept aristotélicien de noûs poietikos (l’intellect productif) (p.28). En résultent bien entendu de nouvelles perspectives émancipatrices indéniables, de par la paradoxale réhabilitation d’un individu qui ne possède plus uniquement une force de travail, mais aussi une force de maîtrise du general intellect dans lequel il baigne. Il s’agit donc pour Paolo Virno de mettre en lumière où se situent les nouveaux rapports de pouvoir et de production.
Partant d’une analyse philologique, Paolo Virno situe historiquement la disparition du concept de multitude. Ce concept, qui se présente chez Spinoza comme la clef de voûte des libertés civiques, se retrouve chez Hobbes comme caractérisant l’ennemi du peuple : la forme que prend une révolte des citoyens. Or, si cette entité politique est exclusivement pensée, à partir de Hobbes, de manière négative, comme ce qui peut ripper la machine politique, il s’agit de mettre à jour la manière dont elle a survécu à la création des Etats centraux. Mais cette forme de vie qui n’a jamais disparue nécessite une exploration minitieuse de toutes les dérivations qu’ont pris les rapports politiques classiques liés à la notion de peuple. Ces rapports se déclinent en ceux de la dialectique bien trop connue peur/sécurité, puis au niveau de l’expérience humaine, dans une subdivision largement acceptée et qui pourtant « ne tient plus » entre Travail, Politique et Pensée, analyse qui aboutira finalement à une « analyse de la subjectivité de la multitude » (p.15).
L’auteur tente donc, selon ses mots, de faire la physionomie des dimensions concrètes d’une réalité nouvelle qui se trouve dans une « région médiane »: la multitude. Il la définira comme « la manière d’être qui prévaut aujourd’hui » tout en prévenant, « mais comme toutes les manières d’être, elle est ambivalente, c’est-à-dire qu’elle contient la perte et le salut, l’acquiescement et le conflit, la servilité et la liberté » (p.14). D’où la nécessité d’une attention particulère. Paulo Virno part d’une « conviction », celle selon laquelle les couples de catégories régnant en politique ont littéralement « explosés » : « ce qui était strictement divisé se confond et se superpose » (p.12). Cette explosion touche à tout l’échiquier politique et montre par cela une communauté de matrice conceptuelle dépassant les divisions partisanes. Ces couples de catégories qui se confondent à présent sont ceux public/privé (libéral), collectif/individuel (démocratico-socialiste), citoyen/producteur (Rousseau, Marx), un/multiple (logique).
L’auteur le rappelle, la pensée libérale a domestiqué cette entité politique qu’est la multitude en la relèguant à la sphère dite privée, c’est-à-dire en la dépossédant de voix, la rendant ainsi « aphasique et écarté des affaires publiques » (p.12). Ce rejet dans la sphère privée est également caractéristique pour la classification de l’intellect, comme le montre la vie théorique aristotélicienne2. L’« archaïque multitude » survit également dans la pensée démocratico-socialiste dans le couple collectif-individuel, voire même seulement dans l’individuel. Ceci est manifeste selon lui, en ce que l’individuel se trouve pour cette pensée ineffable, comme la multitude. L’individu est ce qui est agité de ces forces incontrôlables et n’est pas encore soumis aux exigences du collectif. Il est regrettable qu’à cet endroit Paolo Virno ne soit qu’allusif. On peut l’excuser en constatant que nous avons cette intuition, qu’effectivement, si elle existe, la social-démocratie véhicule idéologiquement ce type de rapports de conflit entre individu et collectif.
De plus, ceux chez qui on pourrait trouver une grande aide, et qui tentèrent d’investir le terrain sauvage des processus de subjectivation font une erreur. Effectivement, les « post-modernes » opposeraient le « bon multiple » à la « mauvaise unité », alors qu’il faudrait bien plutôt voir dans quelle mesure la multitude redéfinit l’Un. Mais quel est cet Un ? Renversant la manière habituelle de penser, qui suit celle de la fondation des Etats nations, il ne s’agit donc plus de le penser « comme une promesse mais comme une prémisse » (p.13). Que cela signifie-t-il ? Que cet Un n’est plus une fin idéale à laquelle on doit tendre (telos transcendant) ou l’Etat, mais un déjà-donné, voire quelque chose qui se trouve derrière nous : « le langage, l’intelligence, les facultés communes du genre humain » (p.13). L’unité est donc déjà réalisée et présente, elle est ce qui permet tout échange doué de sens.
Paolo Virno poursuit son démantèlement des catégories politiques classiques par l’actualisation de l’expérience vécue par la multitude post-fordiste qui s’écarte intrinsèquement de la rhétorique sécuritaire classique. La dialectique entre crainte et protection repose sur une expérience originaire littéralement absente qui se traduit en une « ligne de partage » qui a disparue. On pourrait croire, en suivant Kant (« sublime » de la Critique de la Faculté de juger) ou Heidegger (distinction entre crainte ontique et angoisse ontologique), qu’il est possible de distinguer entre la peur relative et la peur absolue, l’une d’un danger particulier, comme la perte de son poste de travail, et l’autre liée au monde, dans ce qu’il a d’indéterminations, d’imprévus, celui qui est source d’insécurité permanente (p.18). Selon cette distinction se dessinent deux craintes, l’une circonscrite, et l’autre indéterminée. C’est au sein de la communauté, qui a bâti contre les dangers circonscrits un ensemble d’usages et de coutumes répétitives, qu’apparaît la peur déterminée, alors que la crainte indéterminée, elle, « fait son apparition quand on s’éloigne de la communauté d’appartenance, des habitudes partagées » etc… (p.19), et connaît comme réponse par exemple la mystique.
Trois raisons sont à l’origine de la disparition de cette ligne de partage dans l’expérience vécue par la multitude : l’expérience de l’angoisse à l’extérieur de la communauté repose sur l’idée selon laquelle il y aurait des « communautés substantielles » desquelles, éloignés, nous nous retrouverions face au « monde ». Une communauté substantielle implique l’idée d’un dedans stable face à un dehors instable, mais selon l’auteur, les mouvements brusques, l’innovation incessante que connaissent nos générations se traduisent par une superposition des expériences : « Quand je perds mon travail, je dois affronter, bien sûr, un danger bien défini qui suscite une crainte spécifique ; mais ce danger factuel se teinte immédiatement d’une angoisse indéterminée » (p.20). A l’auteur d’en conclure que les communautés substantielles qui amortissaient la relation au monde se sont dissolues.
Si la peur est un sentiment public au sens qu’il concerne plusieurs membres d’une communauté, et l’angoisse ne renvoie qu’à une intériorité de l’individu, alors il est nié la nature bien trop commune d’une expérience actuelle. Car, suivant la thèse de Heidegger, à l’origine de l’angoisse il y a cette expérience du « ne-pas-se-sentir-chez-soi », qui, bien loin d’être individuelle, est en réalité largement partagée, et de ce fait, ne recoupe plus la distinction faite plus haut. La multitude en aquiert par cela le trait distinctif d’être « réunie par le danger du « ne-pas-se-sentir-chez-soi », de l’exposition plurilatérale au monde (p.22).
La troisième critique de la dialectique crainte/protection part d’une aberration dans la chronologie dont on s’en fait. Suivant les analyses de l’anthropologue Arnold Gehlen, le schéma stimulus-réponse est complètement erroné dans la compréhension du rapport crainte/protection. Plutôt que d’être tout d’abord en contact avec un danger pour ensuite élaborer des stratégies de protection, il est manifeste que cela soit en un premier lieu que nous nous protégions, pour seulement ensuite identifier les différents périls possibles. Par cette chronologie, il est bien plus aisé de rendre compte des dynamiques du cycle infernal des protections, se démultipliant en degrés, les secondes visant à être des antidotes aux premières.
Ainsi, Paolo Virno dégage une « manière d’être » de la multitude : d’être en oscillation continuelle entre des stratégies d’assurance différentes (p.24). Mais surtout, il relève que la condition ordinaire de la multitude est cette incertitude et précarité, une « vie en tant qu’étranger », ce ne-pas-se-sentir-chez-soi qu’Heidegger situait dans une intimité de l’expérience de l’angoisse, alors qu’il faut bien plutôt voir qu’il appartient aujourd’hui aux sentiments partagés, et en ce sens « publics ». (p.21, p.113)
Les lieux communs constituent l’ossature effective, et celle-ci n’apparaissant pas en tant que telle de la trame de notre « vie de l’esprit », ce sont les « formes logico-linguistiques génériques qui fondent tout discours » (p.25). Ce qui apparaît en tant que tel, ce sont, suivant l’expression d’Aristote, « les lieux spéciaux », ces manières de parler spécifiques que l’on adopte selon les lieux, les sphères que l’on rencontre (église, parti, AG).
Sans doute le livre réclamerait une précision philologique plus poussée, mais on ne peut vraiment en blâmer l’auteur, qui se contente, et toujours explicitement d’utiliser les concepts qui lui semblent le plus opératoires pour penser cette forme de vie qu’est la mutlitude. Ainsi, serions-nous aisément troublé de l’usage fait de Heidegger, et ceci, même si l’auteur prévient avoir « simplifié » la traduction Vezin. Il serait en réalité quelque peu déplacé de faire une glose philologique polémiste, alors que l’objectif n’est qu’une mise à jour des concepts décrivant la réalité sociale et politique d’aujourd’hui.
Le general intellect : deus ex machina ?
Le titre du livre, Grammaire de la multitude indique qu’il sera question de l’ensemble des règles conventionnelles (variables suivant les époques) qui déterminent un emploi correct (ou bon usage) de la langue parlée et de la langue écrite. L’objet du livre, bien plus qu’être la multitude, est ce qui la lie normativement, conventionnellement. Avec ce présupposé donc, que c’est la convention, sous toutes ses formes qui lie l’ensemble prépolitique.
Le general intellect c’est l’Un déjà-donné, ce quelque chose qui se trouve derrière nous et qu’en début de livre, Paolo Virno identifiait comme « le langage, l’intelligence, les facultés communes du genre humain » (p.13). La multitude est déjà unifiée veut nous dire l’auteur en ce sens là. Il ne s’agit pas de penser la singularité des processus de subjectivation, ou l’individu individué, mais ce qu’il y a de commun dans ces processus. Evidemment, on se doute que ce commun, dès lors qu’il est reconnu comme tel, doit faire l’objet d’un processus de réappropriation. Ce processus doit passer par l’identification des moyens (de production), puis leur réappropriation. Ils sont déjà ce qu’il y a de plus collectif, la collectivisation à déjà eu lieu à ce niveau-là. Ce qui devra faire l’objet de réappropriation c’est donc, en premier lieu, les cartes de ce lieu commun. En connaissant toutes les sphères sur lesquelles il s’étend, nous pourrions prétendre, au moyen des instruments (ici conceptuels) adéquats, en reprendre possession.
Il semble que le développement effectué par Paulo Virno à partir de la multitude n’a qu’un seul et unique but : rendre compte de l’étendue couverte par la notion de general intellect. Ainsi, l’Etat est ce general intellect dépourvu sphère publique et « qui exerce la pression d’un pouvoir impersonnel et despotique » (85). Le general intellect se déplace dans les sphères « pré-individuelles », c’est-à-dire, le fonds biologique (81), et la langue « historico- naturelle » (82). Les deux se distinguent, en ce que le premier ne peut être singularisé, ce n’est jamais un « je » individuel qui sent qui voit, qui touche, écrit Virno en citant Merleau-Ponty, alors que le second est bien un lieu privilégié d’individuation. Ainsi, la langue a le double caractère d’être une faculté, et en ce sens, un pouvoir dire, et de l’autre, l’espace d’une énonciation particulière, une puissance indéterminée. De ce point de vue, la langue est ce qui permet le saut du pré-individuel à l’individuel : le processus d’individuation. Mais ce qui est remarquable c’est le troisième aspect du pré-individuel : le rapport de production dominant, et ce ci par le fait qu’il mobilise « les qualités les plus universelles de l’espèce : perception, langage, mémoire, affects » (83).
« Le general intellect est le savoir social devenu principale force productive, c’est l’ensemble des pradigmes épistémiques des langages artificiels, des constellations conceptuelles qui innervent la communication sociale et les modes de vie » (100).
Paolo Virno entend le general intelellect comme une interaction des savoirs, initiatives, subjectivités et forces-inventives de la société et de ses membres.
Marx comprend le general intellect comme « l’ensemble des connaissances qui constituent l’épicentre de la production sociale, et ensemble, ordonnent tous les milieux de vie » (118). Ce que Paulo Virno retient du Fragment sur les machines tiré des Grundrisse, c’est son caractère peu « marxiste ». Et ceci en ce que dans ce passage, Marx relègue le travail productif parcellarisé et répétitif à une forme résiduelle pour considérer comme principale force productive le savoir scientifique. C’est donc la loi de la valeur, selon laquelle la valeur d’une marchandise est déterminée par le temps de travail qui est incorporé en elle, qui est remise en question.
Mais qu’en est-il de la classe qui fait un métier de communication, qui est dans la diffusion d’art, car voici ceux que Paolo Virno a en tête quand il parle de « multitude ». En effet, il y fait allusion, une première fois sur la virtuosité, et une seconde en évoquant Benjamin, et Heidegger. Mais les comportements qu’il montre vont bien au-delà de l’activité salariale, ils décrivent l’espace privé dans ce qu’il a de public. L’intime dont l’ « in- » disparaît. Car si seuls certains corps de métier sont touchés par ce type de fonctionnement de manière immédiate, en ce qu’il fait partie de son fonctionnement en propre, de mettre en valeur leurs « facultés sociales », c’est l’ensemble des rapports sociaux qui en ont l’empreinte. Comment s’effectue ce passage d’un type de rapport social isolé et encadré dans une entreprise dans un mode de production déterminé, à un rapport généralisé de tous avec chacun ? C’est bien simple. Le paradigme post fordiste sur lequel s’appuie Paulo Virno, a pour caractéristique principale de s’être transformé en machine de la recherche scientifique. Tout ce qui est capté par le capital, ce sont les forces inventives, les rhapsodies effectuées par les virtuoses que nous sommes. Un ballet que nous effectuons, de plus, tous sur les mêmes pas, qu’en ajustements progressifs nous avons réussi à établir. Un exploit de l’amer goût d’un échec. Alors certainement d’un côté nous sommes les plus actifs, par notre brassage incessant du general intellect, mais d’un autre, c’est cette activité qui est productrice de plus-value. Il ne reste plus qu’à définir la philosophie comme cette activité, faite à un plus haut niveau, de brassage de general intellect. L’Eldorado du capital est alors la philosophie.
En Italie, l’usage de la conceptualité marxienne issue des Grundrisse pour chercher à réinvestir la subjectivation politique des ouvriers remonte à 1969. Elle est inaugurée par Raniero Panzieri, qui créé alors la revue opéraïste Quadri Rossi. C’est contre le déterministe objectiviste défendu par la 3ème Internationale, notamment au travers du Parti Communiste Italien, que des théoriciens comme Panzieri tentent d’encadrer le mouvement ouvrier et étudiant naissant dans les années 70. L’usage du general intellect exalte à l’opposé la « révolution subjective ». Le mouvement opéraiste se brise alors sur la question du passage des luttes autonomes ouvrières aux luttes politiques, si bien que dès 1963, deux élèves de Panzieri se séparent de lui pour fonder la nouvelle revue Classe operaia.
Pour penser un engagement politique aujourd’hui ou envisager une lutte émancipatrice qui intègre des sujets qui ne se comprennent pas encore comme révolutionnaires, il faut donc partir de cette analyse de Virno. La grammaire qu’il établit permet de remettre en question la rhétorique politicienne, militante, pour tenter de construire le pont entre le militantisme et « la langue que parlent les gens ». La grammaire de la multitude doit donc devenir celle de toute entité politique sans transcendants, qui doit avant tout accepter que chacun de ses membres est déjà uni par et surtout dans cette grammaire, et que si discussion ou participation éventuelle, intérêt, ou désir de lutte on peut éveiller, cela ne sera possible qu’à la mesure de la maîtrise et de la « virtuosité » que l’on a du general intellect.
1 Michael Hardt, Antonio Negri, Multitude. Guerre et démocratie à l’âge de l’Empire, La Découverte, 2004. La rupture entre l’engagement par des structures partisanes et un niveau subjectif de résistance se trouve en réalité plus en amont dans l’exaltation de la révolution subjective contre le déterminisme objectiviste du marxisme, exaltation qui trouva son assise théorique avec Panzieri contre la 3ème Internationale au travers de la fondation de la revue Quaderni Rossi en 1961. (voir André Tosel, Le marxisme de 20ème siècle, p.75 s.)
2 Pour la question du rapport entre vie intellectuelle et vie politique, séparation des sphères privées et publiques chez Aristote, voir aussi Arendt, La condition de l’homme moderne, p.50.