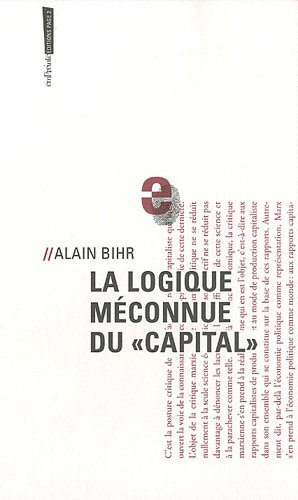 Alain Bihr, La logique méconnue du Capital, 2010.
Alain Bihr, La logique méconnue du Capital, 2010.
Cet ouvrage remarquable d’Alain Bihr, à qui l’on doit notamment l’impressionnante œuvre portant sur la « Préhistoire du capitalisme », est paru en 2010 aux éditions Page 2. Il réussit l’exercice assez complexe de résumer les trois livres du Capital en quelques 120 pages. Ce travail de synthèse permet à qui n’a pas lu les trois livres du Capital d’en avoir un aperçu à la fois précis et didactisé de manière concise. A conseiller donc vivement à qui veut s’initier à la logique qui articule les trois livres, mais peut-être plutôt à des personnes ayant déjà lu au moins le Livre I.

 La fonction de la katabase chez Marx.
La fonction de la katabase chez Marx.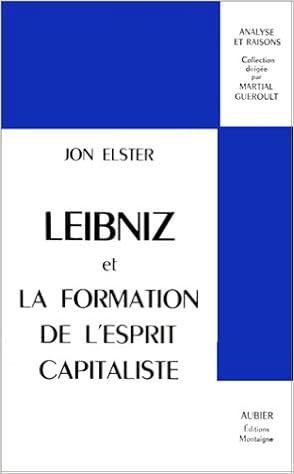 Jon Elster,
Jon Elster,  Rolf Hecker : Springpunkte. Beiträge zur Marx-Forschung und « Kapital »-Diskussion (Contributions à la recherche sur Marx et aux discussions sur le Capital).
Rolf Hecker : Springpunkte. Beiträge zur Marx-Forschung und « Kapital »-Diskussion (Contributions à la recherche sur Marx et aux discussions sur le Capital). Le texte ci-dessous constitue la préface d’un ouvrage récent très intéressant réédité par les Editions Syllepse : Essais sur la théorie de la valeur de Marx (d’Isaac Roubine).
Le texte ci-dessous constitue la préface d’un ouvrage récent très intéressant réédité par les Editions Syllepse : Essais sur la théorie de la valeur de Marx (d’Isaac Roubine).
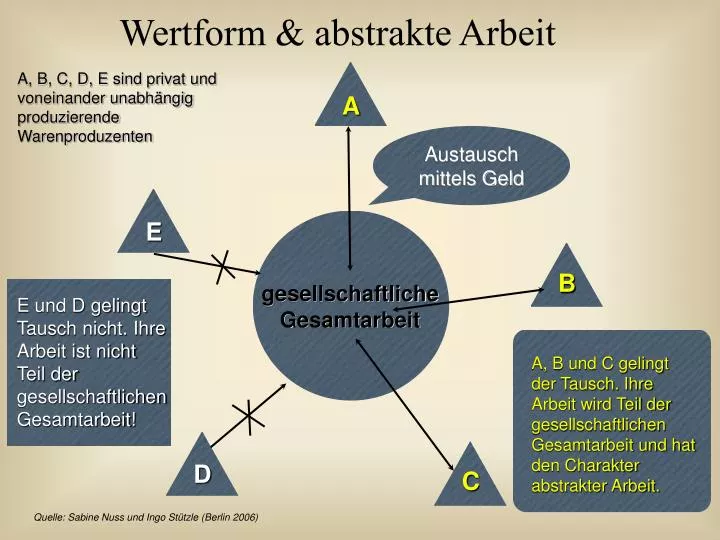 Arbeitsblätter zur Marx-Engels-Forschung Heft 18 Halle(Saale) 1986, ZUR THEORETISCHEN BEDEUTUNG DER „WERTFORM“ IM „KAPITAL“ VON KARL MARX ), Masao Oguro
Arbeitsblätter zur Marx-Engels-Forschung Heft 18 Halle(Saale) 1986, ZUR THEORETISCHEN BEDEUTUNG DER „WERTFORM“ IM „KAPITAL“ VON KARL MARX ), Masao Oguro Pourquoi revenir à Marx? Michael Heinrich
Pourquoi revenir à Marx? Michael Heinrich Ambivalences: Présentation de La science de la valeur
Ambivalences: Présentation de La science de la valeur Conséquences -Une introduction à la théorie de la valeur de Marx
Conséquences -Une introduction à la théorie de la valeur de Marx Salaire, Prix et Profit, c’est un petit bouquin d’à peine 70 pages qui ne paie pas de mine. Et pourtant, c’est dans les grandes lignes de cet essai que Marx esquisse sa théorie de la valeur : toute la valeur vient du travail. Toute ? Toute ; pas un kopeck ne lui échappe. Certes, mais à quoi ça sert ? A démontrer que le salariat, qui ne rémunère que partiellement le travail, ne se distingue du servage et de l’esclavage que par sa forme historique. Comme mode d’exploitation, il est impossible pour un socialiste de prétendre l’améliorer : la seule alternative est son abolition.
Salaire, Prix et Profit, c’est un petit bouquin d’à peine 70 pages qui ne paie pas de mine. Et pourtant, c’est dans les grandes lignes de cet essai que Marx esquisse sa théorie de la valeur : toute la valeur vient du travail. Toute ? Toute ; pas un kopeck ne lui échappe. Certes, mais à quoi ça sert ? A démontrer que le salariat, qui ne rémunère que partiellement le travail, ne se distingue du servage et de l’esclavage que par sa forme historique. Comme mode d’exploitation, il est impossible pour un socialiste de prétendre l’améliorer : la seule alternative est son abolition.